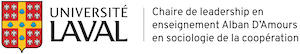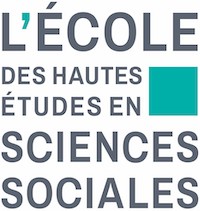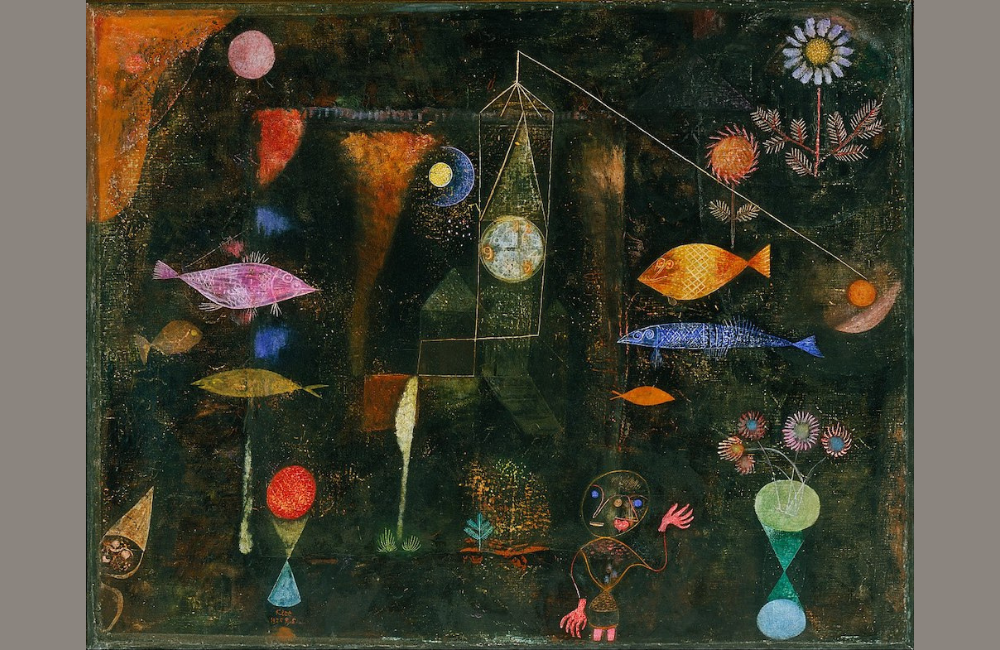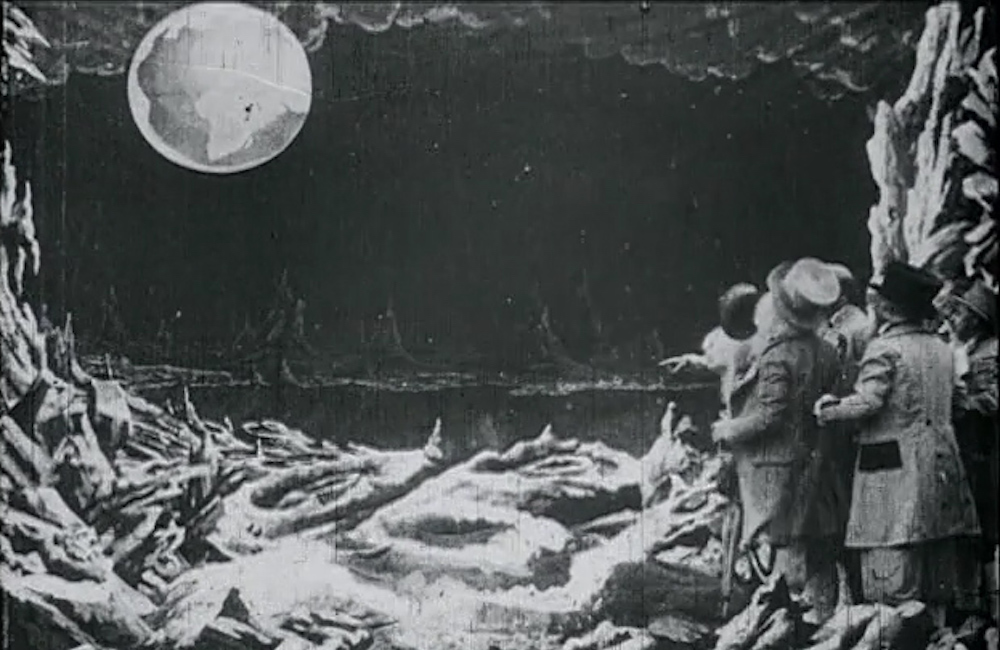RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
Jean-François CHIANTARETTO : Tomber dans le monde, tomber hors du monde
Comment rendre compte aujourd'hui des conditions psychiques et sociales du sentiment d'appartenance au monde des semblables ? D'un point individuel comme d'un point de vue collectif, la question se pose à l'entrecroisement des identifications individuelles et des identifications collectives, de la dimension intrapsychique et culturelle du narcissisme, du narcissisme de vie et du narcissisme de mort. Elle oblige les psychanalystes à s'interroger tant sur la dimension politique de la cure — et du travail de culture dans la cure — que sur les conditions de possibilité sociales et culturelles de la psychanalyse. Et à recommencer le geste métapsychologique des commencements, hérité de Freud : de la psychanalyse, de la psyché.
Jean-François Chiantaretto est psychanalyste, membre du Quatrième Groupe OPLF. Il est Professeur émérite en psychopathologie clinique à l'université Sorbonne Paris Nord, où il a dirigé l'Unité de Recherches Transversales Psychopathologie et Psychogenèse (UTRPP UR 4403). Tous ses livres sont animés par la question de "l'interlocution interne" dans la cure et l'écriture, envisagée sous l'angle des commencements : de la psychanalyse, de la psyché. Il a dirigé ou co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs, dont huit à partir de colloques de Cerisy, le dernier en 2024 (avec H. Abdelouahed et J.-M. Hirt) : L'Écriture du malaise, Ithaque, 2024.
Publications
Le témoin interne, Aubier, 2005.
Trouver en soi la force d'exister, Campagne Première, 2011.
La perte de soi, Campagne première, 2020 (The loss of Self : Self-Writing s a Tool in Borderline Psychoanalysis, Routledge, 2025 ; A perda de si, Blucher, 2025).
Se parler, parler. À l'écoute de l'infans dans l'adulte, Campagne Première, 2025.
Ellen CORIN : La réalité en questions
Parfois, le monde me déroute, ne cadre pas avec ce que je pensais en savoir. Un trouble qui peut surgir dans la clinique, l'impression que quelque chose m'échappe, ou devrait m'échapper pour me permettre d'entendre. Que mes repères théoriques sont en défaut, ou insuffisants pour approcher la complexité de ce que vivent ou cherchent à dire les patients. Quel tribut la réalité psychique paie-t-elle à la réalité historique ou culturelle dans laquelle elle s'inscrit ? Peut-on laisser cette dernière hors-jeu ? À quel prix ? Comment se laisser affecter sans céder à la mode, sans perdre le nord ? Mais peut-être faut-il parfois le perdre ? À quoi pouvons-nous/devrions-nous encore nous identifier ? Ou nous désidentifier ? Quel rôle peuvent jouer ici l'imagination, l'écriture, certaines formes d'art ? Et comment penser la transmission dans ce contexte ?
Ellen Corin est psychanalyste, membre et actuellement présidente de la Société Psychanalytique de Montréal, dont elle a été la secrétaire scientifique de 2017 à 2021. Elle est professeur émérite aux départements d'anthropologie et de psychiatrie de l'université McGill.
Publications
Corin E. (2025), "De l'art brut à l'art", in C. Mestre et M. Géry (eds), Art Soins : Les frontières imaginées, Éd. La pensée sauvage.
Corin E. (2021), Des traces en souffrance d'un dire, Revue française de psychanalyse, LXXXV, 4 : 857-867.
Corin E., Branchereau L. & Johnson C. (dir.) (2019), L'étranger, figure du proche, Actes du colloque de la Société psychanalytique de Montréal, 2018.
Corin E. (2013), "Entre le même et l'autre, l'Altérité comme passeur", L'Information psychiatrique, 89, 6 : 435-442.
Corin E. (Ed) (2010), Psychanalyse et Anthropologie. L'ébranlement d'une rencontre, Anthropologie et Société, 34, 3.
Georges GAILLARD : Consentir à la présence, tolérer la pluralité
Les mutations contemporaines transforment la psyché des sujets et leurs modalités d'"être ensemble", les livrant à la tentation d'un narcissisme exacerbé délié de sa dette d'altérité, dans une temporalité saturée. L'hypermodernité met en effet en chauffe une rivalité généralisée, où la haine et la prédation se donnent libre cours, corrélativement à l'affaiblissement des figures de l'hétéronomie, ces figures qui inscrivent le sujet dans une limite, sous le registre de la loi. Comment l'analyse participe-t-elle à dédensifier la temporalité, et autorise-t-elle le sujet à consentir à la présence ? Simultanément, en tant qu'analystes, comment faisons-nous vivre la pluralité, tout à la fois dans la pratique de la cure et dans la vie de nos groupes et institutions — où le narcissisme est menacé de se désintriquer d'un investissement de l'altérité ?
Georges Gaillard est psychanalyste, membre du Quatrième Groupe - OPLF ; professeur émérite au Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique de l'université Lumière Lyon2, et Membre de l'association européenne Transition. Ses recherches portent sur l'intrication entre le travail de subjectivation et les arrière-fonds sociétaux, et sur la prise en compte de Thanatos dans la construction psychique des sujets, des groupes et des institutions.
Publications
Le travail psychanalytique en institution. Manuel de clinique institutionnelle (avec J.-P. Pinel), Dunod, 2020.
Psychanalyse et culture. L’œuvre de Nathalie Zaltzman (avec J.-F. Chiantaretto), Colloque de Cerisy (2019), Ithaque, 2020.
"Le don de présence. La temporalité entre dépossession et appropriation", Connexions, n°123, 2025/2.
"La technique : entre dévoration du monde et émergence d'une humanité en partage", Le Coq Héron, 2025/262.
Arlette LECOQ : Les blessures narcissiques infligées à l'humanité
L'héliocentrisme, l'évolution des espèces et la découverte de l'inconscient ont infligé des blessures narcissiques à l'humanité. Aujourd'hui la menace qui plane sur l'avenir de l'espèce humaine, l'accès à l'intelligence artificielle, la robotisation et d'autres bouleversements saturent l'air du temps et viennent altérer collectivement et individuellement nos âmes. Une dépression collective, des mouvements de dépsychisation et de déni pourraient modifier nos fonctionnements psychiques et nous faire craindre la perte de nos référents analytiques. Avec quelques auteurs, avec en point de mire le travail du négatif et de culture, avec l'aide de la créativité artistique, trouverions-nous de nouveaux fils à tisser, des voies analytiques de survivance et de transmission à notre époque ?
Arlette Lecoq est psychiatre, psychanalyste, formatrice et secrétaire scientifique de la Société Belge de Psychanalyse, dont elle a été présidente. Elle fait partie du groupe Fimmpic. Elle a été maître de conférences à l'ULG. Auteure d'articles dans des revues internationales, ses réflexions portent notamment sur les traumatismes collectifs et le champ psychosomatique.
Publications
"Entre l'esprit du mal et la vie de l'esprit, d'Angkar à AngKor", in Psychanalyse et culture. L’œuvre de Nathalie Zaltzman, Colloque de Cerisy (2019), Ithaque, 2020.
"Deux petits enfants racontent…", Revue belge de psychanalyse, n°82, 2023.
"La solitude et l'incertitude de l'analyste", Revue française de psychanalyse, 2023/5, Vol 87.
Gérard BAZALGETTE : La panique
Une difficulté majeure, voire une impasse de notre appareil de Sens millénaire, tel que décrypté en partie par une psychanalyse qui ne parvient plus à partager l'avancée de ses recherches avec le collectif, devient de plus en plus manifeste. Et progressivement, dans la pensée et au-delà du structuralisme, ce sont les principes mêmes de la mise en sens avec le rôle central qu'y jouent la négativité et son travail qui vont être bousculés. Ce travail du négatif qui aboutissait aux concepts de manque et de castration symbolique pour la psychanalyse va être dénié et laissé pour compte. Cet abandon, il faudra essayer de dire pourquoi et comment, va de pair avec l'arrivée ou le retour en force de la machine et de l'homme machinique avec ses mécaniques, ses flux, ses contre-flux et ses stases. Il ne semble pas que la menace de chaos aussi bien individuel que collectif que nous vivons aujourd'hui soit conjurée par cet exil du négatif et par la volonté de puissance qui vient alors s'exhiber en son lieu et place (Wille zur Macht). Un sentiment de panique s'installe et le devoir de la psychanalyse est sans doute d'essayer de penser encore et toujours cette situation, y compris en pensant sa propre transformation.
Gérard Bazalgette est psychanalyste, membre et ancien président du Quatrième Groupe.
Publications
La tentation du biologique et la psychanalyse. Le cerveau et l'appareil à penser, Toulouse, Éditions Érés, 2006.
La folie et la psychanalyse, Paris, Éditions Campagne Première, 2017.
Articles
"La subversion hystérique", in G. Lévy (dir.), L'esprit d'insoumission. Réflexions autour de l'œuvre de Nathalie Zaltzman, Paris, Éditions Campagne Première, 2011.
"Une résistance de la psychanalyse", Actes 1 du Quatrième Groupe - La situation de la psychanalyse, Paris, Éditions In Press, 2012.
"Interpréter sans relâche", Actes 9 du Quatrième Groupe - Destins d'un idéal, Paris, Éditions In Press, 2020.
"Écriture poétique et écriture psychanalytique", Le Coq-héron, n°243, 2021.
"Le corps pulsionnel dans la création : simulacre et perversion", Revue canadienne de psychanalyse, vol. 29, n°2, automne 2021.
André BEETSCHEN : La culpabilité et le vivant, écouter le meurtre
L'intention freudienne "de mettre en avant le sentiment de culpabilité comme le problème le plus important du développement de la culture" ("Le Malaise dans la culture", OCF.P XVIII, p. 321) est-elle toujours d'actualité ? De l'identification à l'autre blessé et de l'inéluctable violence pulsionnelle ou narcissique, que peut dire encore la psychanalyse, et par qui peut-elle être entendue ? Le souci du vivant pour les générations futures, le souci de la vie psychique pour nos enfants, ne peuvent que rencontrer l'élaboration du sentiment de culpabilité.
André Beetschen est psychanalyste, membre titulaire de l'APF. Il travaille à Lyon. Ses principaux objets de recherche portent sur la conviction en psychanalyse, la pulsion et les résistances, le sentiment de culpabilité et le surmoi.
Publications
"Désarroi et intempérance", Folies paternelles, Paris, Puf, 2020.
"Une action antagoniste et conjointe", Le Présent de la Psychanalyse, 2022.
"Une revendication indomptable ?", Revue canadienne de Psychanalyse, 33, 2025.
"Les forces adverses", Actes 13 du Quatrième Groupe - Résistances, Paris, In Press, 2025.
Frédéric BURDOT : La Fabrique de Monstres
L'exigence contemporaine de performance identitaire, soutenue par le "technocratique", via les chirurgies plastiques excessives, les mirages d'infinie séduction et jouvence ou encore les parcours extrêmes de transidentité, promet outrageusement réparation et expansion infinie du narcissisme en faisant du corps leur lieu d'élection. La promotion pervertie de ces prothèses de contenance face aux terreurs informes et à la destructivité à l'œuvre, séduit et abuse aisément des sujets déjà fragilisés par une histoire de non-rencontre et transforme leur quête ontologique en surconsommation "monstrigène" du corps. La figure du monstre, au départ maillon symbolique culturel entre informe et représentation, s'empare du corps réel, révélant le paradoxe d'une idéologie qui encourage ces emprises pseudo réparatrices et en stigmatise les effets comme monstrueux. Au-delà du désir du sujet, s'agit-il pour la psychanalyse de s'altérer en validation, ou, au contraire, d'accueillir la détresse et de soutenir un travail de culture contre la destructivité de ce Mal actuel qui promet au corps des exaltations narcissiques impossibles ?
Frédéric Burdot est psychologue et praticien de la Société Belge de Psychanalyse. Il est cofondateur du Centre d'Accompagnement de la Transidentité du CHU de Liège.
Publications
Burdot, F. (2018), "Le mauvais genre a-t-il bon genre ?", Revue Belge de Psychanalyse, 72.
Burdot, F. & Malchair, A. (2015), "L'aménagement transsexuel comme solution à l'adolescence", Enfances & Adolescences, 28(2), 95–102.
Laura DETHIVILLE : Le psychisme au miroir déformant du numérique
Si "je est un autre", comme disait Rimbaud, que se passe-t-il quand cet "autre" devient de plus en plus virtuel (ce qui ne veut pas dire imaginaire), en particulier à l'adolescence où se jouent tous les remaniements identificatoires ? Nous sommes dans une rupture anthropologique où le processus de clivage devient plus opérant que celui du refoulement. Au-delà de la question d'une approche différente du cadre psychanalytique bousculé par les nouvelles techniques (Skype), la question est plutôt : que peut la psychanalyse quand l'espace transitionnel cher à Winnicott est aussi effracté ?
Laura Dethiville est psychanalyste, membre associé et fondateur de la SPF (Société de psychanalyse freudienne), présidente de l'IWA (International Winnicott Association) France. Elle a par ailleurs écrit de nombreux articles en France et à l'étranger.
Publications
Donald W. Winnicott, une nouvelle approche, Paris, Campagne Première, 2008 (traduit en anglais, italien, portugais et chinois).
La clinique de Winnicott, Paris, Campagne Première, 2013 (traduit en anglais, italien, portugais et chinois).
(dir.) Winnicott, notre contemporain, Paris, Campagne Première, 2015.
(dir.) Winnicott, un psychanalyste dans notre temps, Lettres de la SPF, 21, 2009.
Claire DE VRIENDT-GOLDMAN : L'outil psychanalytique, une œuvre d'art à sculpter au fil du temps
L'annonce du déracinement d'un ensemble sculptural pour le motif que l'œuvre incarne "la toute-puissance patriarcale", et de son remplacement par une sculpture réalisée "dans une perspective féministe" a suscité en moi un mouvement de protestation. La liquidation de l'œuvre d'art s'apparenterait à l'une des définitions de la cancel-culture : la destruction pure et simple de ce qui appartient à l'Autre de soi-même dénié, dans une logique binaire de vie et de mort. Dans l'indolence actuelle à penser et à (se) confronter, la psychanalyse pourrait-elle subir le même sort, à savoir être détruite et remplacée par une pensée qui, dans un excès "féministe", pourrait d'une part négliger voire abandonner la force vitale de l'altérité, d'autre part éliminer l'Autre, tiers incontournable des origines ?
Claire De Vriendt-Goldman est pédopsychiatre, membre-titulaire et présidente de la Commission d'enseignement de la Société belge de Psychanalyse.
Publications
"Prologue au roman familial dans les suivis de PMA", Revue belge de Psychanalyse, n°75, 2019/2.
"Sans père, Ou la monoparentalité maternelle ab initio", Cahiers de psychologie clinique, n°60, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2023/1.
Brigitte DOLLÉ-MONGLOND : Défendre "l'appareil de l'âme", et la mise en questions
Si un état des lieux reflète certains pans de déréliction de l'humain, n'y a-t-il pas précisément nécessité de penser autrement cette traversée d'un chaos civilisationnel avec la perte de confiance qui l'accompagne ? En écho à l'avancée freudienne prise dans la déflagration de 1915 — "la désillusion causée par la guerre" — qui va pourtant générer après la période d'abattement cet immense élan créateur portant le renversement théorique de la seconde topique. Que peut l'analyste si ce n'est maintenir la pensée pensante, et faire de la psychanalyse en ce qu'elle incarne : une pratique clinique dans un travail psychique, à la fois de deuil et de sublimation, qui tend vers une réorganisation pulsionnelle des forces obscures résidant en nous, et un outil apportant sa contribution au travail de pensée corrélé aux problématiques sociétales qui sont les nôtres. Prolonger la théorisation du traumatisme trouverait ici une valeur heuristique en ce qu'il renvoie à ces deux niveaux intriqués dans l'acte analytique. Aujourd'hui, dans les impasses d'un narcissisme débridé, les voies de la transmission de/pour la psychanalyse ne peuvent passer que par la force du collectif, au-delà de nos divisions internes et en articulation avec d'autres disciplines de l'esprit, afin de maintenir ouverts des modes de pensée et d'interprétation connexes, notamment l'art, l'histoire.
Brigitte Dollé-Monglond est psychanalyste, membre du Quatrième groupe, psychologue clinicienne, docteure en Lettres Modernes, membre titulaire de la SFTF. Elle est l'auteure de nombreuses publications : articles, contributions dans des recueils collectifs, et ouvrages. Les thématiques centrales de ces travaux sont : Étude des affects dans une approche psychanalytique ; Travail de culture, éthique, et questions contemporaines.
Publications
La thérapie familiale à l'heure de la singularité des couples et familles, Paris, ESF, 2021.
"Un seul choix possible", Résistances, Actes 13 du Quatrième groupe, Toulouse, In Press, 2025.
"Entrecroisements des affects". in M. Lauret (dir.), L'inceste fraternel, Toulouse, Érès 2024.
(dir.) Penser l'espoir, regards psychanalytiques, Presses universitaires du Midi, à paraître en 2026.
Martin GAUTHIER : La corruption masculine autocratique
Les rapports entre les dérives autocratiques et la domination masculine seront explorés à partir des impensés et des biais que Freud a introduits, notamment dans son mythe des origines et sa perspective du féminin. Le surmoi de la communauté civilisée (Kultur-Überich) ne pourra déployer sa protection que si la bisexualité est pleinement prise en compte, ce qui implique un difficile travail pour reconnaître et rendre tolérable la dépendance. Les troubles du narcissisme corrompent par crainte du mouvement relationnel qui altère inévitablement. Seule une psychanalyse altérable-altérée demeure une technique culturelle vivante. La formation doit en témoigner.
Martin Gauthier, pédopsychiatre et psychanalyste formateur, membre de la Société psychanalytique de Montréal (Société canadienne de psychanalyse), a travaillé à l'Hôpital de Montréal pour enfants et enseigné au Département de psychiatrie de l'université McGill pendant 35 ans. Avec ces derniers travaux, le traitement de l'ambivalence dans les rapports avec son corps propre, avec les autres et avec l'environnement a été au cœur d'une piste de recherche questionnant le narcissisme, ses troubles et ses liens avec le cadre analytique.
Publications
"Un temps déraisonnable", Revue canadienne de psychanalyse, 31, 2, 179-193, 2023.
"Of Skin and of Self-mutilation in Adolescence", in R. Cassorla & S. Flechner (eds), The Astonishing Adolescent Upheaval in Psychoanalysis, London, Routledge, 38-53, 2024.
"Se faire son cinéma. Nos voyages en train et leurs accidents", Filigrane, sous presse, 2025.
Pierre JOLY : La psychanalyse dés/idéalisée ?
Notre culture actuelle ne s'apparente-t-elle pas, sous plusieurs aspects, au Meilleur des mondes, un monde où un bonheur artificiel, dont est exclue l'intimité véritable, a remplacé la condition humaine tragique et incertaine ? L'espace analytique se trouve-t-il ainsi dévalorisé, telle la "réserve" dans le roman de Huxley, lieu des douleurs de l'enfantement, de la filiation, des passions, de la vieillesse et de la mort ? Ou, au contraire, a-t-on tendance à parler de l'analyse comme du lieu de l'inaliénable, du plus précieux ? Mais alors, que faire de l'aporie du discours idéalisant ?
Pierre Joly, Ph. D, est psychanalyste, membre et actuel secrétaire scientifique de la Société psychanalytique de Montréal. Il s'intéresse aux phénomènes de groupe abordés dans une perspective psychanalytique, tant en ce qui concerne la psychothérapie que l'analyse institutionnelle.
Publications
"Du phénomène du coucou dans les groupes de psychothérapie", Filigrane, 31 (1), 2023.
"De l'idée à l'idéologie, des "meilleures pratiques" au Meilleur des mondes", Filigrane, 31 (1), 163-172, 2023.
"Le retour de l'idéal", Filigrane, à paraître, 2026.
Anouche KUNTH : Saisir la trace, mettre en lumière, faire consister les vies
Comment reprendre place dans un monde où rien de ce qui était n'est plus ? Où même l'ordinaire n'est plus ? En adressant ces questions aux survivants du génocide des Arméniens, mon travail cherche à décrire ce que devient la vie au lendemain d'un crime sans nom : la vie à l'épreuve de la déchirure. Cette intention est indissociable d'une réflexion sur ce qui, dans l'archive, fait signe, résiste à l'effacement, à l'oubli, à la nuit du mensonge. Il s'agit alors de rendre apparent le geste historien permettant à la trace de faire sens, inscription.
Anouche Kunth est historienne au CNRS (IRIS-EHESS), médaille de bronze CNRS 2020. Elle co-dirige la revue Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales.
Publications
Exils arméniens. Du Caucase à Paris (1920-1945), Belin, 2016.
Au bord de l'effacement. Sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres, La Découverte, 2023 (Prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, 2023).
Isabelle LASVERGNAS : Virtuel de masse et psychanalyse
À quelles relectures des analyses freudiennes du malaise dans la culture et de la psychologie des foules, convoquent la montée en puissance dans le monde occidental d'une pulsion totalitaire et la sensation d'effondrement de la Kulturarbeit qui l'accompagne, notamment dans l'atteinte de la langue dans les discours de la "post-vérité" ? — auxquelles s'ajoutent deux transformations majeures dans les modalités du fonctionnement du socius : la puissance identificatoire et l'attraction politique des masses sociales physiquement intangibles produites par les réseaux sociaux ; et l'émergence d'une culture du virtuel dans les échanges interindividuels des technologies à distance et leur modification du rapport au réel. Jusqu'à quel point ce fonctionnement d'un virtuel de masse a-t-il déjà altéré la pratique analytique dans ses dispositifs et sa méthode ? Quels effets potentiels sur la théorie de la cure ?
Isabelle Lasvergnas est psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Montréal. Auteure de nombreuses articles et chapitres de livres, elle a publié 8 ouvrages collectifs en France et au Québec, dont en 2024, Les antichambres du langage, Monographie, Filigrane. À paraître sous sa direction en 2026 aux Presses de l'université de Montréal : La création psychique entre vie et mort (Dans le sillage de Michel de M'Uzan). Ses principales thématiques de recherche et de publication portent sur la méthode psychanalytique et l'écoute de l'analyste, ainsi que sur les rapports entre processus sociaux et processus inconscients.
Ghyslain LÉVY : Un trouble dans l'identification
Tout travail de déshumanisation de l'autre est la conséquence directe d'un trouble de l'identification. C'est à partir de cette constatation que je me propose d'explorer la menace explosive que peut représenter le familier, le trop proche et avec lui l'angoisse du double, au fondement des formes contemporaines de l'antisémitisme, du racisme et de la volonté de meurtre de masse. En d'autres termes, c'est toute la question du politique et ce qu'elle fait aujourd'hui à la psychanalyse et dans la psychanalyse, qui se trouve ici posée.
Ghyslain Lévy est psychiatre et psychanalyste à Paris, membre et actuellement secrétaire analytique du Quatrième Groupe. Il a dirigé de longues années le Séminaire "Penser avec le mal", initialement avec Nathalie Zaltzman.
Publications
Survivre à l'indifférence, Éditions Campagne Première, 2019.
La vie partielle, Éditions Campagne Première, 2021.
Malaise dans la fraternité, Éditions Campagne Première, 2024.
L'allégresse, Éditions du Palio, 2025.
L'idiot intime, Éditions Ithaque, à paraître en 2026.
Irène NIGOLIAN : Pourquoi la psychanalyse en temps de guerre ?
La psychanalyse pratiquée dans les années 80-90 en Suisse respirait le calme et la neutralité, à l'image du pays. Rien ne pouvait perturber le déploiement naturel du processus interne, garanti et assuré par l'analyste. Les initiés admis à la formation avaient l'impression d'avoir trouvé le graal, et l'avenir semblait tout tracé. Un regard critique s'impose aujourd'hui sur cette période de certitude, et le rôle de la psychanalyse dans l'écoute du nouveau désordre mondial doit être reconsidérée. Est-elle encore crédible lorsque la logique guerrière devient prévalente dans nos sociétés ? Lorsque la confusion, voire la perversion règnent en maître dans le discours politique et social ? À l'inverse, l'expérience collective d'instabilité et d'insécurité ne vient-elle pas soutenir une démarche psychanalytique engagée, "pour le meilleur et pour le pire" ? Une expérience individuelle et groupale d'intervention psychanalytique dans un contexte de guerre et de pandémie en 2020, va servir de toile de fond pour aborder cette réflexion, et pour redécouvrir la complexité et le profond humanisme de notre discipline.
Irène Nigolian est psychiatre d'enfants-adolescents et d'adultes, psychanalyste, membre formatrice de la SSPsa, anciennement membre d'IPSO Pierre Marty. Intérêts spécifiques : adolescence, psychosomatique, génocide arménien, transmission de la psychanalyse dans les pays de l'est.
Publications
"Construction et intuition", La psychosomatique dans tous ses états, autour des travaux de Jacques Press, collection "Perspectives psychosomatiques", 2020.
"Naissance et développement de la psychanalyse en Arménie, en quête d'un père absent ?", Psychologie clinique, n°60, 2025/2.
"La chimère arméno-turque", Le Coq-Héron, n°263, 2026.
Ellen SPARER : L'Institution psychanalytique : peut-elle être psychanalytique ?
La création de l'Association psychanalytique internationale coïncidait avec les préoccupations de Freud concernant la pérennité de sa découverte. La psychanalyse est alors placée au cœur de l'institution. Il est commun d'observer que la filiation à Freud en France s'opère par le truchement de son œuvre. Mais cela pose-t-il un paradoxe entre l'œuvre et l'institution ? À la lumière de mes investissements institutionnels, je propose une réflexion sur la place de la psychanalyse dans l'actualité.
Ellen Sparer est psychanalyste, membre titulaire formatrice de la SPP. Elle est représentante européenne au conseil d'administration de l'Association psychanalytique internationale ; et éditrice associée de l'International Journal of Psychoanalysis. Elle a dirigé l'Institut psychanalytique de Paris et coordonné le Centre de consultation et de traitement Jean Favreau. Ses thématiques de recherche sont : la transmission de la psychanalyse, le contre-transfert, le moi et le moi inconscient.
Publications
"Un transfert de base négativant, dès le début", Le contre-transfert d'hier à aujourd'hui, Débats en psychanalyse, PUF, 2024.
"Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le afin de le posséder", à paraître dans l'IJP, avril 2026.
Evelyne TYSEBAERT : L'inconscient et l'à-venir
En tant que psychanalyste, traiter de la "dimension mortelle de l'humanité" et autres "malaises", dans le contexte actuel, est délicat mais vital. Ces questions, nous les entendons, nous les vivons, nous les débattons en citoyens encore libres jusqu'à présent. Au-delà de la matière brute des bruits et fureurs du monde, ce qui nous est livré dans notre travail, ce sont les échos et résonnances du collectif dans l'individuel, dans les déclinaisons de leurs expressions, entre pulsations et convulsions. Je voudrais sonder le thème de l'inconscient transmetteur, celui des différentes figures qui l'esquissent et le signalent à notre écoute. J'aimerais aussi déchiffrer quelques paramètres propres à témoigner de la sauvegarde de la réalité humaine à travers la transmission inconsciente, dans une réalité interne/externe de destruction.
Evelyne Tysebaert est psychanalyste à Liège, anciennement membre du Quatrième Groupe. Invitée permanente à l'APF, elle est membre invitée à la Société Belge de Psychanalyse.
Publications
"Le mal, ses représentations entre corps individuel et corps du monde", J.-F. Chiantaretto & G. Gaillard (dir.), Psychanalyse et culture. L’œuvre de Nathalie Zaltzman, Colloque de Cerisy (2019), Ithaque, 2020.
"Le Je, ontologie de la vie d’âme", J.-F. Chiantaretto, A. Cohen de Lara, F. Houssier & C. Matha (dir.), Aux origines du Je. L'œuvre de Piera Aulagnier, Colloque de Cerisy (2021), Ithaque, 2022.