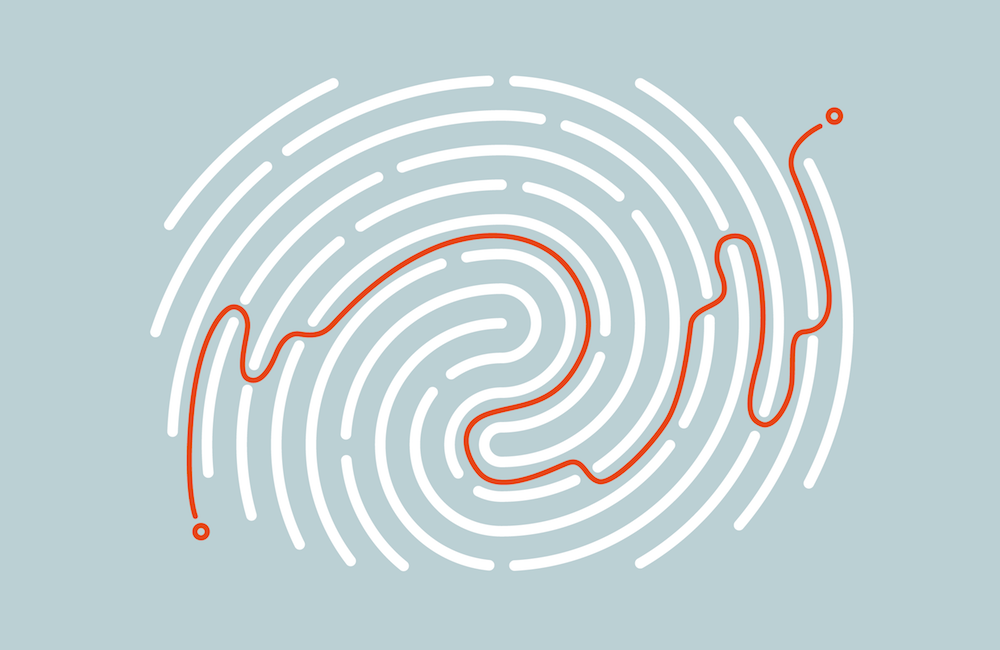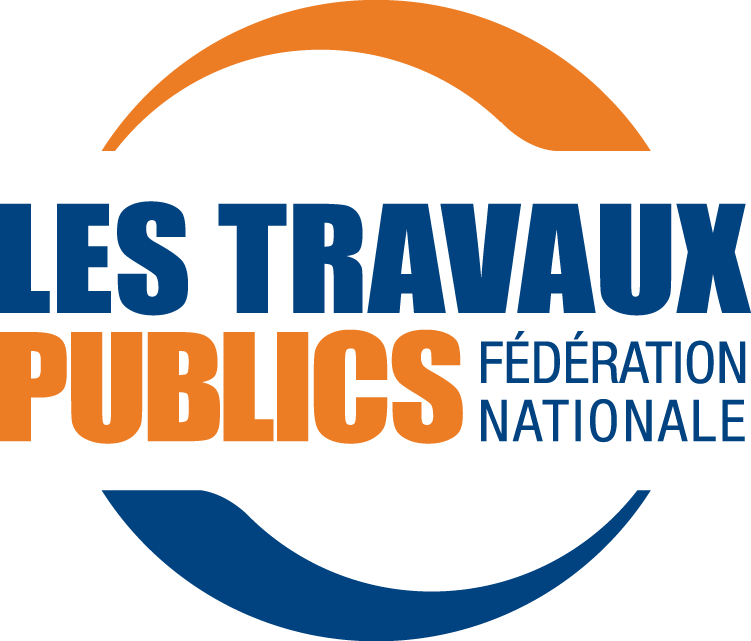COMPRENDRE LA ROUTE :
ENTRE IMAGINAIRES, SENS ET INNOVATIONS
DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE (19 H) AU JEUDI 14 SEPTEMBRE (14 H) 2023
[ colloque de 6 jours ]
PRÉSENTATION VIDÉO :
ARGUMENT :
Ce colloque abordera la route, à la fois comme vecteur de mobilité et d'échange et en tant qu'objet commun et universel. À l'heure de la transition écologique, où la mobilité doit se réinventer, quelle place garde la route ? Autrefois perçue comme un moyen éminent pour le développement des espaces, pour la promotion de la liberté des individus et comme support de l'innovation technologique, la route est aujourd'hui contestée. Souvent représentée au cinéma, en photographie ou en littérature, la route est un lieu de conflits politiques et sociaux, mais également d'empathie.
Réunissant experts, spécialistes et artistes, ce colloque tentera d'en montrer toutes les facettes, entre imaginaires, appropriations, sens et innovations. L'écrivain Aurélien Bellanger, et l'historienne médiologue Catherine Bertho-Lavenir, ont accepté d'en être les grands témoins.
CALENDRIER DÉFINITIF :
Vendredi 8 septembre
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, du colloque et des participants
Samedi 9 septembre
LA ROUTE AU CŒUR DU PATRIMOINE FRANÇAIS
Matin
Ouverture : Que nous dit la route aujourd'hui ? Pourquoi la route ?
Le XXe siècle a vu l'essor de l'automobilisme et de la route comme moyen d'échanges, puis les sociétés occidentales ont assisté au lent déclin de l'investissement collectif dans cette infrastructure aux mille nuances. Aujourd'hui, pourtant, à l'heure où la décarbonation des transports est nécessaire, la route apparaît comme un vecteur de solutions utiles et innovantes. Quelle image la route a-t-elle aujourd'hui ? Quels usages lui seront-ils réservés demain ?
Mathieu FLONNEAU & Frédéric MONLOUIS-FÉLICITÉ
Grands témoins : Aurélien BELLANGER et Catherine BERTHO-LAVENIR
La route, un territoire au présent | Animateur : Mathieu FLONNEAU
Depuis la création des Ponts et Chaussées jusqu'aux projets d'autoroute bas-carbone, la route est indissociable de l'histoire de l'aménagement du territoire français. Adossée à la notion de patrimoine, la route donne à voir des paysages, des lieux, des monuments. Elle s'inscrit donc dans la longue histoire de la technique et du changement de pratiques des hommes. L'automobilisme en demeure le vecteur de développement indissociable.
Jean-Marc OFFNER : Tenir la route ? Un impensé urbanistique contemporain [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]
Après-midi
Introduction par Dominique BOURG : Une planète en voie de rétrécissement [visioconférence]
Table ronde : Prix et valeurs de la route | Animateur : Vincent LE ROUZIC
Outil de désenclavement, axe rapide de mobilité, facilitateur d'échanges… la route et la vitesse de déplacement qu'elle permet ont un impact fort sur le développement des territoires, leurs emplois et leur intégration au reste de l'économie nationale. Pourtant, la route est aussi un espace d'inégalités, d'opposition politique et de crispations sociales. Quelles valeurs sont attribuées à la route ? Valeur économique certes, mais quelle valeur sociale, identitaire, ou territoriale, lui donner ?
Yves CROZET : La route à l'épreuve de nouvelles valeurs
Emma-Sophie MOURET : Que se passe-t-il lorsqu'une route ferme ?
Conclusion de la journée : vernissage d'une exposition des photographies de Nicolas Salvi et accrochage d'une sélection des couvertures de Roaditude
Cette exposition photographique constitue le fil rouge du colloque. En représentant la route et sa valeur patrimoniale française, elle illustre les différentes formes qu'une route peut prendre ainsi que les paysages et lieux qu'elle façonne.
Laurent PITTET [Rédacteur en chef de la revue Roaditude]
Nicolas SALVI [Photographe]
Dimanche 10 septembre
LA BATAILLE DE LA ROUTE
Matin
La route face aux défis environnementaux
Biodiversité, artificialisation des sols, pollution des milieux naturels, les raisons pour ne plus penser la route semblent nombreuses. Et la réglementation se resserre autour de l'extension du réseau routier, et son impact sur l'environnement. À l'heure où le transport et surtout l'automobile constituent une importante source d'émission de CO2, la route n'est-elle pas menacée ?
Arnaud PASSALACQUA : La route au cœur des tensions écologiques entre mobile et immobile. Faire enfin la paix après la bataille de la vitesse ? [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]
Table ronde | Animatrice : Céline ACHARIAN [Directrice générale, La Fabrique de la Cité]
Aurélien BIGO : Les transports face au défi de la transition énergétique
Patrice GEOFFRON : Peut-on imaginer une autoroute décarbonée ?
André BROTO : Le cas des déplacements du quotidien longs et le potentiel des lignes de car express
Julien GUEZ [Directeur général, Fédération nationale des travaux publics (FNTP)]
Après-midi
Table ronde : La route : un vecteur d'innovation pour les mobilités | Animateur : Pascal GRISET [Historien de l'innovation et des techniques]
Route à induction, bornes de recharges ultra-rapides, poids-lourds et caténaires, covoiturage, péage sans barrières, production d'énergie… La route de demain est un support inépuisable d'innovations. Elle est au cœur du renouvellement des usages et de l'intégration de la mobilité bas-carbone. Elle concentre un dynamisme technique et industriel de pointe. Panorama des innovations routières et technologiques en vue de la décarbonation des mobilités routères.
Jean-Pierre ORFEUIL [Spécialiste des mobilités]
Bernard JACOB : Routes du futur et électriques
Jean-Pierre PASERI [Président de Routes de France]
Angèle LE PRIGENT : Des routes à plusieurs vitesses : l'intérêt différencié des collectivités territoriales à la reprise du réseau routier national
Veillée : Les autonautes de la cosmoroute (Julio Cortázar et Carol Dunlop, 1983)
Le couple d'écrivains, Julio Cortazar et Carol Dunlop, décident en 1982 de parcourir le trajet Paris-Marseille en minibus. Dormant sur des aires d'autoroutes, ils se savent chacun menacés d'une maladie incurable. Leur journal de bord s'enrichit progressivement de photographies, dessins et rencontres. Le but ? Suspendre le temps malgré les voies rapides et faire face au danger…
Alphonse COULOT [La Fabrique de la Cité]
Lundi 11 septembre
"HORS LES MURS"
Matin
À MUNEVILLE-LE-BINGARD
Visite de la carrière Eurovia et d'un chantier de construction de route
Après-midi
AU CHÂTEAU DE TOCQUEVILLE
Déjeuner introduit par Mathieu FLONNEAU : Les routes de la prospérité : Tocqueville mobile
Table ronde : La route et la critique de l'écologie politique | Animatrice : Sabine CHARDONNET-DARMAILLACQ [Enseignante-chercheur]
La route a été au fondement de la critique des penseurs précurseurs de l'écologie politique. Ivan Illich avançait l'idée que passé un certain seuil, la production de l'industrie des transports coûte à la société plus de temps qu'elle ne lui en épargne. Dans son sillage, André Gorz a dénoncé l'idéologie sociale de la "bagnole". À l'heure où la cause écologique devient structurante dans nos sociétés contemporaines, dans quelle mesure ces représentations critiques de la route sont-elles toujours d'actualité ?
Roman SOLÉ-POMIES : Le souci des routes comme enjeu éthique
Laure RIBEIRO : La reconquête de la rue par les enfants comme renouveau de nos imaginaires et de nos pratiques
Soirée
Projection du documentaire Une route entre nous et commentaire de son réalisateur Jean-Louis ANDRÉ
Mardi 12 septembre
LA ROUTE, UN ESPACE COMMUN ?
Matin
Introduction par Marc FONTECAVE [Professeur au Collège de France, chaire de Chimie des processus biologiques] [visioconférence]
Table ronde : La route et le rond-point, des espaces politiques ? | Animateur : Sylvain ALLEMAND [Journaliste et essayiste]
Infrastructure d'appropriation d'un espace, la route est un vecteur de développement, d'attractivité et de modernisation. Cependant, elle n'est pas sans révéler de puissantes inégalités à l'œuvre dans les territoires : accès et dépendance à la voiture, enclavement de communes et effet tunnel des autoroutes, inégalité centre-périphéries et mobilités pendulaires imposées (domicile-travail), radars, ronds-points et stations-services aux prises des Gilets Jaunes… autant de situations qui placent la route au cœur des enjeux sociaux. Le rond-point est peut-être le plus fort symbole de cette politisation de la route, de son objectivation comme espace d'expression politique.
Pierre-Louis BALLOT : De la route fonctionnelle à la route devenue patrimoine : des enjeux sociaux pluriels de la route
Jean-Clément ULLÈS [Doctorant, géographie et aménagement de l'espace]
Luc GWIAZDZINSKI [Géographe]
Après-midi
Introduction par Jacques LÉVY [Géographe, professeur à l'École Polytechnique de Lausanne] : Route et justice spatiale
Table ronde : La route de ville et la route de champs | Animatrice : Marie DÉGREMONT [Directrice des études, La Fabrique de la Cité]
La route accueille une grande variété de modes de transports et dessert — voire désenclave — de nombreux territoires. Pourtant, elle peut faire désormais figure d'espace d'exclusion. Et en ville ou en espace rural, les impressions comme les réalités sont différentes. En ville, les Zones à Faibles Émissions restreignent désormais l'accès aux véhicules les plus polluants, et le calendrier prévoit d'intensifier la réglementation. La voiture n'y est déjà pas bienvenue depuis plusieurs années et de nombreux modes alternatifs existent. En revanche, les espaces peu denses ont peu de solutions de transport quotidien, et la route reste incontournable, y compris pour accéder aux métropoles. Dès lors, devons-nous craindre une nouvelle frontière entre espaces urbains et espaces ruraux ? Longtemps associée aux grands espaces, au voyage et à la liberté, quelle place peut prendre désormais la route dans cette révolution des mobilités ? Est-elle le vestige d'un monde rural sans solution alternative de mobilité ?
Étienne FAUGIER [Historien spécialiste du tourisme et de la mobilité]
Nathalie ROSEAU [Architecte et Directrice de recherche au LATTS]
Marc DESPORTES [Historien et auteur de Paysages en mouvement. Transport et perception de l'espace, XVIIIe-XXe siècles]
Mercredi 13 septembre
LES IMAGINAIRES DE LA ROUTE
Matin
"Marcel Proust, Julien Gracq et la route" | Dialogue entre Aurélien BELLANGER et Mathieu FLONNEAU
Table ronde | Animateur : Alphonse COULOT [La Fabrique de la Cité]
Stéphane NICOLAS : L'Aventure Michelin. Comment Michelin a-t-il transformé la perception du territoire ?
Charline & Marie-Émilie PORRONE : Le fil conducteur / Échappées
Georges AMAR : "En avant, route !". La prospective, l'ingénieur et les poètes
Après-midi
Introduction par Dan MARRIOTT [Fondateur de l'association internationale Preserving the historic road] [visioconférence]
Table ronde : Équipements et esthétique de la route | Animateur : Frédéric MONLOUIS-FÉLICITÉ
Et si l'objet "route" était, en lui-même, riche d'une valeur esthétique ? Ponts, tunnels, courbes et lignes à perte de vue : de nombreuses routes sont devenues mythiques, comme la route 66 et son infinie ligne droite américaine, les routes escarpées des Alpes, ou la route Napoléon, en Provence. Derrière ce tracé naturel et net se loge à chaque fois un savoir-faire technique et industriel qu'on ne soupçonne pas. L'appellation d'ouvrage d'art qui désigne une construction remarquable par sa taille ou sa technique révèle toute une esthétique routière bien souvent ignorée.
Éric ALONZO : La beauté de la route en elle-même
Julien VICK [Délégué général du Syndicat des Équipements de la Route]
Laurent PITTET : Le Beau routier en perspective
Soirée
Montrer la route
Isabelle INGOLD [Réalisatrice du documentaire Des jours et des nuits sur l'aire]
Jeudi 14 septembre
Matin
Rapports d'étonnement des doctorants à l'écoute du colloque, par Angèle LE PRIGENT, Emma-Sophie MOURET, Roman SOLÉ-POMIES et Jean-Clément ULLÈS
Conclusion du colloque par les grands témoins : Aurélien BELLANGER et Catherine BERTHO-LAVENIR
Discussion générale
Après-midi
DÉPARTS
TÉMOIGNAGES :
• Une seconde fois sur la route menant à Cerisy. Rencontre avec Marie DÉGREMONT, propos recueillis par Sylvain ALLEMAND.
PRESSE / MÉDIAS :
• Projet "Comprendre la route : entre imaginaires, sens et innovations", Compte-rendu en ligne sur le site de La Fabrique de la Cité.
• Quelle est la place de la route dans nos sociétés ?, Édition spécial du podcast Mobility Stories (1/4), avec la participation de Mathieu FLONNEAU, Aurélien BELLANGER et Catherine BERTHO-LAVENIR | Réalisation : Antoine PERRIN (journaliste/animateur, Movin'On/L'Express) | Mise en ligne : 27/09/2023.
• Va-t-on réussir à partager la route ?, Édition spécial du podcast Mobility Stories (2/4), avec la participation d'Yves CROZET, Emma-Sophie MOURET et Jacques LÉVY | Réalisation : Antoine PERRIN (journaliste/animateur, Movin'On/L'Express) | Mise en ligne : 27/09/2023.
• Sommes-nous arrivés au bout de la route ?, Édition spécial du podcast Mobility Stories, (3/4), avec la participation de Julien GUEZ, Aurélien BIGO et Dominique BOURG | Réalisation : Antoine PERRIN (journaliste/animateur, Movin'On/L'Express) | Mise en ligne : 27/09/2023.
• La route du futur, c’est comment ?, Édition spécial du podcast Mobility Stories, (4/4), avec la participation de Pierre COPPEY, Bernard JACOB et Julien VICK | Réalisation : Antoine PERRIN (journaliste/animateur, Movin'On/L'Express) | Mise en ligne : 27/09/2023.
RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
Mathieu FLONNEAU
Mathieu Flonneau est historien, agrégé et docteur en histoire, enseignant-chercheur, maître de conférences à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il dirige depuis 2017 l'Institut AES de l'École de Droit de la Sorbonne. Spécialiste d'histoire urbaine et des mobilités depuis sa thèse de doctorat sur L'automobile à la conquête de Paris. Formes urbaines, champs politique et représentations (2002), il travaille sur les questions liées à la culture et à civilisation routière dans une perspective internationale. Membre du Mobility History Group né en 1999, il comptait en 2003 parmi les membres fondateurs de l'association internationale T2M, Traffic&Transport to Mobility qu'il a présidé entre 2017 et 2020.
Bibliographie indicative
Défense et illustration d'un automobilisme républicain, Descartes&Cie, 2014.
Métropoles mobiles, Défis institutionnels et politiques de la mobilité dans les métropoles françaises, co-direction, Presses universitaires de Rennes, 2021.
En tous sens ! Circuler, partager, sécuriser. Une histoire des équipements de la route, Éditions Loubatières, 2022.
Frédéric MONLOUIS-FÉLICITÉ
Frédéric Monlouis-Félicité a débuté sa carrière en tant qu'officier, avant de rejoindre le monde de l'entreprise en 2002. Il a dirigé pendant six ans l'Institut de l'entreprise, think tank consacré aux questions économiques et sociales. Entre 2019 et 2023, il a été conseiller du président de VINCI Autoroutes, en charge de la prospective et des affaires publiques. Diplômé de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, il est ancien auditeur de l'IHEDN.
Bibliographie indicative
La Guerre des générations aura-t-elle lieu ?, Éditions Les Belles Lettres, octobre 2022.
"Les grandes entreprises et la politique étrangère française", in Notre intérêt national, Thierry de Montbrial, Thomas Gomart (dir.), Éditions Odile Jacob, janvier 2017.
Le temps de l'action, les enjeux de l'élection présidentielle 2017, Institut de l'entreprise, décembre 2016.
Les grandes entreprises en France, je t'aime moi non plus, en collaboration avec McKinsey, octobre 2015.
Éric ALONZO
Éric Alonzo est architecte, professeur à l'École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est, Université Gustave Eiffel, où il codirige le post-master d'architecte-urbaniste. Chercheur au laboratoire OCS/AUSser (UMR 3329 du CNRS), il a fondé avec Sébastien Marot la publication Marnes, documents d'architecture. Il est l'auteur de Du rond-point au giratoire (Parenthèses, 2005) et de L'Architecture de la voie. Histoire et théories (Parenthèses, 2018). Il est par ailleurs membre de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France.
Pierre-Louis BALLOT
Pierre-Louis Ballot est ingénieur de recherche à l'université de Tours, au sein de l'UMR Citeres, et chercheur associé à l'UMR Passages. Ses recherches portent, d'une part, sur les liens mobilité-territorialité, et, d'autre part, sur les processus de construction patrimoniale. Sa thèse, soutenue en 2020 à l'université Grenoble Alpes, a porté sur les constructions patrimoniales et les territorialités mobiles de la route nationale 7 (Paris-Menton). Il coordonne actuellement un ouvrage collectif intitulé Les sens de la route (à paraître à UGA Éditions), consacré à l'histoire de la route ainsi qu'à ses enjeux passés, actuels et futurs.
Dominique BOURG : Une planète en voie de rétrécissement
L'idée selon laquelle l'habitabilité de la Terre était vouée à une péjoration et à une réduction physique s'est imposée depuis une dizaine d'années au moins. Des études concernant la distribution régionale des populations humaines en fonction de la variation de la température moyenne, la meilleure compréhension d'un phénomène extrême comme la chaleur humide, ont récemment permis de préciser nos connaissances quant à l'altération et la réduction de la niche humaine. Nous rappellerons le contenu de ces connaissances qui ne nous renvoient nullement à la fin du siècle. Nous en tirerons quelques conséquences quant à l'imaginaire de la route, tout en situant ces perspectives dans un contexte plus large.
Dominique Bourg est philosophe, professeur honoraire, Université de Lausanne. Il dirige aux Puf trois collections et la revue en ligne La Pensée écologique. Appartenance à la CFDD, Commission Coppens, CNDD, Grenelle de l'environnement, etc. ; Conseils scientifiques : Ademe (2004-2006), Fondation pour la Nature et l'Homme (1998-2018 ; Paris) ; Organe de prospective de l'État de Vaud (2008-2017) ; Fondation Zoein (Genève). Domaines de recherche : aspects politiques, économiques, écologiques et métaphysiques de la durabilité, risques et principe de précaution, démocratie écologique.
Publications récentes
Nouvelle Terre, réédition Puf-Quadrige, 2022 (2018).
Le Marché contre l'humanité, Puf, 2019.
Primauté du vivant. Essai sur le pensable, Puf, 2021, avec Sophie Swaton.
Devenir du climat, livre audio de 3 CD avec Jean Jouzel et Hervé Le Treut (Climat. Une enquête de la revue La Pensée écologique, Puf, 2023).
Science et prudence. Du réductionnisme et autres erreurs par gros temps écologique, Puf, 2022, avec Nicolas Bouleau.
À paraître : Au cœur des années affreuses, sales et méchantes. Journal éco-philosophique, Puf, septembre 2023.
André BROTO
André Broto est ingénieur diplômé de l'École Polytechnique, il a passé la majeure partie de sa carrière dans les sociétés d'autoroute (Cofiroute puis Vinci Autoroutes) en tant que directeur en charge le maitrise d'ouvrage puis directeur en charge de la prospective et de la stratégie. En retraite depuis 2021, il est actuellement coordonnateur du "thème stratégique mobilité" à l'Association mondiale de la route, et membre du conseil scientifique de TDIE.
Publication
Transports, les oubliés de la République, Eyrolles, 2022.
Sabine CHARDONNET-DARMAILLACQ
Sabine Chardonnet-Darmaillacq est architecte dplg et docteure en urbanisme et dynamique des territoires, récemment retraitée de l'enseignement de l'architecture, elle est chercheure du Laboratoire ACS de l'ENSA Paris Malaquais. Elle est membre du groupe thématique MUP au sein du Labex Futurs Urbains de l'université Gustave Eiffel. Elle participe au projet interdisciplinaire "Ville Vivante" et à la Chaire "Ville Métabolisme" au sein de l'université Paris Sciences et Lettres.
Publications liées à des colloques de Cerisy
Villes et territoires résilients, Actes du colloque de Cerisy 2017 (co-direction), Hermann Éditeurs, 2020.
"La vi(ll)e à l'envers / Ville et résilience à l'ère Covid", in Villes et territoires résilients, Actes du colloque de Cerisy 2017 (co-direction), pp. 404-442, Hermann Éditeurs, 2020.
Le génie de la marche, Actes du colloque de Cerisy 2012 (co-direction), Hermann Éditeurs, 2016.
"La ville mobile au prisme de la marche", in Le génie de la marche, Actes du colloque de Cerisy 2012 (co-direction), pp. 186-207, Hermann Éditeurs, 2016.
Étienne FAUGIER
Étienne Faugier est historien, maître de conférences au département tourisme de l'université Lumière Lyon II. Il est vice-doyen de l'UFR Temps et Territoires et membre du laboratoire d'études rurales. Depuis 2022-2023, il enseigne à l'École des Ponts au sein du Master Transport et Développement durable. Ses travaux traitent des transports et des mobilités et du tourisme en France et au Canada. Il est président de l'Association Passé-Présent-Mobilité et membre de l'association Rail et histoire.
Bibliographie
""Autophobie" et anti-automobilisme : contestations motorisées dans les espaces ruraux européens (fin XIXe-1950s)", Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe (EHNE) [en ligne], mis en ligne le 08/01/23.
Avec Louis BALDASSERONI, Claire PELGRIMS (dir.), Histoire des transports et des mobilités : France, XIXe-XXe siècles, Paris, Armand Colin, 2022.
"Dépendance automobile ? Liberté automobile ? L'automobilisme dans le monde rural, XIXe-XXIe siècles", dans Yoann DEMOLI (dir.), Peut-on se passer de la voiture hors des centres urbains ?, Gif-sur-Yvette, Éditions Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay, 2021, p.19-35.
Luc GWIAZDZINSKI
Luc Gwiazdzinski est docteur en géographie, Professeur à l'ENSA Toulouse et chercheur au LRA. Ses travaux portent notamment sur les mobilités, les temporalités et les mobilisations territoriales. Il a publié une quinzaine d'ouvrages parmi lesquels : Si la route m'était contée. Un autre regard sur la route et les mobilités durables, Éditions d'organisation, 2007 et Sur la vague jaune. L'utopie d'un rond-point, Elya, 2020.
Bernard JACOB : Routes du futur et électriques
La route a fortement évolué au fil du temps. Cinq générations de routes ont été définies : (1) le chemin muletier de l'antiquité, (2) la route romaine pavée, (3) la route revêtue (asphaltée), (4) l'autoroute, et (5) la route intelligente ou dite R5G (route de 5e génération). Cette dernière est instrumentée, connectée, interactive, auto-réparatrice, voire productrice ou convective d'énergie. La décarbonation des transports routiers passe par leur électrification. Toutefois l'électricité, qui se transporte aisément, ne se stocke que difficilement. Les véhicules électriques alimentés par leurs seules batteries sont soumis à des limites fortes, de poids, de volume, de coût, d'autonomie, et la quantité de batteries à produire et recycler va se heurter à des problèmes de disponibilité des matières premières, d'énergie et de prix. La route électrique (ERS, Electric Road System) est une solution innovante et en rupture, adoptée il y a plus d'un siècle dans le monde ferroviaire et des transports guidés (tramways, métros, trolleybus), et qui présente de nombreux avantages, y compris pour la route. Trois technologies sont actuellement à l'étude et en cours d'expérimentation : (i) la conduction aérienne par caténaires, (ii) la conduction par le sol avec rail, et (iii) l'induction. Ces technologies ont chacune leurs points forts et faibles, voire leur domaine d'application. Toutes permettent une réduction de plus de 85% des émissions de carbone pour l'ensemble du cycle de vie par rapport aux carburant fossiles actuels, contre 50 à 65% pour les autres technologies (biofuels, batteries seules, hydrogène) et des coûts d'exploitation des véhicules (TCO, Total Cost of Operation) similaires à ceux d'aujourd’hui (contre des surcoûts de 40 à 200% pour les batteries seules ou l'hydrogène). Les perspectives de la route électrique, scénarios de déploiement et intérêt de chaque technologie seront présentés. En complément, une ouverture sera faite sur la route de 5e génération et ses divers aspects, et sur l'évolution des ponts, notamment les structures récentes et les ponts connectés.
Bernard Jacob, diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, a mené une carrière d'ingénieur-chercheur, au Service d'Étude Technique des Routes et Autoroutes (SETRA), au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), puis à l'Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR), et actuellement à l'université Gustave Eiffel. Il a travaillé sur le dimensionnement, la fatigue et la sécurité des ponts et de leurs charges, le pesage en marche des poids lourds et les interactions poids lourds infrastructures, sur la sécurité routière et l'exploitation de la route, et dans les dernières années sur la décarbonation du transport routier et notamment la route électrique.
Angèle LE PRIGENT
Angèle Le Prigent est doctorante en science politique au Laboratoire Arènes à l'université de Rennes. Sa thèse porte sur la trajectoire d'évolution différenciée du réseau routier national non concédé à partir d'une comparaison entre la Bretagne et l'Occitanie. Elle mène également une mission cartographique au sein de la Direction Interdépartementale des Routes Ouest, financeuse de l'action de recherche.
Jean-Marc OFFNER : Tenir la route ? Un impensé urbanistique contemporain
Comment la route et la rue ont-elles pu disparaître de la réflexion comme de la pratique des aménageurs ? Et ce alors que les réseaux viaires organisent depuis des siècles les territoires ; alors que l'inventeur de l'urbanisme, Cerdà, y voit la recherche de l'articulation entre le mouvement et la sédentarité. Les critiques à l'égard de la civilisation automobile, en partie fondées mais souvent injustes, ont invisibilisé la route comme infrastructure intermodale et la rue comme espace de circulation (pas uniquement espace public). La théorie des réseaux aide penser à nouveaux frais la route. L'infrastructure est un support pour de multiples services, dont la coordination suppose l'existence d'un opérateur de réseau, en l'occurrence une autorité organisatrice de l'exploitation des routes.
Jean-Marc Offner est président de l'École urbaine de Sciences Po. Il a dirigé l'agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine. Il a été formé à la fois à l'ingénierie urbaine et aux sciences sociales. Il s'intéresse à la planification territoriale et aux services en réseaux, à la gouvernance locale et aux relations entre expertises et décisions, à la mobilité et aux modes de vie. Il a publié Anachronismes urbains, Presses de Sciences Po, 2020.
Arnaud PASSALACQUA : La route au cœur des tensions écologiques entre mobile et immobile. Faire enfin la paix après la bataille de la vitesse ?
La route est à la fois le support permettant des déplacements variés et un objet fixe, présent matériellement dans son cadre géographique et immatériellement dans nos esprits et nos récits. Alors que les formes dominantes des déplacements qu'elle accueille sont devenues intenables du point de vue écologique, tandis que l'insertion des infrastructures dans leur environnement est une préoccupation croissante, les tensions se combinent pour remettre en cause le mobile comme l'immobile. Ce qui fait sens puisque cette dialectique entre mobile et immobile est le moteur d'une vitesse qui est à l'origine de nombre de ces problématiques. Dès lors, l'horizon possible n'est-il pas justement de repenser cette tension pour recombiner ce qu'est et ce que porte la route afin d'en faire l'un des jalons déjà présents de la construction d'un nouveau territoire, en adéquation par ses objets comme par ses imaginaires avec les limites enfin assumées du monde ?
Arnaud Passalacqua est historien, professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris (Lab'urba/LIED). Ses travaux portent sur les transports et les mobilités dans la longue durée. Ils utilisent des perspectives transversales pour proposer une compréhension des enjeux contemporains fondés sur le temps long : espace public, circulation transnationale, innovation… Il travaille également sur des questions énergétiques, en lien avec les mobilités, notamment l'enjeu du rationnement fondé sur le carbone. Il a été membre de la commission particulière du débat public chargé du débat sur les parcs éoliens en mer au large de la Nouvelle Aquitaine.
Laurent PITTET
Né en Suisse, Laurent Pittet vit et travaille sur les rives du Léman, entre Genève et Lausanne. Titulaire d'une licence en lettres modernes (Université de Genève, Bruxelles et Philadelphie) et d'un diplôme de conseiller en communication, il mène une carrière de consultant. Parallèlement, il a fondé, en 2016, une maison d'édition, Double ligne Sàrl, basée à Genève et dédiée aux thèmes de la route, du voyage et de l'itinérance. Double ligne propose une revue internationale Roaditude, culture de la route (parution deux fois l'an), ainsi que deux collections, "Figures de l'itinérance" (essais biographiques) et "Récits en route" (fictions).
Charline & Marie-Émilie PORRONE
Comédienne et metteuse en scène, Charline Porrone a cofondé la Compagnie la Piccola Familia et joué dans la plupart des spectacles mis en scène par Thomas Jolly, notamment, "Arlequin, poli par l'amour de Marivaux", TOA de Sacha Guitry, Henry VI et Richard III de W. Shakespeare. En mise en scène, elle a créé des formes théâtrales légères l'"Affaire Richard", "Cassandre", "Une nuit chez Buzzati" destinées à être jouées en tous lieux ainsi que "Les Troyennes de Sénèque". Comédienne permanente au Centre dramatique national d'Angers - Pays de la Loire, elle a récemment coécrit et mis en scène le spectacle "Échappées", un road trip théâtral qui traite des rapports de domination, de l'impulsion du partir, de la route et de l'amitié féminine.
À l'issue d'un voyage d'un an en Eurasie, Marie-Émilie Porrone entame son travail d'autrice. Il est d'abord question de voyage, puis très vite c'est la notion de mobilité qui oriente ses recherches. Des rencontres jalonnent son parcours naissant, elle se relie notamment aux travaux de Georges Amar (Ars Mobilis), puis crée la parole singulière d'une voiture pour la pièce de théâtre "Échappées" (mise en scène par Charline Porrone). Elle travaille actuellement sur un projet d'écriture poétique de la route, inspiré notamment des pensées d'Édouard Glissant et Donna Haraway.
Nathalie ROSEAU
Nathalie Roseau est professeure de l'École des Ponts ParisTech et chercheure au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Elle est architecte et ingénieure, docteure et HDR en urbanisme. Privilégiant une perspective historienne, ses recherches portent sur les dynamiques de transformation métropolitaine et la place qu'y occupent les infrastructures, leurs temporalités et leurs représentations. Sa thèse a porté sur l'influence qu'a eue l'aéronautique sur le devenir des villes, de 1909 jusqu'à nos jours (Aerocity, Quand l'avion fait la ville, Parenthèses, 2012). Son habilitation a porté sur le rôle des infrastructures dans les processus d'agrandissement métropolitain (Le futur des métropoles, Temps et infrastructure, Metispresses, 2022). Elle a co-dirigé plusieurs programmes de recherche sur l'histoire de la culture aérienne et la gouvernance des grandes métropoles. Elle est co-fondatrice et co-animatrice (avec Frédéric Pousin) du programme de recherche Inventer le Grand Paris, Histoire croisée des métropoles. Inscrits dans divers projets de recherche (européen, éditorial, interdisciplinaire), ses travaux actuels portent sur les rapports des cultures mobiles et urbaines à l'"Anthropocène".
Roman SOLÉ-POMIES : Le souci des routes comme enjeu éthique
À travers l'histoire, les routes ont été façonnées par les transformations de la mobilité ; elles ont aussi été analysées comme des matérialisations du pouvoir étatique moderne. Mais les voiries que nous empruntons chaque jour, près desquelles nous vivons, tiennent-elles toutes seules ? Leur capacité de se fondre dans le décor de notre existence ordinaire fait oublier la complexité de ces agencements techniques, à l'interface du trafic, des réseaux enterrés, des intempéries et de la végétation… or, cette complexité est au principe d'une activité particulière : la maintenance. Enjeu d'action publique par l'allocation des ressources financières, enjeu d'expertise technique par l'optimisation des politiques d'entretien, l'organisation de la maintenance suppose un souci partagé pour la fragilité des infrastructures. En étendant aux choses les apports des théories du soin, les études de maintenance suggèrent que la crise de la sensibilité au vivant que nous connaissons relèverait d’une crise plus générale de la sensibilité à la matière. Dans cette optique, un dialogue avec l'éthique environnementale pourrait se nouer autour d'une conception des routes comme patrimoine à faire durer.
Roman Solé-Pomies est en thèse de doctorat au Centre de sociologie de l'innovation (Mines Paris—PSL), après un diplôme d'ingénieur de l'École des mines de Paris et un master de l'École des hautes études en sciences sociales. Dans une approche inspirée de la sociologie et de l'anthropologie des sciences et des techniques, ses recherches portent sur la mise en problème public de la gestion patrimoniale des infrastructures routières et sur les pratiques de maintenance de la voirie dans les petites collectivités de France métropolitaine.
Jean-Clément ULLÈS
Jean-Clément Ullès est doctorant au Laboratoire de Géographie et d'Aménagement de Montpellier (LAGAM) à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Sa thèse porte sur l'adaptation de l'offre intermodale de transport du bassin de mobilité montpelliérain aux nouveaux rythmes urbains dans un contexte de forte dépendance à l'automobile.
Julien VICK
Julien Vick est diplômé de Sciences Po Strasbourg où il a obtenu un Master 2 "Carrières et Action Publiques". Après une première expérience aux États-Unis en tant que Lauréat de la Bourse Fulbright, il débute sa carrière au Sétra (aujourd'hui Cerema) en tant que directeur adjoint du Bureau de Normalisation des Transports, Routes et Aménagements. Il est depuis 10 ans Délégué général du Syndicat des Équipements de la Route (SER), Administrateur de l'Ascquer et de l'Idrrim.
BIBLIOGRAPHIE :
• Amar Georges, Ars Mobilis repenser la mobilité comme un art, FYP Éditions, 2014.
• Aubenas Florence, Gilets jaunes : la révolte des ronds-points, Le Monde, article publié le 15/12/2018.
• Alonzo Éric, Du rond-point au giratoire, Parenthèses éditions, 2005.
• Alonzo Éric, L'architecture de la voie. Histoire et théories, Parenthèses éditions, 2018.
• Begout Bruce, L'obsolescence des ruines, Éditions Incultes, 2022.
• Bellanger Aurélien, Grand Paris, Gallimard, 2017.
• Bertho-Lavenir Catherine, La Roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes, O. Jacob, 1999.
• Bourg Dominique, Kaufmann Alain, Méda Dominique, L’âge de la transition. En route pour la reconversion écologique, Colloque de Cerisy, Éditions Les petits matins / Institut Veblen, 2016.
• Broto André, Transports, les oubliés de la République, Eyrolles, 2022.
• Cassély Jean-Laurent, Fourquet Jérôme, La France sous nos yeux. Économie, paysages, nouveaux modes de vie, Seuil, 2021.
• Cortazar Julio, Dunlop Carol, Les Autonautes de la cosmoroute, Gallimard, 1983.
• Crawford Matthew, Why we drive : toward a philosophy of the Open Road (Prendre la route : une philosophie de la conduite), William Morrow, 2020.
• Crozet Yves, Économie de la vitesse : Ivan Illich Revisité, Scop-Alternatives Économiques, 2017.
• Debray Régis et alii, Les Cahiers de médiologie, Qu'est-ce qu’une route ?, Gallimard, 1996.
• Desjardins Xavier, Urbanisme et mobilité : de nouvelles pistes pour l'action, Éditions de la Sorbonne, 2017.
• Desportes Marc, Paysages en mouvement, Gallimard, 2005.
• Faugier Étienne, Les mobilités automobiles, XIXe-XXIe siècles : les usagers sont-ils encore au volant ?, Éditions Mare & Martin, 2020.
• Faugier Étienne et alii, Histoire des transports et des mobilités en France, Armand Colin, 2022.
• Flonneau Mathieu, En tous sens : circuler, partager, sécuriser. Une histoire des équipements de la route, Loubatières Éditions, 2022.
• Flonneau Mathieu, Les cultures du volant. Essai sur les mondes de l'automobilisme, Autrement, 2008.
• Flonneau, Mathieu, avec Faugier Étienne, "Les mobilités urbaines et rurales ; complémentarités, divergences, ignorance, XIXe-XXIe sicèles" (p. 163-177) et postface, "La mobilité en histoire : portée d'un nouveau paradigme" (p. 219-222), in Histoire des transports et des mobilités en France, Armand Colin, 2022.
• Gwiazdzinski Luc, Sur la vague jaune : l'utopie d'un rond-point, Elya Éditions, 2019.
• Kerouac Jack, Sur la route, Gallimard, 1957.
• Marriott Dan, From Milestones to Mile-markers : understanding Historic roads, National Trust for Historic Preservation, 2004.
• Marriott Dan, Saving Historic Roads : Design and Policy Guidelines, John Wiley and Sons, 1998.
• Offner Jean-Marc, Anachronisme urbains, Presses de SciencesPo, 2020.
• Orfeuil Jean-Pierre, Transports collectifs : après quatre décennies prodigieuses, inventer un nouvel avenir, Tous Urbains, 2015.
• Passalacqua Arnaud, La bataille de la route, Descartes et Cie, 2010.
• Picon Antoine, L'art de l'ingénieur : constructeur, entrepreneur, inventeur, Éditions du Centre Pompidou, 1999.
• Picon Antoine et alii, De l'espace au territoire. L'aménagement en France, Revue d'Histoire Vingtième Siècle 3 (n°59), 1998.
• Picon Antoine, Smart cities : théories et critique d'un idéal auto-réalisateur, Éditions B2, 2013.
• Proust Marcel, Impressions de route en automobile, Le Figaro, 1907.
• Roseau Nathalie, Le futur des métropoles, Temps et infrastructure, Metispresses, 2022.
• Rapetti Rodolphe, Vitesse, RMN éditions, 2021.
• Scapino Julie et alii, Dictionnaire pluriel de la marche en ville, L'œil d'or, 2021.
• Thoret Jean-Baptiste, Road-movie, USA, Hoëbeke éditions, 2011.
• Zeller Thomas, Consuming Landscape, what we see when we drive and why it matters, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2022.
SOUTIENS :
• La Fabrique de la Cité
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Association Passé-Présent-Mobilité (P2M)
• Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe (Sirice) - CNRS UMR 8138
• Syndicat Des Équipements de la Route (SER)
• Union Routière de France (URF)
• Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
• Routes de France