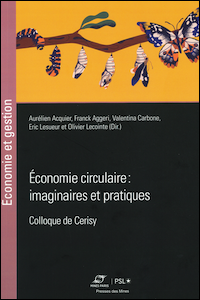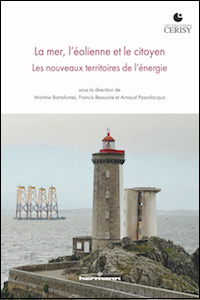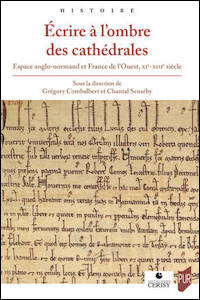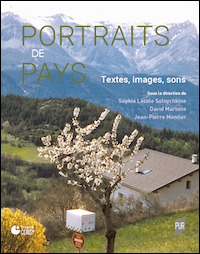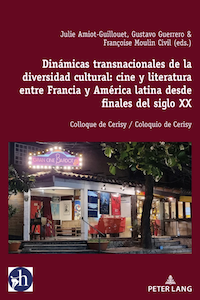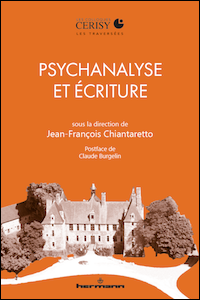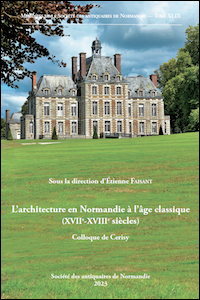"RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AAPC"
RENCONTRE AVEC LUCILE SCHMID
Le Conseil d'administration de l'Association des Amis de Pontigny-Cerisy (AAPC) vient d'accueillir en son sein une nouvelle administratrice en la personne de Lucile Schmid. Ses adhérents ont pu la découvrir à l'occasion de la dernière assemblée générale qui s'est tenue en avril. Le 13 mai, elle participait au séminaire du Conseil administration qui se tenait au Centre culturel international de Cerisy. Dans l'entretien qui suit, elle nous en dit plus sur son parcours et ses rapports à ce dernier qu'elle avait déjà eu plusieurs occasions de fréquenter.
Vous avez rejoint le conseil d'administration de l'AAPC. Quelle a été votre réaction lorsque la proposition vous en avez été faite ?
Lucile Schmid : Avant même de songer au CA, j'y ai vu instantanément la perspective de pouvoir me rendre régulièrement dans ce lieu merveilleux qu'est le château de Cerisy-la-Salle, un lieu qui me saisit à chaque fois par sa proximité avec la nature — celle du parc arboré et du paysage alentour —, par sa relation au temps et à l'espace — une relation qui change du tout au tout avec celle qu'on peut avoir dans la vie ordinaire. En rejoignant le CA de l'AAPC, j'ai le sentiment d'exaucer encore un peu plus ce rêve de vivre dans un lieu comme celui-ci !
Un mot sur ce conseil d'administration dont vous avez pu avoir un premier aperçu — nous réalisons cet entretien à l'occasion de son premier séminaire annuel, qui se tient à Cerisy même. Un CA dont le fonctionnement tranche avec les autres CA en ceci que les administrateurs sont invités à prendre une part active jusque dans la programmation des colloques…
Lucile Schmid : Non seulement ils prennent part, mais ils s'engagent à un titre personnel : dans leur prise de parole, ils n'hésitent pas à mêler des considérations opérationnelles, intellectuelles et intimes. Ils sont tout sauf en représentation, parlent selon leurs convictions. Or que rêver de mieux que de pouvoir échanger avec des personnes dont l'engagement est en adéquation avec ce qu'elles sont fondamentalement ? Les discussions n'en sont que plus intéressantes et stimulantes. On sent que tous ont pour préoccupation d'agir concrètement. Si, donc, je devais retenir quelque chose de ce séminaire du CA, ce serait cela : ce double souci de l'engagement personnel et concret dans l'intérêt manifeste de Cerisy.
Un mot maintenant sur les colloques dont vous avez aussi l'expérience ?
Lucile Schmid : À ce jour, j'ai effectivement participé comme intervenante ou auditrice à quatre colloques, à chaque fois sur des thématiques différentes : Le PSU, des idées pour un socialisme du XXIe siècle (du 14 au 16 mai 2011) ; Quelles trajectoires vers la sobriété ? (du 27 septembre au 1er octobre 2023) ; L'Europe : héritages, défis et perspectives (du 19 au 27 août 2023) ; enfin, Comprendre la route : entre imaginaires, sens et innovations (du 8 au 14 septembre 2023). Avec le recul, je constate que les moments que je préfère sont ceux où le colloque vire à la conversation, à la fois profonde, argumentée et libre, sans l'obsession du débouché opérationnel immédiat, mais dans le souci de ce que pensée et action soient le plus intimement liées possible. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui nous vivons, je le crains, un moment de déconnexion entre l'une, la pensée, et l'autre, l'action : on pense beaucoup, mais sans agir et on agit sans prendre le temps de penser, encore moins collectivement. C'est dire mon intérêt pour Cerisy où j'entrevoie la possibilité, et même le désir, d'articuler les deux.
Ce qui, me semble-t-il, passe par un travail sur le sens des mots, non pas nécessairement pour parvenir à une définition commune, mais prendre la mesure, à travers des échanges formels ou informels, de la diversité des significations qu'ils peuvent revêtir, dans le temps, selon les disciplines, les professions, etc. À se demander d'ailleurs si l'intérêt d'un colloque de Cerisy ne réside pas d'abord en cela : au fait d'offrir l'opportunité aux participants de confronter les sens multiples que peut revêtir un mot, un concept, et dissiper par là même les risques de malentendus… Est-ce quelque chose à laquelle vous avez été sensible ?
Lucile Schmid : Oui, tout à fait. D'ailleurs je me souviens de discussions contradictoires que j'ai eues avec Edith [Heurgon] sur la notion de résilience que, personnellement, je trouve trop abstraite, employée à mauvais escient, là où elle y voit au contraire une notion clé. Au final, nos échanges m'ont été utiles. Tout en étant encore réticente à faire mienne cette notion de résilience, je la considère avec plus d'attention. C'est bien la preuve qu'un mot gagne, dans l'usage qu'on en fait, à être re-contextualisé et non jeté en pâture dans les débats, sans qu'on sache vraiment le sens qu'on y met. Tout l'intérêt d'un colloque de Cerisy, de par sa durée (plusieurs jours), est de prendre le temps de s'arrêter, de mieux réfléchir au sens des mots qu'on utilise et ce faisant au projet qu'on porte.
Il est alors intéressant de constater comment des mots s'imposent au fil du colloque ou persistent tandis que d'autres sont abandonnés en cours de route… Puisque nous avons évoqué l'importance des mots, la nécessité de s'accorder sur leurs significations, je ne résiste pas à l'envie de citer Albert Camus : "Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde…". Justement, à Cerisy, on prend le temps, collectivement, de bien nommer ce dont on parle…
Lucile Schmid : Étant entendu que notre pensée va souvent plus vite que les mots ; que ceux dont on dispose ne sont pas toujours pertinents. Faut-il y renoncer pour autant ? C'est la question dont justement nous débattions au cours du séminaire à propos du mot "transition", auxquels certains recommandent de renoncer. Sauf qu'on n'en dispose pas de meilleurs pour le moment… Personnellement, je ne recommanderais donc pas d'y renoncer trop vite, a fortiori pour traiter des enjeux écologique, énergétique, climatique.
En disant cela, je ne renonce pas à pousser la réflexion sur les mots qu'on utilise. Sans doute nous faut-il aussi forger d'autres concepts. En ce sens-là, je me retrouve dans la citation de Camus, qui nous invite à un devoir d'imagination jusqu'à et y compris au plan sémantique.
Le moment que nous vivons — la crise à la fois climatique, écologique, énergétique… — est propice à cela : nous percevons bien qu'il nous faut inventer quelque chose de nouveau et que nous cherchons les mots pour le dire. S'il est un lieu pour le faire, en associant ces mots à l'action — j'insiste sur ce point — c'est bien Cerisy.
Quand on se penche sur votre parcours, force est de constater un fort engagement politique qui vous a conduite à vous porter candidate à des élections et à vous faire élire (vous avez été notamment conseillère régionale de la Région Île-de-France). Quelle signification donnez-vous à cet autre engagement au sein de Cerisy au titre d'administratrice ? Quel lien feriez-vous avec le premier ?
Lucile Schmid : Effectivement, je me suis engagée politiquement et cet engagement remonte à un moment précis : la guerre civile algérienne des années 1990 — ce qu'on a appelé la "décennie noire". J'ai pris conscience à ce moment-là que l'engagement politique était une question de vie ou de mort, non pas pour moi, qui n'ait aucune origine algérienne, mais pour mes amis algériens. Ma perception du rôle de l'État et des fonctionnaires et du politique en général s'en est trouvée totalement transformée au point de m'amener à m'engager en politique — je me suis présentée à plusieurs élections et ai parfois été élue. Pour autant, je n'ai jamais considéré que c'était le plus important : la candidate et l'élue que j'ai pu être n'étaient que des avatars. Le plus important est la poursuite de cette quête de ce qui pourra donner un sens concret au mandat électif, aux rapports entre les représentants — les élus — et les représentés — les électeurs. Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire : on peut être un élu de terrain et porter des idées — une véritable obsession chez moi. Y suis-je parvenue ? Je n'en suis pas sûre (sourire). Ce constat d'échec apparent ne m'a pas pour autant découragée, fait renoncer à la politique. Je continue à porter des enjeux politiques, mais autrement qu'au travers d'un engagement au sein d'un parti politique ou de mandats électifs. Avec le recul, je pense en réalité m'être égarée en optant justement pour la compétition électorale. Non que je regrette de m'être présentée à des élections. Cela reste une expérience formidable, mais j'ai maintenant la conviction que ce ne doit pas être la seule option de l'engagement politique. Je crois même pouvoir dire que mon engagement actuel, éloigné des partis politiques, revêt une dimension plus éminemment politique puisqu'il m'a amenée à porter la réflexion autour de ce que peut être notre avenir commun, au-delà de l'extrême présentisme qui peut caractériser le temps d'une élection.
Une conviction que j'ai pu exposée dans un livre coécrit avec Catherine Larrère et Olivier Fressard, L'écologie est politique, publié en 2023 [éditions Les petits matins]. À l'époque, le simple fait de poser la question — l'écologie est-elle politique ? — n'allait pas de soi. De fait, les ONG qui œuvrent dans le champ écologique sont censées être apolitiques — c'est une obligation qui doit figurer clairement dans leurs statuts pour pouvoir prétendre à des subventions politiques. On peut le concevoir. D'un autre côté, cela dessert la vision du politique, qui semble ainsi être quelque chose d'impur, de malsain. Heureusement, les mentalités ont évolué. Dans la dizaine d'années qui s'est écoulée, on perçoit tous mieux que la politique ne se résume pas à la quête du pouvoir comme semble le dire le comportement des partis, que la politique, c'est bien autre chose ; elle est l'affaire de tous les citoyens ; nous avons tous une responsabilité politique et, donc, notre mot à dire sur les enjeux de société, y compris écologiques.
Je ne résiste pas à l'envie de revenir à l'Algérie que vous avez évoquée car le hasard veut qu'Edith Heurgon nous reçoive ici en revenant d'un voyage qui l'a amenée à faire escale à Alger… Une synchronicité dans laquelle je ne peux m'empêcher de voir une illustration de la capacité de Cerisy à révéler entre ceux qui le fréquentent, des affinités d'une tout autre nature que ce que pourraient suggérer leurs identités institutionnelles ou professionnelles. Cela fait-il sens pour vous ?
Lucile Schmid : Oui, bien sûr ! D'autant plus que j'ai la conviction que le lien à l'Algérie renvoie à des questions universelles. Malheureusement, on n'a jamais su, en France, pas plus qu'en Algérie, prendre la mesure de cette réalité. On continue à en parler comme deux entités distinctes — "la" France et l'Algérie, comme si des liens étroits n'avaient pas été tissés entre les deux pays. La société française est bien évidemment irriguée par la société algérienne ne serait-ce que par nos histoires entremêlées, la présence sur notre territoire de générations d'immigrés ou de Français d'origine algérienne par leur père et/ou par leur mère.
Mais cette irrigation peut prendre des formes plus subtiles encore : pour ma part, je me suis aperçue, lors de mon premier séjour en Algérie, que je comprenais d'autant mieux les relations entre nos deux pays, que j'avais vécu toute mon enfance en Nouvelle Calédonie. Un territoire qu'on présente encore comme une composante de la France, alors que, de toute évidence, c'est une île située à des milliers de kms de là, dans l'hémisphère sud, peuplée aussi de Kanak. Sans compter une biodiversité qui n'a rien à voir avec celle de la "métropole". Une expérience qui m'a confortée dans l'idée que l'on mesure d'autant mieux la portée universelle des questions qui se posent, qu'on perçoit des affinités entre des lieux qui paraissent de prime abord les plus étrangers les uns aux autres. Ce que nous enseigne d'ailleurs L'Étranger de Camus — on y revient là encore ! Paradoxalement, loin de nous séparer, l'étrangeté, parce qu'universelle, nous rapproche…
Donc, oui, j'adore cette idée de retrouver Edith dans le Cotentin, et de découvrir que c'est l'Algérie qui nous lie, même si encore une fois, je ne suis pas originaire de ce pays, à la différence d'elle, qui y est née.
Propos recueillis par Sylvain ALLEMAND
Secrétaire général de l'AAPC