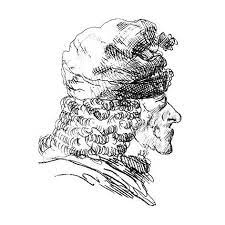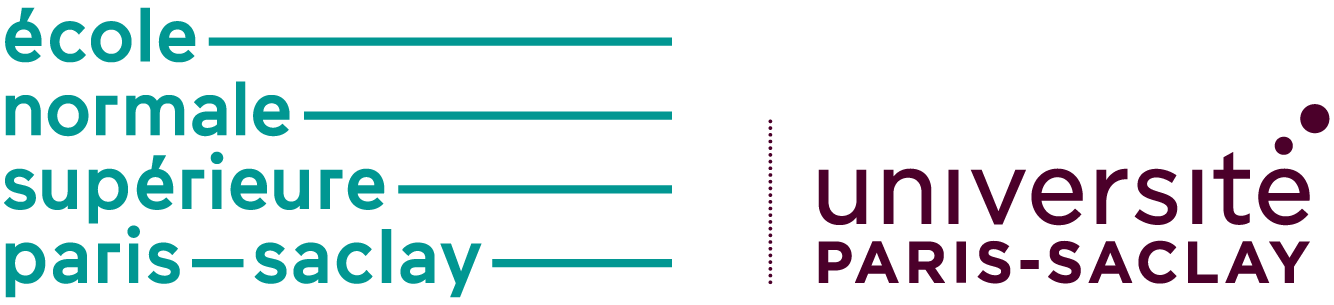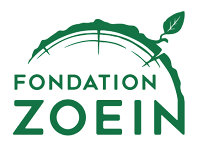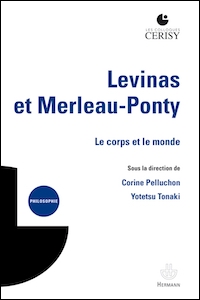SILVIA BARON SUPERVIELLE : LE PAYS DE L'ÉCRITURE
DU JEUDI 27 JUIN (19 H) AU MERCREDI 3 JUILLET (14 H) 2024
[ colloque de 6 jours ]
DIRECTION :
René de CECCATTY, Axel GASQUET, Stavroula KATSIKI, Marc SAGAERT, Martine SAGAERT
En présence de Silvia BARON SUPERVIELLE
ARGUMENT :
Née à Buenos Aires, de mère uruguayenne d'ascendance espagnole, disparue alors qu'elle avait deux ans, et de père argentin d'origine béarnaise, Silvia Baron Supervielle a été élevée par sa grand-mère paternelle, qui privilégiait la langue française. En Argentine, elle avait publié des nouvelles et des poèmes en espagnol. Depuis 1961, elle vit et travaille à Paris. Pour l'étrangère des deux rives, l'exilée en quête d'une "écriture absolue", la passagère "du vide et du vent", écrire, c'est traduire. Auteure à ce jour d'une trentaine d'ouvrages personnels en français (poèmes, romans, récits, essais) et d'autant de traductions (vers le français, notamment Jorge Luis Borges et Julio Cortázar, et vers l'espagnol, Marguerite Yourcenar), elle a aussi autotraduit ses poèmes. Ces expériences multiples du traduire, qui incluent les lectures de textes et de toiles (la peinture est pour elle un art majeur) non comme entreprise d'élucidation mais comme aventure du dire, donc du sujet, la conduisent à interroger la langue, mot énigmatique qui définit aussi bien l'univers spécifique de l'auteure, émanant "de son regard, de sa manière, de son pas", que le secret qu'il abrite.
Ce colloque invite à découvrir un Pays de l'écriture, aux composantes rioplatenses et à l'envergure universelle, à explorer une œuvre transnationale, transgénérique et transindividuelle, une œuvre poétique aux "attaches flottantes", une œuvre reconnaissable à ses accords essentiels, ses résonnances intérieures, ses harmoniques, une œuvre, qui, de manière unique, sait "écarter, rompre, déraciner les habitudes", questionner les évidences, une œuvre authentique, dont la générosité et la liberté font écho en nous.
MOTS-CLÉS :
Argentine / Uruguay / France, Baron Supervielle (Silvia), Bibliothèque, Décolonialisme, Écriture, Espace, Corps, Entre-deux langues, Exil, Hybridité générique, Intime, Langue, Lecture, Nostalgie, Plurilinguisme, Temps, Traduction
CALENDRIER PROVISOIRE (19/03/2024) :
Jeudi 27 juin
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, des colloques et des participants
Vendredi 28 juin
Matin
René de CECCATTY, Axel GASQUET, Stavroula KATSIKI, Marc SAGAERT & Martine SAGAERT : Introduction
Martine SAGAERT : Bibliothèque particulière, dictionnaire personnel et fulgurance d'une œuvre
José GARCÍA-ROMEU : Origine, langue et écriture dans Lettres à des photographies
Après-midi
Alice PANTEL : Écrivains nomades et écriture plurilingue dans la littérature hispanique contemporaine
Sato SONOKO : La présence d'un autre dans la poésie de Silvia Baron Supervielle
Éditer l'œuvre de Silvia Baron Supervielle, table ronde avec Silvia BARON SUPERVIELLE, René de CECCATTY et Gérard PFISTER
Soirée
En commun avec le colloque en parallèle Faut-il brûler Voltaire ?
Film sur Silvia Baron Supervielle, en présence du réalisateur Mario Daniel VILLAGRA
Samedi 29 juin
Matin
Michel COLLOT : Silvia Baron Supervielle à la frontière
Lise GAUVIN : Écrire au bord des langues : les voyages inachevés de Silvia Baron Supervielle
Après-midi
Claudine SAGAERT : Les écritures de la nostalgie
Anne-Marie FORTIER : Pliage et dépliage du temps dans la poésie de Silvia Baron Supervielle
Soirée
En commun avec le colloque en parallèle Faut-il brûler Voltaire ?
Cabaret littéraire, textes : Silvia BARON SUPERVIELLE, direction artistique : Marc SAGAERT, flûte : José LAZARO ÁLVAREZ PIZZORNO
Dimanche 30 juin
Matin
Axel GASQUET : Le creuset de l'écriture entre-deux langues : Silvia Baron Supervielle, l'exil de l'intime comme territoire littéraire
Marc André BROUILLETTE : Écrire en perspective
Après-midi
André-Alain MORELLO : Silvia Baron Supervielle, une autobiographie poétique
Jean-Philippe ROSSIGNOL : La peinture, la poésie : Silvia Baron Supervielle, Geneviève Asse et Marguerite Yourcenar
Soirée
En commun avec le colloque en parallèle Faut-il brûler Voltaire ?
Œdipe de Voltaire, lecture-spectacle mise en scène par Jean-Claude SEGUIN, par le Théâtre du Loup Blanc, avec Marie GRUDZINSKI (Jocaste), Vincent DOMENACH (Œdipe) et Antoine HERBEZ (Philoctète) | Présentation
Lundi 1er juillet
Matin
Stavroula KATSIKI : "Ma langue dans son chant" : Silvia Baron Supervielle, traductrice d'autres voix
Maria Alejandra ORIAS VARGAS : Silvia Baron Supervielle : une langue de l'abstraction
Après-midi
DÉTENTE
Mardi 2 juillet
Matin
Aline BERGÉ : Un timbre décolonial, à la croisée des cultures
René de CECCATTY : Silvia Baron Supervielle, lectrice de soi et des autres
Après-midi
Marc SAGAERT : Les intermittences du corps
Alain MASCAROU : Approches du sublime à travers Le Livre du Retour
Francisco ALVEZ FRANCESE : Sur la désorientation : langue et paysage chez Silvia Baron Supervielle et Jules Supervielle
Soirée
En commun avec le colloque en parallèle Faut-il brûler Voltaire ?
Si j'osais mon petit cœur, pièce de Yoland SIMON présentée par la Compagnie Aello (Cherbourg-en-Cotentin), mise en scène de Michel Beurton et Véronique Lucas, avec Alain BENOIST, Serge RITTER et Nathalie TROCHU, suivie d'une lecture d'extraits des Incertitudes de Sophie et de N'en déplaise à Voltaire par les participants du colloque
Mercredi 3 juillet
Matin
Peter SCHULMAN : Pages de voyage, voyages de pages : périples au fond de soi dans la poésie de Silvia Baron Supervielle
Traduction et autotraduction, table ronde avec Silvia BARON SUPERVIELLE, René de CECCATTY et Jesús David CURBELO (Se traduire et traduire)
Après-midi
DÉPARTS
RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
René de CECCATTY : Silvia Baron Supervielle, lectrice de soi et des autres
Silvia Baron Supervielle accorde autant d'importance à la traduction des poètes du Rio de la Plata qu'à sa propre œuvre qui est un dialogue constant non seulement avec ceux qu'elle traduit, mais avec ses amis (Hector Bianciotti, Marguerite Yourcenar, Jacqueline Risset) et même avec des écrivains argentins ou européens (Dante). Sans compter sa relecture des Psaumes de la Bible (Nouvelles cantates). Elle réinvente la critique sous la forme d'une lecture intérieure.
René de Ceccatty est écrivain, traducteur, critique et éditeur. Il est l'auteur de nombreux romans, essais et biographies. Ami de Silvia Baron Supervielle depuis trente ans, il a écrit plusieurs comptes-rendus critiques de son œuvre, a participé au colloque de Toulon et a édité aux éditions du Seuil les livres suivants de son amie : La ligne et l'ombre, La rive orientale, Le pays de l'écriture, La forme intermédiaire, Une simple possibilité, La langue de là-bas, ainsi qu'aux éditions Points, ses poèmes, En marge qu'il a préfacés.
Axel GASQUET
Axel Gasquet est professeur au département d'Études Hispaniques et Hispano-Américaines de l'université Clermont Auvergne et directeur de l'IHRIM Clermont (UMR 5317 - CNRS). Ses recherches portent sur la littérature comparée et l'histoire culturelle argentine, le multilinguisme littéraire et l'orientalisme hispano-américain, ainsi que sur la littérature hispano-philippine. Il est responsable de six éditions critiques et coéditeur de onze ouvrages scientifiques collectifs. Il est aussi l'auteur de douze ouvrages monographiques, dont Hispanoamérica, Filipinas y las culturas de Asia. Estampas de un orientalismo periférico 1875-1950 (UNAM, 2023) ; Argentinean Literary Orientalism, from Esteban Echeverría to Roberto Arlt (Palgrave Macmillan, 2020) ; El llamado de Oriente, historia cultural del orientalismo argentino 1900-1950 (Eudeba, 2015) et L'Intelligentsia du bout du monde : les écrivains argentins à Paris (Kimé, 2002 ; tr. Esp. UNL, 2007, 2020).
Stavroula KATSIKI : "Ma langue dans son chant" : Silvia Baron Supervielle, traductrice d'autres voix
La traversée littéraire de Silvia Baron Supervielle se place sous le signe du double. Elle se partage, et se rassemble, entre deux pays, deux exils, deux langues, deux manières d'aborder l'énigme du langage — en le créant et en le pensant —, deux activités, écriture et traduction. Si l'écrivaine-traductrice envisage ces deux expériences comme similaires, mues par la même passion de rendre un souffle au silence, de murmurer la cadence d'une âme, la sienne ou une autre, dans une langue presque étrangère, c'est sa traduction d'autres voix que la sienne qu'il s'agira d'observer ici pour esquisser les contours de cette géographie amoureuse, où la traduction est une affection, mais aussi une question. Pourquoi certains écrivains traduisent et d'autres pas ? "La traduction est un mystère", nous confie Silvia Baron Supervielle et nous entraîne dans son désir de deux langues, qui est en réalité celui de toutes les langues, dans un espace sans frontières, où le voyage n'est pas une destination mais une destinée.
Stavroula Katsiki est maîtresse de conférences en sciences du langage à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre de TransCrit et chercheuse associée à l'ITEM. Spécialiste de pragmatique contrastive et d'analyse du discours, elle mène des recherches sur le plurilinguisme littéraire et la traduction, notamment sur l'œuvre de l'écrivaine-traductrice Silvia Baron Supervielle (cf. Katsiki S., "Silvia Baron Supervielle en traduction : "l'amour ouvert"", in Martine Sagaert et André-Alain Morello (dir.), Silvia Baron Supervielle ou le voyage d'écrire, Paris, Honoré Champion, 2022, p. 145-165).
Marc SAGAERT : Les intermittences du corps
À partir de textes fictionnels de Silvia Baron Supervielle et notamment de La Forme intermédiaire (2006), du Pont international (2011) et de La Douceur du miel (2015), nous traiterons de l'importance des sens dans l'œuvre, des résonnances du corps et de ses intermittences : union et désunion, présence et absence, rêve et réalité. Écriture.
Marc Sagaert a occupé différents postes diplomatiques et culturels en France et à l'étranger (Algérie, Espagne, Colombie, Mexique, Amérique centrale, Cuba) en tant qu'attaché culturel, directeur d'établissement et délégué général régional. Il a écrit plus de 200 articles dans des revues culturelles. Il a collaboré à des livres documentaires, notamment sur Miguel Ángel Asturias et Roberto Cortázar et a dirigé des numéros spéciaux des Lettres Françaises en français et en espagnol. Il est le traducteur en espagnol de Jean Ristat et en français d'Antón Arrufat. Son ouvrage Bailarín – Danseur est publié aux éditions Helvetius (2023). Il a écrit de nombreux articles sur Silvia Baron Supervielle, participé au colloque "Silvia Baron Supervielle ou le voyage d'écrire" et organisé des rencontres sur son œuvre (Cuba, 2019, 2023).
Martine SAGAERT : Bibliothèque particulière, dictionnaire personnel et fulgurance d'une œuvre
Dans les ouvrages de Silvia Baron Supervielle, il est question de bibliothèques. En rayon ou tenus en main, les livres sont des intermédiaires. L'essentiel est ailleurs, invisible, caché, au fond et par delà. Les livres sont magiques. Mais il est une magie supérieure à laquelle seule l'auteure, poète et prophète, peut accèder, de sa manière unique, tant que les visions dureront, tant que le stylo courra sur le papier. Toujours, l'écriture plutôt que l'écrit. À la clé du Pays de l'écriture, il est deux phrases remarquables : "J'écris uniquement pour elle" et "J'écris pour que cela ait lieu" et en point d'orgue : "J'écris pour faire durer ta voix qui est venue à la mienne". Nous explorerons l'œuvre de Silvia Baron Supervielle et en abyme son dictionnaire personnel. Et nous examinerons les réponses multiples qu'elle donne à ces questions complexes : "Pourquoi / Pour quoi / écrivez-vous ?", "Pour qui écrivez-vous ?". Une façon, peut-être, d'approcher le mystère de cette œuvre fulgurante.
Martine Sagaert est professeure émérite de littérature française des XXe et XXIe siècles à l'université de Toulon. Elle a publié des ouvrages sur André Gide, dont certains en collaboration avec Peter Schnyder, et édité plusieurs de ses œuvres dont le Journal (1926-1950) ("Bibliothèque de la Pléiade", 1997, rééd. 2022). Par ailleurs, elle a préfacé l'Œuvre romanesque de Christiane Rochefort (Grasset, 2004) et dirigé Manuscrits littéraires du XXe siècle (Presses universitaires de Bordeaux, 2005). Elle a écrit avec Yvonne Knibiehler, Les Mots des mères, du XVIIe siècle à nos jours (Laffont, "Bouquins", 2016). Elle a codirigé Médecine et écritures / Medicina y escrituras (Babel, "Transverses", 2019). Avec André-Alain Morello, elle a organisé le colloque international Silvia Baron Supervielle ou le voyage d'écrire (Champion, 2022). Elle a publié Victoria Ocampo et André Gide, préfacé par Silvia Baron Supervielle (Classiques Garnier, 2023).
Francisco ALVEZ FRANCESE : Sur la désorientation : langue et paysage chez Silvia Baron Supervielle et Jules Supervielle
L'idée de la désorientation, que l'on trouve nommée dans L'Alphabet de feu (2007), est très productive pour penser à Silvia Baron Supervielle, née à Buenos Aires et émigrée à Paris en 1961, où elle a écrit toute son œuvre en français. Jules Supervielle — né à Montevideo et invisible dans son écriture, mais présent comme un fantôme à partir du nom de famille — a créé pour sa part une littérature dans laquelle la langue est mise en place comme problème à partir précisément de son refoulement. Cette communication se propose d'étudier comment le problème de la langue affecte les œuvres de ces deux écrivains dans lesquels les paysages d'ici et de là-bas, de dedans et dehors, ont la même capacité de se confondre.
Francisco Alvez Francese (Montevideo, 1992). Diplômé en littérature de l'université de la République (Uruguay), il a une maîtrise en philosophie de l'université Paris VIII, où il poursuit actuellement un doctorat en études hispaniques et latino-américaines. Sa thèse porte sur les figures d'auteur de Jules Supervielle et Felisberto Hernández et, surtout, sur leur position décentrée par rapport aux traditions littéraires de ces pays.
Aline BERGÉ : Un timbre décolonial, à la croisée des cultures
Un retour inédit sur l'histoire coloniale des Amériques et sur la généalogie familiale, une attention à de nouveaux gestes d'émancipation, à une présence et à un legs inca, maya ou ranquel, un désir de justice et de liberté : c'est bien un timbre décolonial singulier que Silvia Baron Supervielle fait entendre dans La Langue de là-bas (2023). Comment s'élabore-t-il au fil des pages ? Quelle en est la texture, la fréquence et la résonance dans ce livre, et à quelles variations se prête-t-il dans les écrits en prose antérieurs de l'auteure, dans sa voix et sa manière de jouer de son "instrument", de L'Or de l'incertitude (1990) au Regard inconnu (2020), époque où la question décoloniale retentit en Amérique latine ? Quels seraient les lieux, les modalités d'émergence et les modulations de ce timbre décolonial inouï dans les partitions de l'œuvre au long cours ? C'est à en interroger la genèse et les accents, mais aussi les éclipses et le contrepoint, le devenir et la portée, en affinité avec d'autres voix, que notre propos s'attachera, dans la déclinaison ouverte d'autres acceptions du timbre.
Maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle (UMR 7172 THALIM), Aline Bergé mène des recherches en littératures et humanités environnementales. Elle a publié "Sens de l'espace et polygraphie des auteurs migrants : François Cheng et Silvia Baron Supervielle", dans Francographies. Identité et altérité dans les espaces francophones européens, S. Bainbrigge, J. Charnley et C. Verdier (dir.), New York, Peter Lang, 2010 ; "L'arbre du souffle. Enquête sur les figures de la terre chez Silvia Baron Supervielle", dans A. Morello et M. Sagaert (dir.), Silvia Baron Supervielle ou le voyage d'écrire, Paris, Champion, "Babeliana", 2022. Elle a également animé des rencontres avec Silvia Baron Supervielle en mars 2016 et en mars 2019 (Films Productions Sorbonne Nouvelle).
Marc André BROUILLETTE : Écrire en perspective
L'œuvre de Silvia Baron Supervielle se déploie sans cesse dans un rapport sensible à l'espace, par l'intermédiaire duquel le sujet explore patiemment le territoire mobile de l'écriture. L'écrivaine fait notamment appel à un réseau complexe de découpes afin de reconfigurer le caractère évanescent, insaisissable, fuyant de l'existence. De cette dynamique, l'écriture cherche des lignes de force vitales qui puissent permettre de relier entre elles des expériences aussi déterminantes que l'enfance, la langue, l'exil et l'art. La communication portera sur les principaux motifs issus de l'expérience de l'espace et cherchera à montrer en quoi l'écriture repose sur un désir de remettre constamment le sujet en perspective, c'est-à-dire de réunir dans un champ de perception sensible des éléments épars (images mentales, souvenirs, etc.) ou de nature diverse (détermination de soi, rapport aux autres, transcendance, etc.) afin d'en mieux saisir la réalité à la fois sensible et existentielle.
Marc André Brouillette est professeur titulaire au Département d'études littéraires de l'université du Québec à Montréal, où il enseigne la création littéraire. Ses travaux portent sur la poésie contemporaine, mais aussi sur les croisements entre les arts visuels, les arts vivants, l'art public et la littérature. Poète, il a collaboré à des livres d'artistes et publié plusieurs recueils de poésie dont le plus récent, La langue de ta langue (Noroît, 2021), tisse un dialogue avec l'univers de quatre poètes argentins (Juarroz, Calveyra, Baron Supervielle, Borges).
Michel COLLOT : Silvia Baron Supervielle à la frontière
La récurrence du motif de la frontière dans l'œuvre de Silvia Baron Supervielle est liée aux séparations qui ont marqué son existence, mais son travail d'écriture tend, à travers ses divers avatars (seuils, lisières, rivages, horizons…), à en inverser le sens et la fonction. Loin d'être mise au service d'un partage rigoureux, elle est rendue poreuse, devient un lieu d'échange, voire de mélange, entre le proche et le lointain, le ciel et la terre mais aussi le passé et le présent, le réel et l'imaginaire. Cette métamorphose mobilise une logique inclusive et non exclusive, qui anime la syntaxe des phrases, l'organisation des images et la conduite de récits qu'on peut qualifier de poétiques, car le jeu des ressemblances et de la répétition y prévaut sur la mise en place des différences et la recherche d'une progression : les personnages, au lieu de franchir la frontière pour aller d'un point à un autre, semblent le plus souvent s'y tenir ou y revenir. C'est particulièrement net dans le récit intitulé La Frontière, sur lequel se concentrera l'étude.
Michel Collot est professeur émérite de Littérature française à l'université Sorbonne nouvelle Paris 3. Spécialiste de la poésie moderne, il lui a consacré de nombreux essais, dont Le Chant du monde dans la poésie française contemporaine (Corti, 2019). Lecteur de Silvia Baron Supervielle depuis 1983, il lui a consacré un chapitre de son essai Vers une géographie littéraire (2014). Poète, il a publié plusieurs recueils, parmi lesquels Le Parti pris des lieux (La Lettre volée, 2018) et Épitaphes Épiphanies (Tarabuste, 2022). L'Académie française lui a décerné en 2019 un Grand Prix pour l'ensemble de son œuvre critique et poétique.
Jesús David CURBELO : Se traduire et traduire
Mon objectif est de comparer la pensée et la praxis d'écriture de Silvia Baron Supervielle avec celles d'autres auteurs "migrants" qui ont choisi le français comme langue littéraire (José María de Heredia, Jules Laforgue, Jules Supervielle, Samuel Becket, Emil Cioran, Velibor Colic). Cette analyse me permettra d'exposer quelques hypothèses sur ses sources, ses influences et son positionnement esthétique et linguistique par rapport aux deux traditions littéraires fondamentales qui la nourrissent : la française et l'espagnole et de présenter certaines de ses découvertes personnelles. D'autre part, à partir de ma propre expérience de traducteur, je propose de dialoguer avec l'auteure et de confronter les idées sur la traduction exposées dans ses œuvres aux miennes.
Jesús David Curbelo (Camagüey, Cuba, 1965) est écrivain et professeur d'université. Il a publié plusieurs recueils de poèmes, trois romans, plusieurs recueils de nouvelles et d'essais. Il a traduit notamment Dante Alighieri, Louise Labé, Joachim du Bellay, William Blake, Victor Hugo, Edgar Lee Masters, Guillaume Apollinaire, Jean Genet et Yves Bonnefoy.
Anne-Marie FORTIER : Pliage et dépliage du temps dans la poésie de Silvia Baron Supervielle
Ce qui retient, dans les Pages de voyage (2004), appartiendrait au renversement, à la permutation des attentes du lecteur et, par conséquent au travail singulier du temps dans les poèmes. Car, nous semble-t-il, ce qui ailleurs apparaît dans une quasi-immobilité, voire en surimpression — deux époques, deux pays, deux rives — se trouverait ici déplié, séquencé, défait en des moments dont on aperçoit la tension, le parcours, le fil et le dénouement : le temps progresse, s'embraye puis se désembraye, s'emballe et cherche un prolongement (60). Le mouvement n'a cependant rien d'inaugural (Il y a longtemps que je pars, 23). Aussi faut-il selon nous examiner la nature paradoxale des événements présentés comme les actions d'un récit (je me rapproche, 10 ; je marche, 61) : convoqués au présent, ils offrent l'épaisseur de ce qui se confond avec le souvenir vivide dans le temps même où ils paraissent donner au passage la fermeté de son marquage. À terme — et l'hypothèse resterait à vérifier à l'échelle de l'œuvre — la poésie dans ce recueil semble redéployer le mouvement du temps alors que le récit aurait tendance à le donner dans une oscillation imperceptible comme pour l'annuler — le temps, ses effets, les séparations qu'il matérialise et l'amplitude de la subjectivité dont il est la trame.
Anne-Marie Fortier est Professeur de littérature française des XIXe et XXe siècles à l'université Laval (Québec, Canada) et Directrice de la revue Études littéraires.
José GARCÍA-ROMEU : Origine, langue et écriture dans Lettres à des photographies
Lettres à des photographies (2013) de Silvia Baron Supervielle exploite les notions de portrait, de mémoire, de genre épistolaire… afin de reconstituer le souvenir de la mère disparue et de représenter une vaste généalogie familiale. Si l'exercice suppose une élaboration esthétique concertée, celle-ci résulte surtout, presque par nécessité, d'un processus guidé par les émotions, l'expression de la fierté des origines et l'amour envers la mère. Dans cette perspective, le choix du français par l'écrivaine, langue non-maternelle, mérite, pour le moins, d'être interrogé. Ayant travaillé à la traduction en espagnol de Lettres à des photographies, nous proposons de mettre à profit notre réception du texte dans ce contexte particulier et d'en lire la trame verbale à la lumière de la question des origines (Mère - Uruguay - Argentine) et de leur restitution à travers le jeu des langues (français - espagnol).
Né en 1966 à Buenos Aires, José García-Romeu enseigne depuis 2002 à l'université de Toulon. Il codirige la revue Babel-Littératures plurielles dont il a coédité plusieurs numéros. Il a publié de nombreux articles sur les littératures hispanophones, ainsi que les ouvrages Dictature et littérature en Argentine (2006), Cortázar, Rayuela, Queremos tanto a Glenda (2018), Mundos imaginarios en la literatura argentina (2022).
Lise GAUVIN : Écrire au bord des langues : les voyages inachevés de Silvia Baron Supervielle
Née à Buenos-Aires, Silvia Baron Supervielle passe son enfance en Argentine avant de s'installer définitivement à Paris. Son parcours passe très tôt par la fréquentation de langues autres que celle de la communication immédiate. "Jeunes enfants d'un immense espace jusqu'à l'horizon, lorsqu'on se rendait chez des amis, on découvrait la seconde langue qu'ils parlaient chez eux avec leurs parents. En vérité, nous avions tous une seconde langue, qui, liée à nos proches, nous communiquait la nostalgie d'une autre partie du monde, d'une géographie et d'une langue abandonnées". Cette conscience de la langue comme étrangeté ne cesse de l'habiter et alimente chez elle une réflexion sur le rapport entre langue et écriture dont elle rend compte dans le récit autobiographique publié en 2023, La langue de là-bas. C'est cette réflexion et ce parcours que je propose d'examiner.
Essayiste, critique et romancière, Lise Gauvin est professeure émérite de l'université de Montréal. Elle a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels La Fabrique de la langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme (Seuil, "Points", 2004 et 2011). Pour son engagement envers la langue et dans la francophonie, l'Académie française lui a remis en 2020 la Grande Médaille de la francophonie. Elle a fait paraître récemment un roman sous le titre Et toi, comment vas-tu ? (Montréal, Leméac, 2021 ; Paris, Éditions des femmes, 2022) ainsi qu'un essai portant sur les littératures francophones sous le titre Des littératures de l'intranquillité (Karthala, 2023).
Alain MASCAROU : Approches du sublime à travers Le Livre du Retour
Cette communication s'insère dans la section "Hybridités génériques" du projet, à l'intersection des rapports roman/réel, mythe/mystique, lecture/écriture — autant de déclinaisons de la "forme intermédiaire", ici envisagée dans ses rapports avec l'idée de sublime, et définie par l'auteur comme une écriture qui "s'inspire de sa reprise et de son inachèvement". Notre étude est centrée sur Le Livre du Retour, paru en 1993. Il constitue à plus d'un titre un hapax dans l'œuvre ; encore s'inscrit-il dans une lignée idéaliste de la littérature argentine, celle qui se réclame d'une "esthétique de l'évasion". Du "dessaisissement" sublime, on retiendra ici trois aspects : l'accointance avec le roman, l'expression de l'intériorité et la relation du sujet à l'objet au travers de l'expérience artistique et de sa transmission. Or ces aspects sont indissociables : la requête d'un "livre oublié" est le thème d'un quête intérieure à laquelle elle se substitue.
Alain Mascarou a publié divers articles et communications sur l'œuvre de Silvia Baron Supervielle. Dernière contribution et bibliographie détaillée dans Silvia Baron Supervielle ou le Voyage d'écrire, Honoré Champion, 2022.
André-Alain MORELLO : Silvia Baron Supervielle, une autobiographie poétique
Silvia Baron Supervielle ne sépare pas la poésie et la prose. Pour elle, tout est poésie. Si ses poèmes sont souvent caractérisés par une forte dimension lyrique, ses livres de prose contiennent aussi une part d'autobiographie. Cette étude se propose d'interroger cette part d'autobiographie, présente dans une série de livres inclassables comme Journal d'une saison sans mémoire, Le Pays de l'écriture, La Langue de là-bas. Autobiographie poétique, au sens de créatrice, de construction d'une identité sans frontières, toujours dans une perspective humaniste, qui célèbre la fidélité et l'amour. Entre "journal de bord" et poésie de l'intime, cette part autobiographique de l'œuvre est au cœur d'un partage, et promesse d'universalité. Ce que Silvia Baron Supervielle dit d'elle-même, de l'exil, du deuil, de la mémoire, nous concerne tous.
André-Alain Morello est normalien, agrégé, maître de conférences en littérature française à l'université de Toulon, et chargé d'enseignement en littérature comparée à l'université de Picardie Jules Verne. Ses recherches portent sur les écritures romanesques du XXe siècle (Jean Giono, Marguerite Yourcenar, Julien Green, Julien Gracq). Il s'intéresse aussi aux écrivains au carrefour des cultures (Roger Caillois, Milan Kundera, Vassilis Alexakis) et aux différentes modalités de l'écriture de soi (journal de Jean Giono, journal et autobiographie de Julien Green, lettres de Marguerite Yourcenar). Il a notamment collaboré à l'édition du Journal et des essais de Jean Giono dans la Bibliothèque de la Pléiade, et à celle de Marcel Proust chez Robert Laffont. Il a aussi dirigé une quinzaine d'ouvrages collectifs consacrés à des écrivains du XXe siècle (Jean Claude Renard, Marguerite Yourcenar, Roger Caillois, Henry de Montherlant, Jean Giono, Julien Green).
Maria Alejandra ORIAS VARGAS : Silvia Baron Supervielle : une langue de l'abstraction
"Les signes conjuguent le mot et le dessin"(1), déclare Silvia Baron Supervielle pour signaler l'importance qu'a la peinture dans son œuvre littéraire. En s'inspirant de l'œuvre abstraite de l'artiste-peintre Geneviève Asse, Silvia Baron Supervielle s'est servie de la langue pour créer des espaces sur le blanc de la page. Loin de se soumettre au mythe et au génie de la langue française, elle la "conceptualise" pour créer une langue transparente et habitée par le silence. Nous proposons d'analyser comment l'auteure fait du français une langue de l'abstraction. Dans un premier temps, nous verrons que le geste de l'écriture est comparable à celui de l'artiste et de son pinceau. Une démarche semblable à celle de Henri Michaux qui trouvait que ce geste élémentaire permet de se débarrasser de la lourdeur des mots et de faire naître le silence(2). Ensuite, nous analyserons la page blanche qui favorise la forme brève du poème et qui crée un effet d'aération(3). Le blanc de la page nourrit le besoin d'ascèse, un vœu d'effacement(4) auquel Silvia Baron Supervielle accorde une vocation spirituelle. Enfin, nous verrons que l'écrivaine transfigure le français pour qu'il devienne "la langue de là-bas", celle qui n'a ni pays ni alphabet ni passé historique.
(1) Silvia Baron Supervielle, La Langue de là-bas, Paris, Éditions du Seuil, 2023, p. 52.
(2) Being Huang, "Henri Michaux et l'aventure du geste", Littérature, nº175, 2014, p. 114 (en ligne).
(3) Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980, texte annoté par Nathalie Léger et Éric Marty, avant-propos de Bernard Comment, Paris, Éditions du Seuil, 2015, p. 85.
(4) Yves Peyré, Peinture et poésie. Le dialogue par le livre 1874-2000, Paris, Gallimard, 2001, p. 207.
Maria Alejandra Orias Vargas a obtenu son doctorat en littérature française en février 2024. Le titre de sa thèse s'intitule "La littérature migrante hispano-américaine d'expression française depuis les années 1960", préparée dans l'unité de recherche Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC), Université Paris-Saclay, UVSQ, sous la direction de Serge Linarès et la co-direction de Sylvie Bouffartigue. Ses recherches portent sur la représentation de la culture et de la langue française en Amérique hispanique, l'analyse de l'étude de la littérature migrante (récits migrants autobiographiques et fictifs), l'étude de la langue française en tant qu'outil imaginaire dans l'écriture migrante ainsi que sur les enjeux liés à la multiculturalité, l'hybridation culturelle et la transculturation.
Alice PANTEL : Écrivains nomades et écriture plurilingue dans la littérature hispanique contemporaine
Qu'est-ce qu'un écrivain nomade ? Quel est l'impact de la condition translingue sur la pratique littéraire ? Comment lit-on un texte plurilingue ? S'agit-il d'une tradition littéraire liée à l'histoire de l'Amérique Latine ou plutôt la conséquence d'une plus grande mobilité des êtres et des productions culturelles ? Fernando Ainsa propose la notion de nomadisme pour qualifier les écrivains latinos-américains dont la production littéraire est résolument cosmopolite et profondément marquée par le voyage ou l'exil. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, ou plus récemment Roberto Bolaño, Andrés Neuman ou Samantha Schweblin sont autant de grands noms de la littérature hispanique nomade. Le parcours personnel et littéraire de Silvia Baron Supervielle, dans son indéniable singularité et sa grande richesse nous permettra d'interroger ces notions à partir d'un cadre théorique récent et d'un corpus d'œuvres littéraires translingues.
Alice Pantel, professeure agrégée et docteure en littérature contemporaine espagnole (section 14), est maître de conférences au département d'études hispaniques de la Faculté des Langues de l'université Jean Moulin-Lyon 3 depuis 2013. Membre de l'équipe de Recherche MARGE, Alice Pantel participe actuellement au projet ANR Lifranum qui vise à valoriser la littérature numérique notamment via une cartographie du web littéraire. Auteure d'une vingtaine d'articles publiés dans des revues spécialisées en France, en Espagne et en Suisse, ses principaux domaines de recherche portent sur l'hybridité dans la production romanesque espagnole la plus récente. En parallèle, Alice Pantel travaille à un projet qui cherche à explorer la question du nomadisme et du plurilinguisme dans la littérature hispanique contemporaine.
Jean-Philippe ROSSIGNOL : La peinture, la poésie : Silvia Baron Supervielle, Geneviève Asse et Marguerite Yourcenar
Silvia Baron Supervielle entretient une relation forte à la peinture et à la poésie. Son compagnonnage avec Geneviève Asse et son amitié avec Marguerite Yourcenar se reflètent dans plusieurs livres, dont Un été avec Geneviève Asse (L'Échoppe, 1996) et Une reconstitution passionnelle, correspondance 1980-1987 (Gallimard, 2009). En observant des motifs a priori éloignés (le bleu et l'abstraction picturale face à la poésie de langue française traduite vers l'espagnol), motifs qui s'entremêlent plus qu'ils ne s’opposent, je propose de suivre des trajectoires croisées et de nous approcher de l'alphabet du feu de Silvia Baron Supervielle.
Écrivain et traducteur, Jean-Philippe Rossignol a publié Vie électrique et Juan Fortuna. Il traduit en français l'œuvre de la poétesse afro-allemande May Ayim. Auteur d'un article sur Silvia Baron Supervielle dans Les Lettres françaises, il est critique de littérature étrangère pour Le Monde diplomatique.
Claudine SAGAERT : Les écritures de la nostalgie
"Le nostalgique est en même temps ici et là-bas, ni ici, ni là-bas, présent et absent, deux fois présent et deux fois absent, on peut donc dire à volonté qu'il est multiprésent ou qu'il est nulle part : ici même il est physiquement présent mais il se sent absent en esprit de ce lieu ou il est présent par le corps ; là-bas, à l'inverse, il se sent moralement présent mais il est en fait et actuellement absent de ces lieux chers qu'il a autre fois quittés."
Vladimir Jankélévitch, L'Irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, coll. "Champs essais", p. 346.
Silvia Baron Supervielle écrit "j'ai attrapé l'exil". Dans nombre de ses textes, le mal dont il est question est tout entier contenu dans la séparation entre ici et là-bas. Existe-t-il un remède pour ce type de mal ? Certes, il est possible de retourner là-bas. Mais comment expliquer que le retour est un impossible revenir ? Pour le comprendre ne suffit-il pas d'entrevoir la non concordance entre la réversibilité de l'espace et l'irréversibilité du temps ? N'est-ce pas d'ailleurs au cœur même de cet écueil que la nostalgie trouve demeure ? Déterritorialisant, l'exil reterritorialise et permet par-delà pensées, sentiments, émotions, la migration vers l’ailleurs. Paradoxalement alors, la distance rend possible une incomparable proximité. Par la réminiscence, l'ailleurs natal est là tout près, dans les sons, les images, les photos, les mélodies. Il est visage des aimés, mots, poèmes, pages des livres. En floutant le présent, il inscrit l'empreinte d'un passé qui "n'a pas d'oubli". La présence naît dans l'absence et par l'écriture, l'irréversibilité du temps et la réversibilité de l'espace, sont abolies. "Le voyage de retour" est possible sans "bouger d'ici". Ainsi se lie "le visible et l'invisible, l'absence à la présence, la mémoire à l'oubli" et "la langue de là-bas" "s'écrit ici".
Claudine Sagaert enseigne la philosophie en D.N.M.A.D.E. (diplôme des métiers d'art et du design). Ses recherches au sein du Laboratoire Babel de l'université de Toulon portent sur les représentations du corps dans une approche pluridisciplinaire : philosophie, esthétique et anthropologie. Elle est l'autrice de nombreux articles et ouvrages.
Peter SCHULMAN : Pages de voyage, voyages de pages : périples au fond de soi dans la poésie de Silvia Baron Supervielle
La poésie de Silvia Baron Supervielle décrit souvent des voyages (Pages de voyage ; Lectures du vent ; Sur le vent). Voyages élémentaires de feu, d'eau et de vent. Voyages abstraits de mots et d'absence de mots, d'abîmes et de transports. Des questions et un manque de réponse, comme à la fin de Lectures du vent : "où aller pour/ que le mot occupe/ le silence" (p. 99). Certes, les thèmes du voyage et l'idée d'être entre deux pays ponctuent la prose de Silvia Baron Supervielle, mais ses livres de poésie mettent en avant surtout des voyages métaphysiques de l'extérieur vers l'intérieur, des trajets cathartiques qui cherchent un abri ("sortir d'ici/afin que/le temps dehors/trouve asile/dedans") (p. 33), dans Sur le fleuve et une attente ("peu à peu/ la mer guérira") (p. 121). Ses vers décrivent des transformations, voire des métamorphoses plutôt que des trajets géographiques : "je suis devenue une matière/ différente qui me respire/ de tant refaire l'exercice/ à la découverte de la parole" (Pages de voyage, p. 48). Semblable aux recueils de Céline Zins, qui est aussi traductrice, et qui, dans L'Arbre et la glycine, tente de "voir le vide comme une plénitude" (p. 89) et "la lumière" comme "le verbe d'un lieu disparu" (p. 86), les périples de Silvia Baron Supervielle représentent des voyages spirituels qui vont au-delà du concret, et font partie d'un univers hors du temps : "lorsque viendra mon tour", explique-t-elle, "je serai déjà partie/ sans m'en aller" (Pages de voyage, p. 70). Quel compas nous permettrait de naviguer et suivre ses explorations ? Par un "alphabet de feu" dont le lecteur se servirait non pour traduire ou interpréter les mots de l'écrivaine, mais pour l'accompagner à travers plusieurs dimensions de sens comme s'il s’agissait d'un palimpseste poétique.
Peter Schulman est professeur de français et d'affaires internationales à Old Dominion University à Norfolk (Virginie, États-Unis). Il est l'auteur de The Sunday of Fiction : The Modern Eccentric (Purdue University Press) et de Le dernier livre du siècle (Romillat) avec Mischa Zabotin. Il a rédigé une édition critique de The Begum's Millions (Wesleyan University) de Jules Verne et a récemment traduit, Impressions d'été de Ying Chen, Pages de Voyage de Silvia Baron Supervielle, Les derniers coureurs de Virginie Beauregard D., Précisions sur les vagues de Marie Darrieussecq, Beauté suburbaine de Jacques Réda et Adamah de Céline Zins, et The Secret of Wilhelm Storitz (Le secret de Wilhelm Storitz) de Jules Verne. Il est actuellement co-rédacteur-en-chef d'une revue d'éco-critique, Green Humanities : A Journal of Ecological Thought in Literature, Philosophy and the Arts. Il a publié en 2023 une anthologie de poésies de Calcutta et de Montréal avec Somrita Urny Ganguly, Nights at the Calcutta Café.
Sato SONOKO : La présence d'un autre dans la poésie de Silvia Baron Supervielle
Silvia Baron Supervielle affirme que la création poétique est elle-même une traduction de sa voix intérieure. C'est un autre qui représente la poétesse sur les papiers. C'est ainsi qu'elle essaie d'interpréter, d'imiter et de traduire sa voix silencieuse. Cette présentation montrera comment cet autre se présente dans ses poèmes, en analysant principalement son recueil poétique En marge (2020), pour l'objectif d'attester que la présence d'un autre fera de la poétesse une lectrice de ses propres poèmes et réalisera une écoute de la voix intérieure à la fois personnelle et universelle.
Publication
"Lire Silvia Baron Supervielle", Association pour des Études de la Poésie Française Contemporaine au Japon, Paris/Tokyo, 2021 | En ligne.
BIBLIOGRAPHIE :
PUBLICATIONS DE SILVIA BARON SUPERVIELLE
Choix de publications en français
• Lectures du vent, José Corti, 1988.
• L'Or de l'incertitude, José Corti, 1990.
• Le Livre du retour, José Corti, 1993.
• La Frontière, José Corti, 1995.
• La Ligne et l'ombre, Le Seuil, 1999.
• La Rive orientale, Le Seuil, 2001.
• Le Pays de l'écriture, Le Seuil, 2002.
• Une Simple Possibilité : nouvelles, Le Seuil, 2004.
• Pages de voyage, Éditions Arfuyen, 2004.
• La Forme intermédiaire, Le Seuil, 2006.
• L'Alphabet du feu : petites études sur la langue, Gallimard, 2007.
• Journal d'une saison sans mémoire, Gallimard, "Arcades", 2009.
• Le Pont international, Gallimard, 2011.
• Lettres à des photographies, Gallimard, 2013.
• Sur le fleuve, Éditions Arfuyen, 2013.
• Notes sur Thème, Galilée, 2014 (avec neuf pointes sèches de Geneviève Asse).
• La Douceur du miel, Gallimard, 2015.
• Chant d'amour et de séparation, Gallimard, 2017.
• Un autre loin, Gallimard, 2018.
• En marge, Préface de René de Ceccatty, Seuil, "Points", 2020.
• Le Regard inconnu, Gallimard, 2020.
• La Langue de là-bas, Seuil, 2023.
Œuvre écrite en espagnol
• El cambio de lengua para un escritor, Buenos Aires, Corregidor, 1998.
Édition Bilingue
• Al Margen / En marge (1962-2010), Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2013, Introduction et édition Eduardo Berti, Trad. Silvia Baron Supervielle, Eduardo Berti, Axel Gasquet, Vivian Lofiego & Diego Vecchio.
Correspondance
• Une reconstitution passionnelle, correspondance avec Marguerite Yourcenar, Gallimard, 2009.
Choix de traductions vers le français
• Jorge Luis Borges, Les Conjurés, Genève, Jacques Quentin Éditeur, 1989, Huile sur papier de Geneviève Asse.
• Juan Rodolfo Wilcock, Les Jours heureux, Paris, La Différence, "Orphée", 1994.
• Macedonio Fernández, Cahiers de tout et de rien, Trad. SBS & Marianne Millon, José Corti, 1996.
• Silvina Ocampo, Poèmes d'amour désespéré, José Corti, 1997.
• Roberto Juarroz, Quatorzième poésie verticale, José Corti, 1997.
• Arnaldo Calveyra, Le Livre du miroir, Arles, Actes Sud, 2000.
• Alejandra Pizarnik, Œuvre poétique, Trad. SBS & Claude Couffon, Actes Sud, 2005.
• Julio Cortázar, Crépuscule d'automne, José Corti, 2010.
• Jorge Luis Borges, Poèmes d'amour, Avant-propos Maria Kodama, Gallimard, 2014.
• Ida Vitale, Ni plus ni moins, Trad. SBS & François Maspero, Le Seuil, "La Librairie du XXIe siècle", 2016.
• Jorge Luis Borges, Le Tango : quatre conférences, Gallimard, "Arcades", 2018.
Traduction vers l'espagnol
• Marguerite Yourcenar, Teatro I et II, Barcelona, Lumen, 1986.
Choix de préfaces
• Alejandra Pizarnik, Journaux 1959-1971, Édition établie et présentée par SBS, Trad. Anne Picard, José Corti, 2010.
• Victoria Ocampo, En témoignage, Trad. Anne Picard, Éditions des Femmes, 2012.
• Victoria Ocampo, Le Vert Paradis et autres écrits, Paris, Vendémiaire, 2023.
• Victoria Ocampo et André Gide, Édition Martine Sagaert, Trad. Marianne Millon, Paris, Classiques Garnier, "Bibliothèque gidienne", 2023.
PUBLICATIONS SUR SILVIA BARON SUPERVIELLE
• René de CECCATTY, Mes Argentins de Paris, Paris, Séguier, 2014.
• Julie CORSIN, Lenguas e identidad en la obra ectópica y translingüe de Silvia Baron Supervielle, Thèse, Université de Castille-La Manche, 2023.
• Axel GASQUET, L'Intelligentsia du bout du monde, les écrivains argentins à Paris, Paris, Kimé, 2002.
• Alejandra ORIAS VARGAS, La Littérature migrante hispano-américaine d'expression française depuis les années 60, Thèse dirigée par Serge Linares & Sylvie Bouffartigue, Université Saint-Quentin-en-Yvelines, 2023.
• Jacqueline MICHEL (avec Ruth AMAR, Jeannine HOROWITZ & Annette SHAHAR), Une écriture en exil, Éditions Caractères, "Cahiers et cahiers", 2012.
• Martine SAGAERT & André-Alain MORELLO (dir.), Silvia Baron Supervielle ou le voyage d'écrire, Champion, "Babeliana", 2022.
SOUTIENS :
• Institut des Amériques
• Laboratoire BABEL (EA 2649) | Université de Toulon
• UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines | Université de Toulon
• Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités (IHRIM - UMR 5317) | CNRS / Université Clermont Auvergne (UCA)
• Unité de recherche "Transferts Critiques anglophones" (TransCrit) | Université Paris 8
BULLETIN D'INSCRIPTION
Les inscriptions à ce colloque sont maintenant ouvertes. Au regard de notre capacité d'accueil, celles-ci pourront être mises sur une liste d'attente.
Avant de remplir ce bulletin, consulter la page Inscription de notre site.
Tous les champs marqués d'un (*) doivent être renseignés.