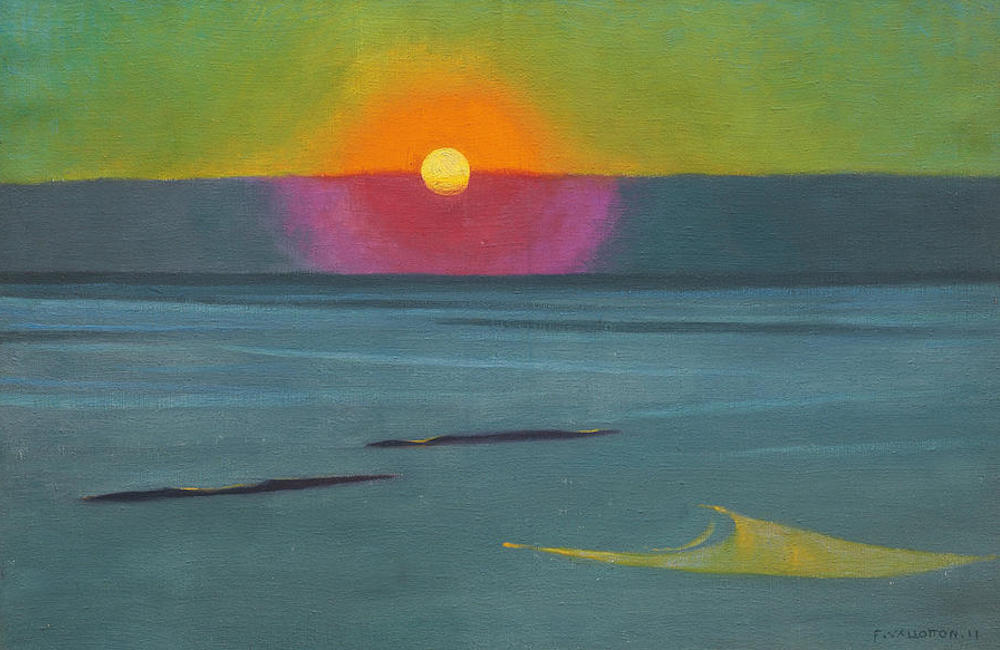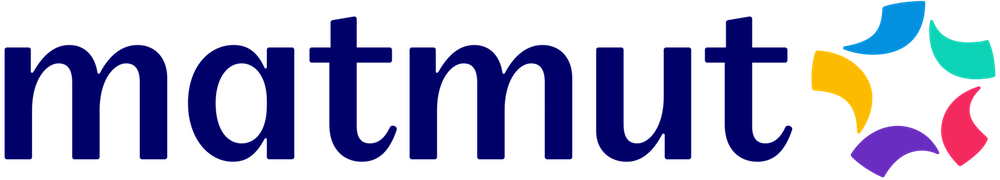L'EUROPE : HÉRITAGES, DÉFIS ET PERSPECTIVES
DU SAMEDI 19 AOÛT (19 H) AU DIMANCHE 27 AOÛT (14 H) 2023
[ colloque de 8 jours ]
DIRECTION :
Wolfgang ASHOLT [Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne], Corine PELLUCHON [Université Gustave Eiffel]
ARGUMENT :
Le destin de l'Europe se confond avec celui des Lumières et avec un message philosophique qui fait de la liberté de penser la clef de l'émancipation et peut concerner les autres continents. Sa revitalisation suppose cependant qu'elle soit capable à la fois de faire son autocritique et de réactualiser son héritage. Ce dernier doit, en effet, être réinterprété au regard des défis de notre temps. Il lui faut également répondre aux critiques adressées par les féministes et les post-coloniaux aux Lumières passées, accusées d'être hégémoniques et eurocentristes. En outre, si la construction de la paix reste la finalité de l'Union européenne, le contexte géopolitique actuel l'oblige à affirmer son indépendance militaire, technologique, alimentaire et énergétique tout en étant une alternative aux politiques de la domination. Ainsi, la prise en compte des enjeux écologiques, sanitaires, sociaux et démocratiques que le réchauffement climatique, la pandémie, le réveil des nationalismes et la guerre en Ukraine mettent au jour doit la conduire à restructurer son projet politique autour d'un axe soulignant le lien entre ces phénomènes.
Dans ce colloque international, la philosophie, l'histoire, la science politique, le droit, la littérature croiseront les témoignages d'associations, d'entrepreneurs, et d'hommes et de femmes politiques connaissant de l'intérieur ou de l'extérieur les institutions de l'Union européenne.
MOTS-CLÉS :
Colonialisme, Cosmopolitisme, Démocratie, Droits de l'homme, Écologie, Europe, Guerre, Impérialisme, Lumières, Nationalisme, Post-modernisme, Universalisme, Universalité
CALENDRIER DÉFINITIF :
Samedi 19 août
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, du colloque et des participants
Dimanche 20 août
Matin
Corine PELLUCHON & Wolfgang ASHOLT : Introduction
L'AUTOCRITIQUE DE L'EUROPE, CONDITION DE SA REVITALISATION
Corine PELLUCHON : Le message philosophique de l'Europe, l'autocritique des Lumières et l'écologie comme nouveau télos
Maiwenn ROUDAUT : Est-il possible de (re)penser le défi démocratique européen avec la Théorie critique ?
Après-midi
NATIONALISMES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Bernard ROUGIER : Terrorisme, islamisme
Marius MASSON : Dépasser l'histoire national pour renouveler l'historiographie du fascisme
Klaus OSCHEMA : Images de l'Europe au Moyen Âge : entre "réalités médiévales" et projections modernes [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]
Soirée
Grands témoins, animée par Jean-Baptiste de FOUCAULD & Dinah LOUDA, avec Jean-Louis BOURLANGES (Président de la commission des Affaires étrangères) et Pierre VIMONT (Diplomate)
Lundi 21 août
ACTUALITÉS GÉOPOLITIQUES ET CONFLITS
Matin
Christian LEQUESNE : La guerre en Ukraine change-t-elle le rapport de l'Europe et des puissances
Nicolas TENZER : Comment la guerre russe contre l'Ukraine engage l'Europe et les États-Unis dans un combat commun ?
Nicolas WEILL : L'Occident contre l'Europe. "Rêves hespériques", de Hölderlin à Heidegger
Après-midi
Natalie SCHWABL : Le rôle des Églises dans les luttes pour l'indépendance
Table ronde, avec Dominique MOISI (Géopolitologue. Conseiller spécial à l'Institut Montaigne), Philippe POCHET (DG de l'Institut syndical européen, ETUI) et Jacques RUPNIK (Directeur de recherche au Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI))
Soirée
Apollinaire, Un bel obus, lecture-spectacle par Cécile BOUILLOT & Sophie BOUREL [Production Acte II scène 2 et la Compagnie La Minutieuse] (montage original de poèmes, chansons, calligrammes de Guillaume Apollinaire et d'extraits du film Après les combats de Bois-Le-Prêtre)
Mardi 22 août
LITTÉRATURE ET ART, DÉCOLONISATION ET UNIVERSALISME LATÉRAL
Matin
Laurent COHEN-TANUGI : Les représentations politiques de l'Europe aux défis du XXIe siècle
Wolfgang ASHOLT : L'universalisme latéral : une perspective pour la littérature contemporaine ?
Marie ROTKOPF : La mentalité allemande et l'impérialisme : Lettres à Émile Durkheim
Après-midi
Marianne DAUTREY : L'Europe et son dehors : l'exemple de la Documenta fifteen
Habib TENGOUR : Quand l'Algérie se décolonise, héritage et émancipation des Lumières : la littérature francophone originaire
Friedrich SMOLNY : Littérature et décolonisation
Soirée
Ania SZCZEPANSKA : L'héritage controversé et conflictuel de Solidarność [visioconférence]
Mercredi 23 août
LE NOMOS DE L'EUROPE : CONSTITUTION, COSMOPOLITIQUE ET FÉDÉRALISME
Historique de la constitution européenne, défis passés et présents
Matin
Teresa PULLANO : Europe hérétique, ou la physique du pouvoir contemporain
Didier GEORGAKAKIS : Au-delà de l'institutionnalisme dominant : pistes pour le futur des institutions européennes
Kristin ENGELHARDT : Mode et politique — Politique de la mode. La mode européenne des avant-gardes entre refus et adaptation
Après-midi
DÉTENTE
Soirée
Les femmes et l'Europe, lecture musicale de la construction de l'Europe des femmes, par Sophie BOUREL & Silvia LENZI [Compagnie La Minutieuse], avec le soutien de la Maison Jean Monnet du Parlement européen
Jeudi 24 août
LA MÉMOIRE ET LE PARDON DIFFICILE
Matin
Dietmar WETZEL : Penser l'Europe au-delà de la mémoire collective (Halbwachs) — points de référence, constructions, critiques
Jan FISCHER : Nous, les Lumières et l'autre
Jonas NICKEL : Enjeux de la réédition critique d'écrits antisémites
Frederike LIEVEN : Mathématiques modernes et esprit des Lumières
Après-midi
DÉTENTE
Vendredi 25 août
L'EUROPE ET LES EMPIRES
Matin
Olivier COMPAGNON : L'Europe en mal d'Amérique latine [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]
Harro von SENGER : Droits de l'homme : différences et similitudes sino-européennes
Après-midi
Sabine DULLIN : L'Empire russe contre la nation ukrainienne. Perspectives historiennes sur la décolonisation aux frontières de l'Europe
Mariia SHEPSHELEVICH : Formes de résistance en Russie (le plus brièvement possible) ou "pourquoi vous ne protestez pas ?"
Mamoudou GAZIBO : La Chine en Afrique : permanences, ruptures et implications [visioconférence]
Samedi 26 août
L'AVENIR DE L'EUROPE
Matin
Lucile SCHMID : L'Europe et l'écologie : le Pacte vert (Green deal) peut-il résoudre les impenses autour de la justice sociale et de la puissance ?
Hartmut ROSA : L'Europe comme espace de la résonance [visioconférence]
Après-midi
Marius PLOUARD : Le regard du documentariste sur les lieux du trauma
Table ronde de synthèse, animée par Jean-Baptiste de FOUCAULD, avec notamment Wolfgang ASHOLT, Hadrien FRÉMONT, Dinah LOUDA et Corine PELLUCHON
Dimanche 27 août
DÉPARTS
TÉMOIGNAGES :
• Cerisy à l’heure d’une Europe polyglotte. Rencontre avec Kristin ENGELHARDT, Jan FISCHER, Frederike LIEVEN, Marius MASSON, Jonas NICKEL, Natalie SCHWABL, Mariia SHEPSHELEVITCH et Frieder SMOLNY, propos recueillis par Sylvain ALLEMAND.
PRESSE / MÉDIAS :
• Présentation du colloque. Entretien avec Edith HEURGON réalisé par Hadrien FRÉMONT (Fondation Clarens pour l'humanisme)
VIDÉO RÉALISÉE PAR FRANCE MANHES — INIT - Éditions - Productions :
RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
Wolfgang ASHOLT : L'universalisme latéral : une perspective pour la littérature contemporaine ?
En partant des discours sur l'Europe de l'entre-deux-guerres (Valéry, Hussserl, Heidegger), on montrera comment, avec L'autre cap (1991), l'eurocentrisme qui est aussi un universalisme, est déconstruit par Derrida qui insiste sur la nécessité de "rester fidèle à l'idéal des Lumières". On comparera cette position, d'une part, à celle d'Axel Honneth qui, trente ans plus tard face à la critique du colonialisme, ne défend plus qu'une "capacité d'imputabilité réflexive" comme "petit" héritage des Lumières, et, d'autre part, à celle de Markus Messling qui, dans L'universel après l'universalisme (2023) défend la nécessité de préserver l'universel pour revendiquer aujourd'hui une "justice" et sa "légitimité" dans une société mondiale. Si la littérature actuelle peut être un laboratoire pour l'expérimentation et la "fabrication" de cet "universel", Boussole (2015) de Mathias Enard est probablement le roman "franco-français" qui va le plus loin dans ce sens. Dans une deuxième partie, en prenant l'exemple de ce roman, on mettra en évidence les difficultés que Le Partage du sensible (Rancière) de l'orientalisme vécu rencontrent et quelles questions cela pose à la construction et à la constitution de l'universel.
Corine PELLUCHON : Le message philosophique de l'Europe, l'autocritique des Lumières et l'écologie comme nouveau télos
Si l'Europe ne s'identifie pas à une zone géographique et culturelle ni à des croyances morales et religieuses, si elle ne se réduit pas à un marché ni même à un ensemble de lois, alors comment la penser ? Peut-on parler, comme Husserl et Patočka, de son sens philosophique, et est-ce à partir de son êthos, qui ne se confond pas avec une doctrine, mais implique un rapport non dogmatique au monde, que l'on peut saisir les finalités et la forme — le télos et le nomos — de l'Union européenne ? Sa construction aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale doit être replacée dans un contexte marqué par la conscience de devoir éviter les erreurs passées ayant pu alimenter le ressentiment et le nationalisme, mais également par une sorte de modestie intellectuelle liée à l'effondrement de l'idéal d'un progrès par la raison et par le discrédit attaché à tout idéal universalisable. Or s'il importe de regarder en face le passé tragique de l'Europe ainsi que l'inversion de la rationalité en irrationalité qui ont conduit à faire le procès de la modernité et justifient les critiques adressées par les post-modernes à l'eurocentrisme et au faux universalisme des Lumières passées, il convient aussi de réexaminer l'héritage philosophique et socratique de l'Europe. Non pour l'identifier à cette provenance grecque ou la ramener aux Lumières conçues comme un corps doctrinal, mais pour penser ces dernières comme le geste par lequel on identifie les dangers et les défis de son époque et comme un processus inachevé impliquant l'autocritique et exigeant même une sorte d'herméneutique de soi. Qu'est-ce que l'Europe a aujourd'hui à dire au monde, alors que nous sommes confrontés à des défis globaux, économiques, politiques et environnementaux, qui nous obligent à revoir nos habitudes de penser et nos modes de vie ? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre en montrant que si l'identité de l'Europe est dynamique, ouverte aux influences étrangères, la pertinence de son message philosophique suppose d'entreprendre une généalogie du nihilisme mettant en évidence le lien entre le destin du rationalisme et celui de l'Europe, entre la dénonciation d'un rationalisme pris dans les rets de la domination et la promotion de nouvelles Lumières impliquant une manière de se penser et de se rapporter aux autres, humains et autres qu'humains, qui équivaut à une révolution anthropologique. Témoignant des ruptures historiques, épistémologiques et technologiques nous séparant des penseurs du XVIIe et XVIIIe siècles, ces nouvelles Lumières qui accompagnent un mouvement social déjà existant donnent un contenu plus précis au projet politique européen en reformulant son télos. Ainsi, il s'agira de voir comment l'écologie, quand elle est pensée dans sa dimension à la fois environnementale, sociale et existentielle et articulée à une phénoménologie du vivant, peut rendre l'Europe plus désirable dans un ordre mondial caractérisé par l'exacerbation des conflits, l'aggravation des inégalités et la prédation.
Spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée (médicale, environnementale et animale), Corine Pelluchon est professeur à l'université Gustave Eiffel. Elle est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dans lesquels elle développe une philosophie de la corporéité centrée sur la vulnérabilité et sur notre habitation de la Terre qui est toujours une cohabitation avec les autres vivants. Ce travail s'inscrit dans l'héritage des Lumières tout en prenant au sérieux les critiques qui leur sont adressées. Elle a déjà organisé deux colloques internationaux à Cerisy : un en juillet 2019, Humains, animaux, nature : quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ? (Actes publiés chez Hermann en 2020) et un autre, en juillet 2022, avec Yotetsu Tonaki, de l'université de Rikkyo, Levinas et Merleau-Ponty : le corps et le monde (Actes à paraître en octobre 2023 chez Hermann). Elle a reçu en 2020 en Allemagne le prix Günther Anders de la pensée critique pour l'ensemble de ses travaux et vient de passer presque deux ans à Hambourg, puis à Berlin, notamment à l'institut Max Planck.
Derniers ouvrages parus
Les Lumières à l'âge du vivant, Seuil, 2021, réédité en Points Seuil, 2022.
Paul Ricœur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice, PUF, 2022.
L'espérance ou la traversée de l'impossible, Rivages, 2023.
Site internet : corine-pelluchon.fr
Jean-Louis BOURLANGES
Président de la commission des affaires étrangères, Jean-Louis Bourlanges, est député des Hauts-de-Seine depuis 2017. Agrégé des lettres, ancien élève de l'École nationale d'administration, ancien professeur associé à Sciences-Po, il est Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Il a été membre du Parlement européen (1989-2007) où il fut président de la Commission de contrôle budgétaire, rapporteur-général du budget, président de la commission des libertés, membre puis président de la commission mixte Parlement européen Diète de Pologne. Il participe régulièrement à l'émission "Le nouvel esprit public" de Philippe Meyer diffusée en podcast : lenouvelespritpublic.fr.
Olivier COMPAGNON : L'Europe en mal d'Amérique latine
En 2003, Carlos Fuentes publiait un texte intitulé "L'Amérique latine en mal d'Europe" où il invoquait la source d'inspiration que pouvait constituer le Vieux Continent dans une région confrontée aux défis de la consolidation démocratique, de la pauvreté et des inégalités ou encore de l'intégration. Il perpétuait ainsi une tradition de pensée héritée du XIXe siècle dans laquelle l'Amérique latine, périphérie parmi les périphéries, semblait devoir soumettre son devenir à l'adoption des modèles produits dans les centres présumés du monde. Vingt ans plus tard, tandis que certaines démocraties vacillent et que les inégalités se creusent en Europe, il n'est pas anodin de retourner la question et de se demander ce que l'Europe aurait à gagner en se tournant vers l'Amérique latine et les Caraïbes. Que nous disent ces mondes qui furent à la fois le berceau de la mutation néolibérale et des premières contestations de cette nouvelle orthodoxie globale ? Que retenir des diverses propositions d'inclusion socio-raciale qui y virent le jour au cours des dernières décennies — du multiculturalisme à la plurinationalité — dans le contexte de ce que l'on nomme parfois "la crise de l'universalisme des Lumières" ? En quoi la transformation des sociétés latino-américaines au cours du dernier demi-siècle peut-elle contribuer à penser les défis auxquels est confrontée l'Europe contemporaine ?
Olivier Compagnon est professeur d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle (Institut des Hautes Études de l'Amérique latine), chercheur au Centre de recherche et de documentation des Amériques (CREDA UMR 7227) et co-rédacteur en chef de la revue Cahiers des Amériques latines. Il a notamment publié L'Adieu à l'Europe. L'Amérique latine et la Grande Guerre (Paris, Fayard, coll. "L'épreuve de l'histoire", 2013), primé par l'Académie française et traduit en espagnol et en portugais. Il achève actuellement un ouvrage intitulé Salvador Allende. Le Chili, l'Amérique latine et le monde (à paraître chez Flammarion, fin 2023).
Sabine DULLIN : L'Empire russe contre la nation ukrainienne. Perspectives historiennes sur la décolonisation aux frontières de l'Europe
Les discours du Kremlin évoquent une menace existentielle sur leur pays comme le 22 juin 1941 quand les nazis avaient envahi leur territoire. Ils mettent en avant une guerre de civilisation contre l'Occident dont la Russie serait le porte-drapeau. Pourtant, perçant le brouillard épais des mots tentant de justifier la guerre, la réalité crue et violente qui apparaît ressemble à celle d'une guerre coloniale. Dans le discours national des Ukrainiens, l'idée de se décoloniser de la Russie, présente dès la fin du XIXe siècle, puis dans la résistance et la dissidence du temps de l'URSS, n'a cessé de se renforcer depuis l'indépendance. Faut-il dès lors envisager le conflit comme une guerre de décolonisation ? Quand il s'agit des peuples européens, l'habitude est souvent d'invoquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la décolonisation semblant relever des réalités africaines ou asiatiques. Pourtant, la guerre qui se déroule sous nos yeux se comprend mieux si on la réinscrit dans une histoire des Empires et des décolonisations à l'Est de l'Europe.
Sabine Dullin est professeur en histoire contemporaine de la Russie à Sciences Po. Ses recherches portent sur l'histoire de l'Empire russe et soviétique, sur les dimensions internationale et transnationale du communisme et les frontières.
Publications
Histoire de l'URSS, La Découverte, 2009.
La frontière épaisse. Aux origines des politiques soviétiques (1920-1940), Éditions de l'EHESS (2014).
Atlas de la guerre froide, Autrement, 2017.
L'ironie du destin. Une histoire des Russes et de leur empire (1853-1991), Payot, 2021.
Didier GEORGAKAKIS : Au-delà de l'institutionnalisme dominant : pistes pour le futur des institutions européennes
Cette contribution rallie la position des organisateurs sur la place que l'autocritique doit prendre dans le nécessaire mouvement de renaissance ou de revitalisation de l'Europe. De ce point de vue, la communication veut pointer que la forte clôture sociologique du champ institutionnel européen et les effets d'exclusion qu'elle entraine font qu'on ne peut se contenter de voir les discussions sur l'avenir de l'Europe se consumer dans l'idée d'une éventuelle énième révision des institutions politiques et juridiques de l'UE. Rééquilibrer le poids respectif des différentes institutions/organes ou en créer d'autres n'est en aucun cas mécaniquement le commencement d'autre chose et encore moins une fin en et pour elle-même. La sociologie critique des institutions européennes invite dès lors à frayer un autre chemin : il s'agit, par les institutions, mais aussi surtout en deçà et au-delà d'elles, de concentrer les énergies sur la transformation des conditions des investissements (humains et symboliques aussi bien que matériels et financiers) dans et de l'UE.
Didier Georgakakis est professeur à l'université Panthéon Sorbonne (PARIS 1) et au Collège d'Europe, et membre du Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS). Directeurs de master et de programme pédagogiques européens depuis 25 ans, il a occupé différentes fonctions dans les associations européennes de sciences humaines et sociales. Ses travaux ont contribué à fonder la sociologie historique et politique de l'UE sur laquelle il a publié abondamment. En 2021 et 2022, il a notamment coordonné deux numéro de la Revue française d'administration publique (180 et 181) sur les transformations de l'UE et une importante synthèse sur la sociologie politique européenne parue dans l'encyclopédie en ligne Politika.
Christian LEQUESNE : La guerre en Ukraine change-t-elle le rapport de l'Europe et des puissances
La guerre en Ukraine a pris de court des Européens habitués à penser leur continent comme un espace de paix régulé par la négociation. L'offensive militaire russe a fait revenir sur le devant de la scène les questions de sécurité au sens le plus classique du terme. L'Union européenne a fait preuve d'unité dans l'élaboration de neuf paquets de sanctions et l'octroi d'une aide militaire qui vient s'ajouter à celle des États-Unis. Cette unité cache cependant des faiblesses à l'égard du traitement qu'il convient de réserver à la Russie lors d'un éventuel processus de paix, au processus d'élargissement de l'Union européenne et au rôle de la solidarité transatlantique. Alors que l'espoir d'une paix négociée en Ukraine ne semble pas se profiler à court terme, quel rôle peut jouer l'Union européenne en Europe ? Doit-elle affirmer un rôle autonome ou est-elle condamnée à embrasser la solidarité transatlantique en assumant un leadership des États-Unis dans le camp des démocraties occidentales ?
Christian Lequesne est professeur de science politique à Sciences Po Paris. Il a été directeur du Centre de recherches internationales (CERI) à Sciences Po et du Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) à Prague. Ses publications depuis trente ans portent sur l'Union européenne et les pratiques de la diplomatie. Il prépare actuellement un livre sur la diplomatie française et les Français de l'Étranger.
Klaus OSCHEMA : Images de l'Europe au Moyen Âge : entre "réalités médiévales" et projections modernes
Mis à part certains travaux pionniers, les historiens n'ont commencé à s'intéresser à l'histoire de la notion et des idées d'Europe au Moyen Âge qu'au milieu du XXe siècle. Inspirées par l'expérience de deux guerres catastrophiques, les enquêtes visaient désormais à identifier les racines d'une culture "européenne" afin de contrebalancer les effets dévastateurs des nationalismes modernes. De la sorte, le discours historique s'est rapproché du discours politique — et son analyse ne révèle pas seulement des connaissances sur les phénomènes du passé, mais aussi des attitudes et convictions modernes. L'historiographie sur "l'Europe médiévale" montre la relativité des connaissances historiques et permet de réfléchir sur la valeur de l'histoire pour l'orientation de la politique contemporaine. Sur la base d'un choix d'exemples représentatifs ("Charlemagne l'Européen", "l'Europe chrétienne"), cette présentation vise à discuter les potentiels et les limitations des motifs historiques pour les débats actuels.
Klaus Oschema est le directeur de l'Institut historique allemand à Paris et professeur d'histoire médiévale à la Ruhr-Universität Bochum (Allemagne). Ses recherches se focalisent sur l'histoire de la noblesse et de la cour (Bourgogne, Savoie) à la fin du Moyen Âge, les formes de sociabilité et les liens entre l'imaginaire géographique et l'ordre social. Il a notamment publié Bilder von Europa im Mittelalter (2013) et "Europe" in the Middle Ages (2023).
Teresa PULLANO : Europe hérétique, ou la physique du pouvoir contemporain
La question à présent est de savoir si l'Europe est encore en mesure de se poser comme le sujet d'une politique d'émancipation pour ses propres citoyens et pour ceux qui ne le sont pas. Pour y répondre, il faut mobiliser ces ressources philosophiques qui ont été minoritaires à l'intérieur de la philosophie moderne. Réfléchir à une Europe hérétique signifie retrouver les traces d'une temporalité non hégémonique, qui puisse nous aider à penser les catégories centrales du politique à partir de paradigmes marginaux à l'intérieur de l'histoire du libéralisme moderne sans toutefois se renfermer dans l'obscurantisme. C'est seulement si on développe une analytique de ce que j’appelle, d'après Foucault, la physique du pouvoir contemporain que l'on peut déchiffrer les transformations de l'Europe à présent et de ses relations au monde.
Teresa Pullano est une philosophe du politique. Elle travaille comme chercheuse auprès du Centre National de la Recherche italien à Rome (CNR-IRPPS), elle enseigne à l'université de Leuphana, Lüneburg (Allemagne) ; elle est research fellow auprès du European Institute de la London School of Economics and Political Science (Royaume Uni) et de l'Institute of European Global Studies de l'université de Bale (Suisse). Elle a publié le livre La citoyenneté européenne : un espace quasi-étatique (Paris, Presses de Sciences Po, 2014). Ses travaux ont été publié, parmi d'autres, dans les revues Droit et Société, Politique européenne, Philosophie, Politica & Società et dans plusieurs livres collectifs en français, anglais et italien.
Marie ROTKOPF : La mentalité allemande et l'impérialisme : Lettres à Émile Durkheim
1915, le sociologue Émile Durkheim publie L'Allemagne au-dessus de tout. Tout comme le Franco-Allemand Rudolf Diesel, né la même année que lui, Durkheim a une mission : rendre le peuple heureux. Il l'écrira clairement : celle-ci est incompatible avec la mentalité allemande. Tous les deux tués par l'axe impérialiste, l'un finira suicidé mystérieux dans la Manche, l'autre anéanti par la désespérance. 1943, la réalité allemande dépasse la fiction. 2023, l'impérialisme, qu'on ne nomme pas, vit de guerres, d'îles d'or et d'offshore. Depuis les guerres de Yougoslavie, le bombardement de la Serbie signé en 1999 par les Verts et le SPD, on assiste aujourd'hui à la remilitarisation historique allemande. C'est dans la continuité du travail et du dernier livre de Durkheim que nous proposerons une réflexion sur le moteur de l'Union européenne, ce pays mystérieux qu'est l'Allemagne.
Marie Rotkopf (1975, Paris) est écrivain, poète et critique culturelle. Elle s'intéresse à la construction et à la communication du pouvoir. La réécriture de l'Histoire, la conscience allemande et européenne est l'un des thèmes de son travail. Elle est l'auteur d'Antiromantisches Manifest (Nautilus, 2017) ou de Rejected. Designs For The European Flag (Wirklichkeit Books, 2020). En 2023, elle fait republier en Allemagne Deutschland über alles d'Émile Durkheim, suivi de son essai Zone Libre (Matthes & Seitz).
http://marie-rotkopf.net/
Maiwenn ROUDAUT : Est-il possible de (re)penser le défi démocratique européen avec la Théorie critique ?
En philosophie politique et en histoire des idées européennes, c'est traditionnellement la critique kantienne, compatible avec le programme des Lumières, qui est convoquée pour penser l'idéal démocratique. À l'inverse, les philosophes de la Théorie critique francfortoise sont plutôt perçus comme les instigateurs d'un courant des anti-Lumières, caractérisé par son pessimisme et son rejet de tout espoir de mener une vie juste, a fortiori démocratique, "après Auschwitz". À l'opposé de cette interprétation de l'histoire des idées européennes, cette contribution entend montrer que cette tradition critique, partant de Hegel, et passant par Marx et Freud, peut contribuer à renouveler la pensée de la démocratie en Europe dans la mesure où elle interroge la continuité, trop souvent sous-estimée dans les réflexions sur l'Europe, de l'autoritarisme et du fascisme sous des formes diverses.
Maiwenn Roudaut est maîtresse de conférences en histoire des idées des pays de langue allemande à l'université de Nantes, actuellement chercheuse au Centre Marc Bloch à Berlin. Ses travaux de recherche portent sur la notion de critique, l'École de Francfort et les questions de reconnaissance en philosophie politique. Elle a notamment publié plusieurs articles sur Habermas et l'Europe, et plus récemment sur les rapports entre éducation, critique et démocratie ("Démocratie, critique et éducation en Europe. L'héritage de l'École de Francfort", in Tristan Coignard et Céline Spector (dir.), Europe philosophique, Europe politique. L'héritage des Lumières, Classiques Garnier, 2022, p. 247-264).
Lucile SCHMID
Lucile Schmid est ancienne élève de l'ENA, administratrice de l'État au ministère de l'Économie. Elle a été élue locale socialiste puis écologiste en Ile de France. Cofondatrice du think tank La Fabrique écologique, elle est membre de longue date de la rédaction de la revue Esprit, et a été coprésidente de la fondation verte européenne (Green european Foundation) avec laquelle elle travaille régulièrement. Depuis 2019, elle anime avec la philosophe Catherine Larrère un séminaire sur les relations entre démocratie et écologie. Elle a créé en 2018 le Prix du roman d'écologie (PRE) un prix littéraire qui récompense des romans écrits en langue française où l'écologie occupe une part substantielle de l'intrigue. Elle est l'auteure de plusieurs essais portant sur les élites publiques, les enjeux écologiques et les relations franco-algériennes.
Harro von SENGER : Droits de l'homme : différences et similitudes sino-européennes
Le passé
Les différences entre les cultures juridiques autochtones européennes et chinoises ne doivent pas être surestimées, et les parallèles sino-occidentales dans l'histoire juridique chinoise et européenne ne doivent pas être négligées.
Actualité
Différences
Europe : Libéralisme (avec une exception)
Chine (RPC): Sino-Marxisme
Europe : Accent sur les droits humains politiques
Chine : Accent sur les droits humains économiques
Europe : Accent sur les libertés
Chine : Accent sur les limitations des libertés
Similitudes
Convention européenne des droits de l'homme et conception officielle chinoise des droits de l'homme : relativisme culturel.
Les pays européens et la Chine ont ratifié le Pacte 1 sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Dans chaque session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de nombreuses résolutions sont approuvés par les pays européens et la RPC.
Conclusion
La situation des droits de l'homme en RPC doit être considérée de manière différenciée dans l'esprit de la Conférence mondiale de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme.
Harro von Senger (Suisse), docteur en droit et docteur en philosophie, avocat, est professeur émérite en sinologie de l'université de Fribourg en Brisgau. Ses recherches portent sur la langue et culture chinoise, surtout le droit chinois ancien et contemporain et la doctrine militaire chinoise depuis l'antiquité.
Publications
"Not only Differences, but also Consensus in Human Rights Concepts between China and the West", in Chen Sun & Hans-Christian Günther (ed.), Aspects of China's New Role in the Globalized World. Problems of International Politics, Séries de livres "East and West", vol. 2, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2016, p. 95-112.
"Emer de Vattel en Chine", in Revue historique neuchâteloise, 151e année, n°3, 2014, p. 163-174.
Livres sur l'art chinois de la ruse publiés en 16 langues, dont en Ouïghour et Ukrainien, voir :
china-outofthebox.ch | 36strategeme.ch | supraplanung.eu | dastaoderschweiz.ch
Ania SZCZEPANSKA : L'héritage controversé et conflictuel de Solidarność
Les grèves d'août 1980 aux chantiers navals Lénine de Gdańsk furent essentielles dans la sortie du communisme en Europe centrale. Solidarność fut bien plus que le premier syndicat libre et autonome. C'est un incroyable mouvement social qui regroupa des millions d'individus, en Pologne et ailleurs, et mena à l'une des plus importantes révolutions pacifiques dans l'Europe du XXe siècle. Quarante ans plus tard, par-delà les questions mémorielles de l'après-1989, ce moment d'éveil des consciences continue à fasciner et fait l'objet d'une guerre mémorielle dans la Pologne d'aujourd'hui. Il oblige également à questionner les valeurs et le programme politique porté par un mouvement hétéroclite, soutenu par l'Église catholique et tourné vers l'Ouest, qui se voulait à la fois émancipateur et défenseur des traditions. Son programme peut-il encore inspirer l'Europe aujourd'hui ?
Ania Szczepanska est maîtresse de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et réalisatrice. Ses travaux portent sur les cinématographies de l'Est, les archives visuelles et leur rôle dans l'écriture de l'histoire. Elle a réalisé le film documentaire Nous filmons le peuple ! (2011, Abacaris films) consacré à l'engagement politique des cinéastes en Pologne communiste ainsi que Solidarność, la chute du mur commence en Pologne (2019, Looksfilm, Arte-NDR). Son dernier ouvrage s'intitule Une histoire visuelle de Solidarność (2021, FMSH). Elle réalise actuellement un film documentaire, Sous la terre de Polin, consacré à l'histoire des fouilles archéologiques d'Auschwitz et des objets ainsi exhumés.
Habib TENGOUR : Quand l'Algérie se décolonise, héritage et émancipation des Lumières : la littérature francophone originaire
Résultat d'une guerre de libération douloureuse, la décolonisation de l'Algérie s'est faite par rapport à la France, puissance coloniale d'alors qui se disait héritière des Lumières. La politique scolaire mise progressivement en œuvre (dans les villes surtout et en Kabylie) a permis l'émergence d'intellectuels et d'écrivains de langue française qui auront à prendre en charge cet héritage tout en ayant un regard critique en le confrontant à leur culture d'origine. Cette communication portera sur la manière dont Mohammed Dib, Kateb Yacine, Jean Senac, Mouloud Mammeri et Assia Djebar, écrivains que j'ai bien connus, ont entrepris cette décolonisation dans leur écriture.
Habib Tengour, poète et anthropologue, né le 29 mars 1947 à Mostaganem (Algérie). Il a publié une vingtaine d'ouvrages (poésie, prose, théâtre, essais). Sa poésie est traduite dans plusieurs langues. Il a obtenu en juin 2016 le Prix européen de poésie Dante pour l'ensemble de son œuvre poétique et en décembre 2022, le prix Benjamin Fondane pour l'ensemble de son œuvre. Il dirige depuis le printemps 2018 la collection "Poèmes du monde" aux Éditions Apic à Alger.
Publications récentes
Le Tatar du Kremlin, Éditions Phi, Luxembourg, 2018.
Odysséennes / Odissaiche, édition bilingue français-italien, traduction Fabio Scotto, Éditions Puntoacapo, Torino, octobre 2019.
Ta voix vit / Nous vivons, dessins de Hamid Tibouchi, Éditions Apic, Alger, octobre 2020.
La sandale d'Empédocle, Éditions Non lieu, Paris, juin 2021.
Nicolas WEILL : L'Occident contre l'Europe. "Rêves hespériques", de Hölderlin à Heidegger
À partir des "Cahiers noirs" de Martin Heidegger, mon propos veut mettre en lumière une opposition entre l'idée d'Europe et celle d'Occident. On s'appuiera sur une relecture critique de l'utilisation par Heidegger du corpus Hölderlinien dans le but de définir, contre la notion d'Europe, un destin "hespérique" (authentiquement occidental). Heidegger a pensé que ce destin — ou "nouveau commencement" — devait être assumé par l'Allemagne, puis par une Russie (débarrassée, soutenait-il, du bolchévisme et des théories venues de "l'Ouest"). Il y a là quelque chose de tristement actuel quand on voit l'argumentaire des idéologues proches de Moscou. Mais il s'agit surtout de s'interroger sur l'idéal européen à travers l'un de ses contretypes philosophiques.
Nicolas Weill, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, est journaliste au Monde depuis 1995 et critique littéraire au "Monde des livres" depuis 2017. Traducteur et enseignant à Sciences Po, il a notamment publié en 2018, Heidegger et les Cahiers noirs. Mystique du ressentiment, Paris, CNRS éditions.
Dietmar WETZEL : Penser l'Europe au-delà de la mémoire collective (Halbwachs) — points de référence, constructions, critiques
Après une brève introduction aux questions centrales de la mémoire collective dans une perspective européenne, je rappellerai dans un deuxième temps de ma contribution des connaissances importantes tirées de l'œuvre du sociologue Maurice Halbwachs (1877-1945). Celles-ci fournissent encore aujourd'hui une base solide pour aborder les questions de la mémoire européenne. Dans un troisième temps, je me pencherai sur les constellations post-nationales ainsi que sur la question des re-nationalisations actuelles et de leurs implications pour le discours de la mémoire. Une étude de cas sur les cultures de la mémoire (européenne) sert à illustrer les idées de base développées précédemment. Dans le contexte d'une réflexion sur la mémoire disputée et nécessairement incomplète, l'exposé se conclut par la question de la nécessité et des difficultés d'une culture européenne de la mémoire.
Dr. habil. Dietmar J. Wetzel est Professeur de Sciences Sociales et Directeur du Département de Pédagogie depuis 2019 à la MSH Medical School de Hambourg. Il est chargé de cours à l'université de Bâle et à la ZHAW de Winterthur.
Publication
"Contested Memories – Aspects of collective remembering and forgetting", in H.-J. Schmidt & N.-L. Perret (ed.), Memories lost in the Middle Ages. Collective forgetting as an alternative procedure of the social cohesion, Belgium, Brepols, 2023.
SOUTIENS :
• Fondation Clarens pour l'humanisme | Fondation de France
• Université Gustave Eiffel
• Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne
• Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
• Veolia
• Matmut
• Maison Jean Monnet | Parlement européen
• Université franco-allemande (UFA)