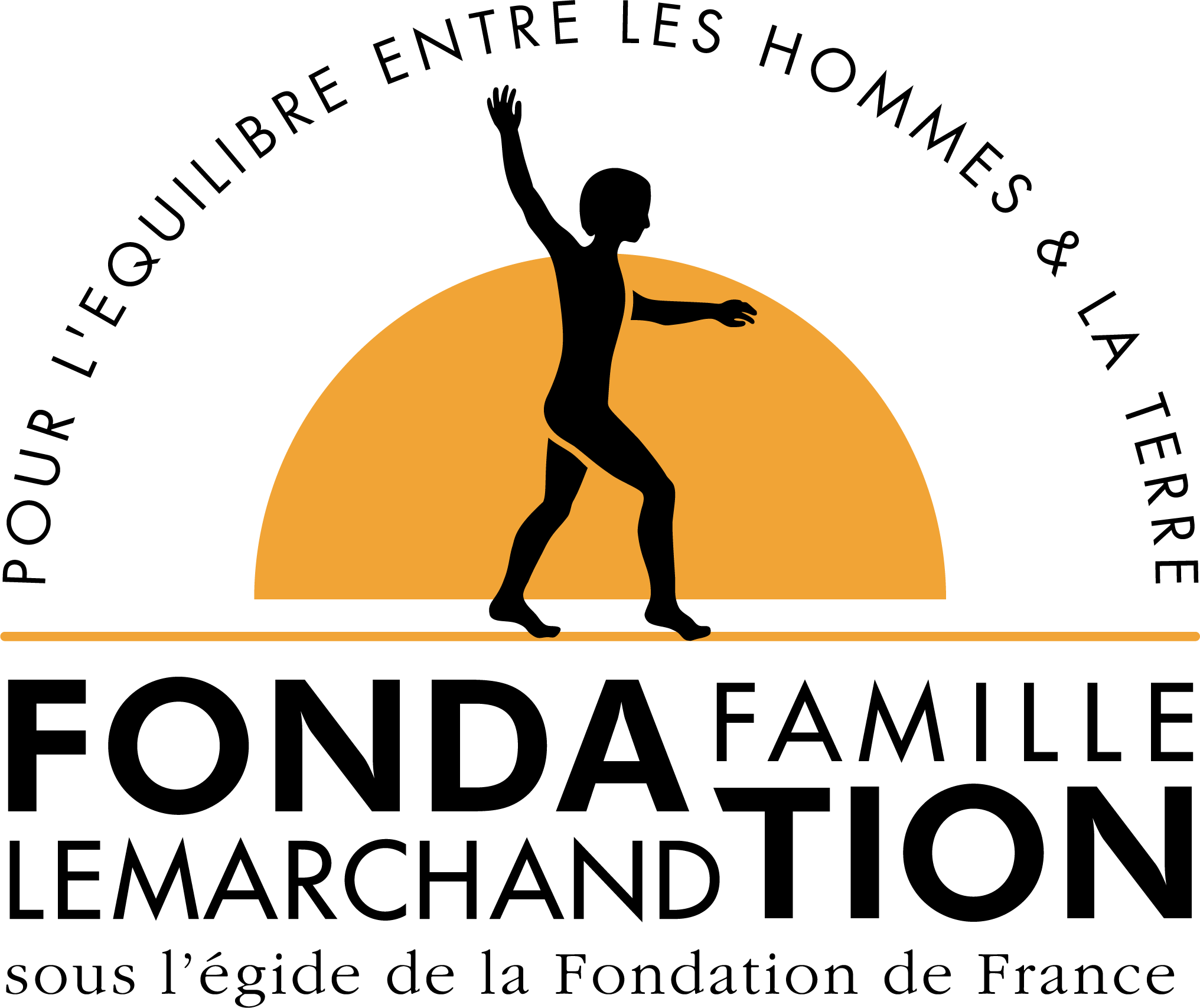LE RENOUVEAU DU SAUVAGE
DU LUNDI 26 JUIN (19 H) AU DIMANCHE 2 JUILLET (14 H) 2023
[ colloque de 6 jours ]
ARGUMENT :
Même dans nos sociétés industrialisées et de vieille civilisation agraire, où l'on avait espéré cantonner, voire éliminer, le sauvage, il revient et s'invite dans des espaces que l'on avait consacrés aux activités et aux habitations humaines. La déprise agricole, l'abandon d'anciens espaces cultivés ou ouverts au pastoralisme, s'est traduite par une sorte d'ensauvagement des campagnes, avec la progression de friches qui évoluent à terme vers des peuplements forestiers. On parle alors de "fermeture des paysages". La désindustrialisation se manifeste par la progression de friches industrielles, de la même façon que les remaniements de l'urbanisme ont multiplié les friches urbaines et périurbaines, en attente d'une autre affectation qui tarde à venir, et parfois n'advient pas. Le sauvage est désormais partout présent, et le partage des espaces entre le sauvage et le domestique ne tient plus : le sauvage s'invite là où on ne l'attendait plus, et ses interactions avec les activités humaines se multiplient et se complexifient.
Comment cohabite-t-on avec le sauvage, comment faire-avec lui et quelles évolutions se dessinent-elles dans la société ? Pour y répondre, ce colloque vise à favoriser des échanges entre différentes disciplines et des acteurs intervenant sur le terrain. Ouvert à toute personne intéressée par le sujet, il s'élargira encore grâce au partage de certaines séances, soirées ou promenades avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?.
MOTS-CLÉS :
Aires protégées, Animaux, Chasse, Conservation, Espace domestique, Forêt, Friches, Interactions entre humains et non-humains, Libre-évolution, Nature sauvage, Réensauvagement, Restauration écologique
CALENDRIER DÉFINITIF :
Lundi 26 juin
Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée
Présentation du Centre, des colloques et des participants
Mardi 27 juin | En commun avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?
Matin
LA PLACE DU SAUVAGE DANS NOS CIVILISATIONS
Raphaël LARRÈRE : Le sauvage, le domestique et l'entre-deux
Bénédicte MEILLON : Changer de paradigme par le biais de l'écopoétique : quand la littérature compose sur le mode du "réalisme liminal" pour amplifier notre Umwelt et réenchanter le monde | Colloque en parallèle
Après-midi
Jacques TASSIN : Maurice Genevoix : natures pensées, natures sensibles
Marie CAZABAN-MAZEROLLES : La tornade et le crocodile. Complicités, empêchements et pouvoirs du récit à l'ère du grand dérangement | Colloque en parallèle
Rémi BEAU : Figures contemporaines du sauvage : le nouveau, l'ancien et le trouble
Visite de l'exposition "Danse et anamorphoses sylvestres" réalisée par Bénédicte MEILLON et Caroline GRANGER | Colloque en parallèle
Soirée
Visite du château puis promenade dans le parc
Mercredi 28 juin
Matin
L'ENSAUVAGEMENT ET LE RÉENSAUVAGEMENT
Vincent DEVICTOR : C'est arrivé près de chez vous : la dynamique du sauvage sous pression [communication établie avec Laurent GODET]
François SARGOS : Le pâturage naturel sur la réserve naturelle de l'étang de Cousseau (Gironde) : outil dans la restauration et la protection de la biodiversité et des paysages
Après-midi | En commun avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?
REGARDS SUR LE SAUVAGE
Virginie MARIS : Critiques et ressources écoféministes pour penser un ré-ensauvagement émancipateur
Anne SIMON : Zoopoétique, vivant, nature, sauvage… : mots-mania ou mots-tabous ? | Colloque en parallèle
Charles STÉPANOFF : Les deux visages du sauvage
Soirée | En commun avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?
Roman, littérature et science face aux biocides, débat animé par Noël CORDONIER, avec la participation de Gisèle BIENNE (autrice de La Malchimie) et de Gilles-Éric SÉRALINI (biologiste, spécialiste des OGM et des pesticides, auteur de L'Affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers)
Jeudi 29 juin
Matin & Après-midi
LA LIBRE-ÉVOLUTION SUR LE TERRAIN
Serge MORAND : Zoonoses, ces liens infectieux entre sauvage, domestique et humains
"HORS LES MURS" — VISITES | Présentation
• Les falaises littorales de Carolles et Champeaux — Conservatoire du littoral
• La grande Noé (bois de pente et ancienne carrière) — CEN Normandie
Vendredi 30 juin
Matin
LE SAUVAGE À LA CAMPAGNE
Christian BARTHOD : Comment s'est-on approprié la wilderness et la nature férale en Europe et en France ?
Gilles RAYÉ : Retour d'expérience de plus de 70 ans de rewilding dans les Alpes
Après-midi
COHABITER AVEC LE SAUVAGE
Rémi LUGLIA : Quelle(s) place(s) laisser aux autres qu'humains ? Regards historiens
Les ensauvagements, table ronde animée par Laurent GERMAIN [Office français de la biodiversité (OFB)], avec Farid BENHAMMOU [Ces "envahissants" qui nous dérangent : du loup à l'ibis sacré], Loïs MOREL [Que dire des friches et des forêts férales ? Récits naturalistes de la déprise agricole] et Joëlle SALOMON CAVIN [La faune non désirée de la ville]
Soirée | En commun avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?
Témoignages sur la libre évolution en Normandie, animée par Lydie DOISY, avec Sébastien ÉTIENNE (Office National des Forêts), Nicolas FILLOL (Parc naturel régional des Maris du Cotentin et du Bessin) et Thomas GUILLORE (Association Hydroscope)
Samedi 1er juillet
Matin
LES TERRITOIRES FACE AU RENOUVEAU DU SAUVAGE
Raphaël MATHEVET : Écologie et zoopolitique du sauvage [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]
Les praticiens, table ronde animée par Fabien QUÉTIER, avec Denis CAUDRON [L'expérience du label "Rivières Sauvages"], Alexandre CHAVEY [Le label "Territoire de faune sauvage"] et Lydie DOISY [L'expérience du programme PRELE du CEN Normandie]
Après-midi
Pascal MARTY : "Nous avons toujours été sauvages" : dynamiques des paysages ruraux
Discussion générale sur les possibilités d'assurer une libre évolution sur le long terme et sur celles de réaliser des expériences de rewilding socialement acceptées
Soirée | En commun avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?
Benjamin AUDOUARD & Mathilde GILOT (Collectif SMOG) : Terminus sauvage [transcription artistique du colloque]
Dimanche 2 juillet
Matin
CONCLUSIONS
Damien MARAGE : Des raisons objectives pour s'attacher à la sauvegarde du monde sauvage ?
En commun avec le colloque en parallèle : Que peut la littérature pour les vivants ?
"Rapports d'étonnement" (suite) : Léa Sophia HÜMBELIN, Maïwenn MIGNON et Robin WEGMÜLLER (Fondation suisse d'études)
Gérald MANNAERTS : Éléments de synthèse du colloque "Que peut la littérature pour les vivants ?" | Colloque en parallèle
Laurent GERMAIN : Des pistes d'actions pour changer notre relation au vivant dans la gestion des espaces naturels
Discussion générale et remerciements par les directeurs des deux colloques
Après-midi
DÉPARTS
RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
Erwan CHEREL
Technicien de la conservation de la nature, Erwan Cherel a rejoint le comité français de l'UICN (CF UICN) après avoir travaillé en Afrique Centrale sur les aires protégées et dans la lutte contre le trafic des espèces protégées. Il anime aujourd'hui le groupe de travail "Wilderness et Nature Férale" du CF UICN dont les réflexions et les débats sur le sauvage et la libre évolution ont inspiré l'idée du colloque sur "Le Renouveau du Sauvage".
Raphaël LARRÈRE : Le sauvage, le domestique et l'entre-deux
Je me propose de déconstruire la frontière entre le domestique et le sauvage, un sauvage que l'on n'apprécie en général que lorsqu'il reste à sa place et ne s'invite pas dans notre environnement quotidien où il est malvenu. Il y aura toujours des passeurs de frontières et dans les deux sens (espèces sauvages qui fréquentent l'espace domestique, espèces domestiques qui envahissent des milieux naturels). De même, subsistera-t-il toujours un entre-deux du sauvage et du domestique, qu'il s'agisse de milieux ou d'espèces. En prendre conscience conduit à considérer qu'il est raisonnable de négocier avec des espèces sauvages, de façon à trouver la "bonne distance" envers elles et les humains. Il est en tous cas plus raisonnable de faire-avec la spontanéité et l'ingouvernabilité du sauvage que d'espérer le cantonner dans des réserves ou l'éliminer.
Agronome et sociologue, Raphaël Larrère, retraité, fut directeur de recherche à l'INRA. Il a orienté ses recherches en éthique environnementale. Il a publié avec Catherine Larrère : Du bon usage de la nature (Flammarion, 1997, 2009, 2022), Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique (La Découverte, 2015, 2018), et Le pire n'est pas certain. Essai sur l'aveuglement catastrophiste (Premier Parallèle, 2020).
Fabien QUÉTIER
Écologue "indiscipliné", Fabien Quétier a 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu dans l'interfaçage des connaissances et méthodes de l'écologie scientifique avec celles des sciences économiques et sociales, dans un contexte de conservation de la nature, de restauration écologique et de gestion durable des ressources naturelles et d'aménagement des territoires. Il travaille aujourd'hui pour Rewilding Europe, une fondation qui porte une initiative pan-européenne qui cible ses efforts sur la renaturation à grande échelle de plusieurs territoires exemplaires et accompagne de nombreux partenaires dans leurs propres démarches en faveur d'un renouveau de la nature sauvage à l'échelle du continent.
Benjamin AUDOUARD & Mathilde GILOT (Collectif SMOG) : Terminus sauvage
Le Collectif SMOG propose une restitution artistique du colloque. Cette création in situ prendra forme à travers plusieurs disciplines. Le collectif d'artistes s'emparera de l'ensemble des thématiques abordées dans la semaine pour dresser un portrait du sauvage à la fois poétique et sensible. Terminus sauvage est une transcription artistique, se dessinant aux travers des différents points de vue présents.
Le Collectif SMOG est le fruit de la rencontre entre Benjamin Audouard et Mathilde Gilot, entre les arts vivants et les arts visuels. Depuis plusieurs années, ils s'intéressent aux relations qu'entretiennent l'Homme et la Nature à travers différents projets pluridisciplinaires. En 2021, ils font partie des 264 lauréats du programme "Mondes Nouveaux" avec Coquilles qui s'articule à travers deux disciplines : la science et l'art. Mathilde et Benjamin s'inscrivent dans une forme d'écriture où se mêlent documentaire et fiction pour trouver un sens, parmi d'autres, au monde qui les entoure.
Christian BARTHOD : Comment s'est-on approprié la wilderness et la nature férale en Europe et en France ?
En 2009, l'adoption par le Parlement européen, à la quasi-unanimité, d'une résolution demandant une politique communautaire de la wilderness, et les débats afférents menés sous les présidences tchèque et belge ont révélé au grand jour une nouvelle sensibilité découlant de l'élargissement à l'Est de l'Union européenne, qui s'est traduite (encore timidement) dans les dernières stratégies communautaires sur la biodiversité et sur les forêts. Mais ceci a été rendu possible par un grand nombre d'initiatives convergentes prises depuis la fin des années 1990 par des associations à visée européenne, travaillant de manière plus ou moins articulée avec la Commission européenne. En France, sur la base d'initiatives diverses datant des années 1990, un groupe de travail de l'UICN, créé en 2012, s'est intéressé simultanément à la wilderness et nature férale, au sein d'une approche qui insistait sur la notion de trajectoire, plus que d'état actuellement constaté. Il a cherché à dépasser le seul horizon culturel des "sachants" motivés par ces questions, à consolider et fédérer les initiatives de terrain, et à banaliser les questions, réflexions et projets, en donnant envie à d'autres décideurs et acteurs d'investir le sujet.
Christian Barthod est Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts (honoraire). Il a créé le département de la santé des forêts qu'il a ensuite dirigé durant sept ans, avant de prendre la responsabilité de la sous-direction de la forêt entre 1995 et 2002, puis de la sous-direction des espaces protégés entre 2002 et 2008, avant de terminer sa carrière au sein de l'Autorité environnementale. Président du groupe de travail de l'UICN "Wilderness et nature férale" de 2012 à 2020, il a été co-rédacteur en chef invité par la Revue Forestière Française (RFF) pour le numéro spécial "Des forêts en libre évolution" (2021). Il est co-auteur de 5 ouvrages sur la forêt et le bois, auteur de plus de 180 articles, ainsi que de préfaces d'ouvrages sur la forêt, le bois et la protection de la nature.
Rémi BEAU : Figures contemporaines du sauvage : le nouveau, l'ancien et le trouble
Alors même que la terre, saturée de présence humaine, serait entrée, selon certains auteurs, dans l'âge de l'Anthropocène, l'idée du sauvage fait un retour remarqué dans différents champs de la pensée et de l'action écologiques. Un temps écarté au profit d'autres notions jugées plus scientifiques comme la biodiversité, le sauvage renaît depuis le début du XXIe siècle sous différentes figures qui ont en commun de valoriser la spontanéité et l'autonomie des processus naturels. Mais, par-delà ce point d'accord, de la libre évolution au ré-ensauvagement actif, se dessinent des conceptions distinctes à l'intersection entre science, éthique et esthétique. Empruntant au champ de l'écologie scientifique, mais aussi de l'éthique et de l'esthétique environnementale, je décrirai ces reconfigurations récentes qui ouvrent des possibilités de cohabitations nouvelles avec le sauvage.
Rémi Beau est chargé de recherche en philosophie au CNRS (IEES-Paris, Sorbonne Université). Spécialiste de philosophie de l'environnement, il travaille sur les notions d'écocentrisme, de perfectionnisme moral et sur les enjeux épistémologiques, éthiques et politique de la transition écologique et sociale. Il a notamment publié Éthique de la nature ordinaire. Recherches philosophiques dans les champs, les friches et les jardins (Presses de la Sorbonne, 2017), co-dirigé avec Catherine Larrère l'ouvrage Penser l'Anthropocène (Presses de Science Po, 2018) et avec Cécile Renouard, Christophe Goupil et Christian Koenig le Manuel de la Grande Transition (Liens qui libèrent, 2020).
Farid BENHAMMOU : Ces "envahissants" qui nous dérangent : du loup à l'ibis sacré
Ours slovènes, loups italiens, ibis africains… qu'il s'agisse d'espèces protégées dites autochtones ou d'espèces dites exotiques envahissantes, il est intéressant d'observer les mécanismes d'exclusion de certaines espèces jugées étrangères qui mériteraient au mieux d'être régulées, au pire éradiquées. Et quand il est question d'espèces exotiques, les rhétoriques dénonciatrices nourrissent une controverse où des naturalistes en appellent à un recours à la violence pour réparer un équilibre naturel qui aurait été perturbé par l'arrivée de l'ibis sacré dans l'Ouest de la France. Il s'agit ici de questionner les mécanismes à l'œuvre, d'évaluer les risques écologiques et d'interroger nos conceptions de la bonne nature sauvage et de la mauvaise nature sauvage.
Chercheur associé au Laboratoire Ruralités de l'université de Poitiers, enseignant en CPGE, Farid Benhammou étudie les controverses liées à la faune sauvage à travers le prisme d'une approche géopolitique environnementale. Le cœur de son travail porte sur les enjeux de cohabitation avec les ours et les loups, mais également sur d'autres espèces comme l'ibis sacré ou le bouquetin, victimes d'une politique publique relevant d'une géopolitique de la violence de la gestion de la faune sauvage.
Vincent DEVICTOR : C'est arrivé près de chez vous : la dynamique du sauvage sous pression
Sortons. Et cherchons le premier petit espace de végétation un peu dense. Accroupissons-nous et rampons le long des chemins empruntés par les renards, les fouines, les sangliers, les genettes, et toute la communauté des vivants qui les accompagne. À quoi serons-nous exposés ? Comment fuir ? Se reposer ? Se nourrir ? Nous chercherons dans cette étude à base de pièges photographiques à observer ce milieu d'intrication qui caractérise le sauvage — à l'intérieur et aux portes — des milieux anthropisés. La coexistence humains/non-humains est un ensemble fluctuant de stratégies mêlant opportunisme, résistance ou évitement.
Vincent Devictor est directeur de recherche eu CNRS à l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier. Il mène depuis 20 ans des recherches sur les différentes formes de réponses de la biodiversité aux pressions liées aux activités humaines. Il complète ses travaux par une réflexion philosophique sur le rôle des techniques et les enjeux politiques impliqués dans les stratégies de conservation de la nature. Vincent Devictor a notamment publié deux ouvrages sur ces travaux : Nature en Crise (coll. "Anthropoène", Seuil, 2015) et Gouverner la Biodiversité ou comment réussir à échouer (coll. "Sciences en Questions", Quae, 2021).
Rémi LUGLIA : Quelle(s) place(s) laisser aux autres qu'humains ? Regards historiens
Entre une logique d'éradication, héritée des XVIIIe et XIXe siècles, et une logique de sacralisation, toute récente, une cohabitation entre les humains et le monde sauvage est-elle possible ? "On ne naît pas nuisible, on le devient" souligne Aline Treillard. La problématique de l'étranger — qui n'est donc, par principe, pas à sa place selon le point de vue de certains humains — est un leitmotiv des relations conflictuelles entre les humains et les animaux. Cette communication propose un cheminement à travers les âges, les espèces, les milieux et les sociétés afin de mieux appréhender le caractère évolutif et situé de ces questionnements. Nous examinerons l'existence de différents registres d'acceptation qui pourraient n'être en réalité que des registres d'adaptation, celle-ci étant tout autant humaine qu'animale.
Rémi Luglia est agrégé et docteur en histoire, associé aux universités de Caen Normandie et de Tours. Il est également président de la Société nationale de protection de la nature. Il travaille sur l'histoire de la protection de la nature et l'histoire des animaux. Il a publié en 2015 sa thèse aux PUR sous le titre Des savants pour protéger la nature. La Société d'acclimatation (1854-1960). Il a dirigé en 2018 aux PUR Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! "Nuisible", une notion en débat. Il co-dirige avec Rémi Beau et Aline Treillard De la réserve intégrale à la nature ordinaire. Les figures changeantes de la protection de la nature en France (XIXe s.-XXIe s.), à paraître en juin 2023.
Damien MARAGE : Des raisons objectives pour s'attacher à la sauvegarde du monde sauvage ?
La planète est en passe de devenir de moins en moins vivable pour toujours plus d'espèces dites sauvages. Or, la civilisation occidentale n'a-t-elle pas considéré les espaces sauvages comme des terres "à mettre en valeur" ? Cette contribution présente les grandes lignes du manifeste sur lequel elle s'appuie : "L'avenir du vivant. Nos valeurs pour l'action", du Comité français de l'UICN, traitant du sauvage. Se contenter d'envisager l'organisation d'un "monde équitable qui comprend la valeur de la nature et la préserve" ne suffira pas. Par-delà les appels à une responsabilisation individuelle et collective vis-à-vis de la dynamique évolutive de la Terre et envers le sauvage, les humains doivent repenser leur organisation afin d'habiter la Terre de telle sorte que le sauvage s'y perpétue. Lui dédiant des espaces dont la devise pourrait être "la paix pour la nature", serait-ce l'expression du respect des humains pour la liberté des autres non-humains ? Pour autant, le monde sauvage ne peut être exclusivement confiné dans des espaces interdits aux humains. Il ne s'agit pas de fragmenter les territoires en zones d'exclusion, le sauvage là-bas, le domestique ici. Au contraire, dans le cadre d'un continuum allant des espaces les plus sauvages jusqu'au cœur des villes, il faut que l'aménagement de l'habitat humain soit conçu pour que des représentants diversifiés du monde sauvage s'y déploient partout et s'y perpétuent spontanément, selon des modalités négociées et ajustées de façon à garantir le mieux-vivre ensemble.
Damien Marage, professeur en géographie à l'université de Franche-Comté, travaille, au sein du laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS, le thème de la prise en charge du vivant dans les territoires. Il explore plus particulièrement l'analyse des qualités paysagères et environnementales depuis les milieux urbains jusqu'aux forêts d'Europe centrale et de Colombie. Il est membre du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il co-anime le groupe de travail "Éthique en action" du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
Virginie MARIS : Critiques et ressources écoféministes pour penser un ré-ensauvagement émancipateur
Cette présentation examinera différentes approches du ré-ensauvagement à la lumière des travaux féministes et écoféministes ayant indirectement ou directement abordé la question de la relation au sauvage. L'écoféminisme a produit une analyse critique de la notion de "wilderness", en mettant en évidence la charge coloniale et viriliste dont sa mobilisation au sein des mouvements préservationnistes est héritière. Néanmoins, on trouve dans le corpus écoféministe des ressources plus positives pour penser à nouveau frais l'intérêt d'une référence à la nature sauvage dans le contexte contemporain, notamment dans les analyses que Val Plumwood ou Carolyn Merchant proposent ou dans certaines formes de "réclamations" féministes de l'expérience de la nature sauvage. Il s'agira donc d'esquisser les contours d'un ré-ensauvagement qui soit en mesure d'esquiver les critiques féministes de la préservation de la nature sauvage et qui offre une base politique convaincante pour repenser la conservation de la nature.
Virginie Maris est chercheuse au CNRS. Elle travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE – UMR 5175) à Montpellier en philosophie de l'environnement. Ses travaux portent sur les enjeux épistémologiques et éthiques de la protection de la nature. Elle est l'autrice de nombreux articles scientifiques sur la biodiversité, l'écoféminisme, les espèces non-indigènes, l'économie environnementale, les services écosystémiques ou la compensation écologique. Elle a publié Nature à vendre — les limites des services écosystémiques (Quae, 2014), Philosophie de la biodiversité — petite éthique pour une nature en péril (2de éd. Buchet-Chastel, 2016) et La part sauvage du monde — penser la nature dans l’Anthropocène (Seuil, 2018).
Pascal MARTY : "Nous avons toujours été sauvages" : dynamiques des paysages ruraux
Si on accepte de définir "le sauvage" dans les paysages comme la permanence et l'expression de processus naturels de dynamiques de populations animales et végétales non domestiques, on peut défendre l'idée que les paysages ruraux possèdent à toutes les époques une part de sauvage. Ce qui varie au cours du temps est la place que les groupes humains accordent aux différentes composantes du sauvage dans le paysage. En fonction des pratiques d'utilisation des sols, des orientations des systèmes de production agricole et des préférences exprimées par les groupes usagers, le sauvage trouve des expressions variées dans le paysage. Cette proposition sera illustrée par l'exemple des transformations de paysages dans le cas d'une dynamique majeure dans l'espace européen : la progression spontanée des espaces forestiers.
Pascal Marty est professeur de géographie de l’environnement. Ses recherches, à la charnière entre géographie et écologie, explorent les interactions entre les dynamiques spontanées des écosystèmes — "le sauvage" — et les transformations et usages de l'espace par les sociétés humaines. Professeur à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, il est en ce moment détaché au CNRS et directeur de la Maison Française d'Oxford (Royaume-Uni).
Raphaël MATHEVET : Écologie et zoopolitique du sauvage
En prenant pour exemple l'histoire du sauvetage du flamant rose (Phoenicopterus roseus) et celle du développement des populations de sangliers (Sus scrofa) en France, nous interrogerons l'état de nos relations à la nature et à la faune sauvage, que celle-ci soit protégée ou gibier. Cette communication propose d'examiner les efforts déployés pour préserver ou exploiter ces espèces et montre comment ces dernières restent rebelles aux frontières arbitraires auxquelles les humains tentent de les assigner et rebattent les cartes de l'aménagement du territoire. Ce faisant elles nous invitent à repenser les politiques et pratiques de gestion de la nature face aux changements et à questionner le grand partage, au-delà du sauvage et de l'artifice. Entre géopolitique locale et zoopolitique globale, nous proposons de redéfinir le régime gestionnaire dominant et les conditions de coexistence avec le reste du vivant pour esquisser une écologie du sauvage.
Raphaël Mathevet est directeur de recherche au CNRS au Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive de Montpellier. Écologue et géographe, il s'intéresse aux relations Homme/Nature et particulièrement à la gestion intégrée de la biodiversité et des espaces protégés, aux approches de modélisation participative et de gestion adaptative des territoires. Il est l'auteur notamment de La solidarité écologique. Ce lien qui nous oblige (2012) ; Résilience & Environnement : penser les changements socio-écologiques (2015 avec F. Bousquet) ; Politiques du flamant rose. Vers une écologie du sauvage (2020 avec A. Béchet) et Sangliers : géographies d'un animal politique (2023 avec R. Bondon).
Loïs MOREL : Que dire des friches et des forêts férales ? Récits naturalistes de la déprise agricole
C'est un cas d'école en biologie de la conservation : écologues, naturalistes ou encore gestionnaires peinent à s'accorder sur l'intérêt écologique des friches agricoles dans les paysages ruraux. Le même processus, la déprise agricole, peut ainsi aussi bien être décrit, exemples et théories à l'appui, comme une menace ou comme une opportunité pour la conservation de la diversité biologique. À partir de ce constat, que l'on cherchera à resituer dans un contexte historique et sociologique, et de plusieurs exemples concrets, on s'interrogera sur ces récits écologiques qui semblent s'opposer et qui pourtant s'intéressent à un même processus, celui de la dé-domestication de certains territoires ruraux.
Loïs Morel est écologue et naturaliste. Enseignant-chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers, il s'intéresse aux changements de biodiversité induits par l'anthropisation des paysages et des habitats, en particulier dans les environnements forestiers et bocagers de l'Europe de l'Ouest. Il a notamment travaillé sur les dynamiques de recomposition des communautés d'espèces dans les friches et les forêts récentes post-déprise agricole.
Joëlle SALOMON CAVIN : La faune non désirée de la ville
Rats, cafards, pigeons, punaises de lit, etc. constituent une faune intimement liée aux villes, mais avec laquelle beaucoup de citadins préféreraient ne pas coexister, surtout dans l'intimité de leur foyer. Souvent qualifiés d’indésirables, de nuisibles ou de pestes, ces animaux définissent le contour d'une "autre" nature urbaine : non ou peu désirée, sauvage en ce qu'elle échappe en grande partie au contrôle et parfaitement adaptée à l'environnement artificiel des villes.
"Indésirables !?" est un projet muséographique et éditorial dont l'objectif est de communiquer avec le public sur cette animalité dérangeante des villes. Trois perspectives y sont croisées : celle des citadins qui doivent cohabiter avec cette faune, celle des animaux eux-mêmes qui ont fait de la ville leur écosystème, celle des gestionnaires urbains et des désinfestateurs qui développent des solutions pour réguler leur présence.
Joëlle Salomon Cavin est géographe à l'université de Lausanne. Ces travaux portent sur les relations ville-nature/ville-campagne. Elle a publié des ouvrages consacrés à la ville mal-aimée : Antiurbain. Origines et conséquences de l'urbaphobie (avec Bernard Marchand, 2010 - Colloque de Cerisy), le rapport à la ville des sciences naturelles : Quand l'écologie s'urbanise (avec Céline Granjou, 2021) et, récemment, à l'animalité dérangeante des villes : Indésirables !? les animaux mal-aimés de la ville (2022).
Charles STÉPANOFF : Les deux visages du sauvage
La civilisation paysanne est-elle fondée, comme on le dit souvent, sur une guerre du monde domestique contre le monde sauvage ? Les données archéologiques et ethnographiques livrent un tableau bien différent. En pénétrant en Europe, le Néolithique crée des formes originales d'hybridation sauvage-domestique parmi les espèces, les paysages et les cosmologies. Jusqu'à l'époque industrielle, l'autonomie paysanne exige une diversité de ressources locales qui entrelacent le sauvage et le domestique dans un continuum. En supprimant les zones intermédiaires de saltus (jachères, landes, haies, marais), la modernisation agricole entraîne un divorce domestique-sauvage. À l'heure de la 6e extinction de masse, nous n'assistons pas à une résurgence du sauvage en Europe, mais à un démantèlement d'écosystèmes hybridés qui étaient source à la fois d'autonomie pour les communautés locales et d'habitat pour une multitude d'espèces.
Charles Stépanoff est anthropologue spécialiste des relations humains-environnements. Il mène des enquêtes de terrain en Sibérie et en France. Il a publié Voyager dans l'invisible. Techniques chamaniques de l'imagination (2019) et L'animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage (2021).
Jacques TASSIN : Maurice Genevoix : natures pensées, natures sensibles
Enfant voué aux rivages de la Loire, intellectuel sorti major de la rue d'Ulm, puis devenu grand mutilé des tranchées, résolument libéré de toute école et de toute chapelle, Maurice Genevoix fut rendu aux rivages d'une Loire natale libre qui devint son écritoire. Cet écrivain avait le goût inné de l'immersion du corps et de l'âme dans ce que Novalis nommait la "communauté merveilleuse" du vivant. La poésie fut sa quête, elle-même mue par un sentiment panique du monde, par la sensation d'une harmonie diffuse liant d'emblée le simple et le poète aux autres êtres, sans discontinuité aucune. Ainsi naquirent Raboliot, La grande harde ou La forêt perdue. Le domestique et le sauvage y entretissent une même étoffe vivante où l'humain prend place à son tour, selon une grâce qui toutefois se mérite. Un peu chamane, Genevoix témoigne d'une rare aptitude à l'émerveillement face au vivant, quel qu'il soit et sous quelque forme qu'il se présente, au-delà de toute représentation mentalisée de la nature.
Jacques Tassin est ingénieur en horticulture et en agronomie tropicale, docteur en écologie, chercheur au CIRAD et membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France. Scientifique et littéraire, il défend une approche transdisciplinaire du vivant et promeut une écologie consentant à la préséance du sensible sur nos représentations mécanistes usuelles. L'arbre et l'oiseau sont ses intercesseurs privilégiés. Il est l'auteur de À quoi pensent les plantes ? (2016), Penser comme un arbre (2018), Pour une écologie du sensible (2020), Je crois aux arbres (2021) et Écoute les voix du monde (2023). Il est également biographe de Maurice Genevoix et a consacré plusieurs livres à l'analyse de son œuvre, dont Maurice Genevoix l'écologiste (2020).
Les falaises littorales de Carolles et Champeaux — Conservatoire du littoral
Situées face à la baie du Mont Saint-Michel, ces falaises de 60 à 80 m accueillent une grande diversité biologique et font partie des sites d'intervention du Conservatoire du littoral. À ce jour, elles bénéficient d'un plan de gestion qui guide les orientations d'aménagement et de gestion en vue de la protection du patrimoine naturel et paysager du site. Tandis que le sentier des douaniers parcourt le site et qu'une partie continue à être exploitée d'un point de vue agricole, la question du ré-ensauvagement de certaines parcelles inusitées s'est invitée dans les débats entre locaux et gestionnaires à l'occasion du dernier renouvellement du plan de gestion des falaises…
La grande Noé (bois de pente et ancienne carrière) — CEN Normandie
Propriété du Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, ce site naturel de 30 ha est marqué par l'exploitation humaine à plus d'un titre : ancienne lande pacagée, ancienne carrière de grès armoricain… Et pourtant aujourd'hui après un abandon de plus de 30 ans, cet espace naturel abrite une biodiversité rare ayant justifié l'intérêt de l'association pour sa sauvegarde. Au travers du récit de cette protection, nous partirons à la découverte des richesses biologiques cachées, de l'histoire paysagère du site et des choix parfois cornéliens auquel le gestionnaire de milieu naturel est confronté.
BIBLIOGRAPHIE :
• Christian Barthod, Jean-Luc Dupouey, Raphaël Larrère & François Sarrazin (éds.), Revue Forestière Française 2-3, Des forêts en libre évolution, 2021.
• Guillaume Blanc, Elise Demeulenaere & Wolf Feuerhahn, Humanités environnementales - Enquêtes et contre-enquêtes, Paris, Publication de la Sorbonne, 2017.
• Patrick Blandin, De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité, Éditions Quae, Paris, 2009.
• Cain Blythe & Paul Jepson, Réensauvager la nature pour sauver la planète, Presses universitaires de l'EPFL, Lausanne, Suisse, 2022 (traduction).
• John Baird Callicott & Michael P. Nelson (éds.), The Great New Wilderness Debate, Athens and London, The University of Georgia Press, 1998.
• John Baird Callicott & Michael P. Nelson (éds.), The Wilderness Debate Rages on, Athens and London, The University of Georgia Press, 2008.
• Gilles Clément, Manifeste du Tiers Paysage, Éditions du Commun, Paris, 2004.
• Charles Clover, Rewilding the sea : how to save our oceans, Ebury Publishing, Londres, 2022.
• Gilbert Cochet & Béatrice Kremer-Cochet, L'Europe réensauvagée - Vers un nouveau monde, Arles, Babel, 2022.
• L'avenir du vivant - Nos valeurs pour l'action, Paris, Comité Français de l'UICN, 2021.
• Philippe Descola, "Le sauvage et le domestique", in Sophie Bobbé (éd.), Les nouvelles figures du sauvage, Communications, n°76, 2004, pp. 17-39.
• Thierry Dutoit & al., Restaurer ou laisser faire la nature, Courrier de la Nature, n°301, 2017.
• Jean-Claude Génot, Nature : le réveil du sauvage, L'Harmattan, Collection "Antidotes", 2017.
• Jean-Claude Génot & Annik Schnitzler, La nature férale ou le retour du sauvage, Éditions Jouvence, Collection "Jouvence Nature", 2020.
• Catherine Larrère & Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique, Paris, La Découverte, 2018.
• Raphaël Larrère, "La nature férale - Milieux de l'entre-deux du sauvage et du domestique", in Multitudes, n°86, 2022, pp. 225-229.
• Aldo Léopold, Almanach d'un comté des sables, Flammarion, 2017.
• Alexandra Locquet, Born to be wild ? Représentations du sauvage et stratégies de protection de la Wilderness en Europe, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, Paris, 2021.
• Rémi Luglia (éd.), Sales bêtes et mauvaises herbes ! "Nuisible", une notion en débat ?, Presses universitaires de Rennes, 2018.
• Virginie Maris, La part sauvage du monde, Paris, Seuil, 2018.
• Raphaël Mathevet & Arnaud Béchet, Politiques du Flamant rose - Vers une écologie du sauvage, Marseille, Wildptoject, 2020.
• Raphaël Mathevet & Roméo Bondon, Sangliers - Géographies d'un animal politique, Arles, Actes sud, 2022.
• George Monbiot, Feral : Searching for Enchantment on the Frontiers of Rewilding, Penguin Books, Londres, 2013.
• Serge Morand, L'homme, la faune sauvage et la peste, Paris, Fayard, 2020.
• Loïs Morel, De la ruralité à la féralité : dynamique de recomposition des facettes taxonomique, fonctionnelle et phylogénétique des communautés d'espèces lors des processus de reboisement spontanés, Museum national d'histoire naturelle, 2018.
• Baptiste Morizot, Les diplomates – Comment cohabiter avec les loups sur un autre carte du vivant, Marseille, Wildproject, 2016.
• Baptiste Morizot, Raviver les braises du vivant : un front commun, Marseille, Wildptoject (et Arles, Actes sud), 2020.
• Henrique M. Pereira & Laetitia M. Navarro (éds.), Rewilding European Landscapes, Springer, 2015.
• Annick Schnitzler & Jean-Claude Génot, La France des friches - De la ruralité à la féralité, Versailles, Quæ, 2012.
• Charles Stepanoff, L'animal et la mort, Paris, La Découverte, 2021.
• Jacques Tassin, Pour une écologie du sensible, Paris, Odile Jacob, 2020.
• François Terrasson, La peur de la nature, Sang de la Terre, 2007.
• Isabella Tree, Le réensauvagement de la ferme à Knepp, Actes Sud, 2022 (traduction).
• Joëlle Zask, Zoocities - Des animaux sauvages dans le ville, Paris, Premier Parallèle, 2020.
SOUTIENS :
• Office français de la biodiversité (OFB)
• Région Normandie
• Comité Français de l'UICN
• Fondation Lemarchand