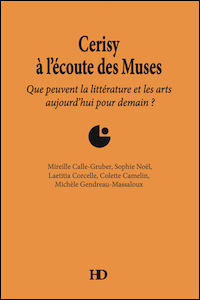RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
Corine PELLUCHON : Résonance et démocratie
L'un des legs de la première génération de la Théorie critique, qui a vécu l'avènement du nazisme, est de s'interroger sur les causes qui expliquent que les individus soient perméables aux solutions autoritaires et totalitaires du politique. Mais aucun des théoriciens de l'École de Francfort ne s'est borné à établir un diagnostic. Ils ont tous cherché des remèdes à la déshumanisation de la société afin de lutter contre les risques de liquidation de la civilisation qui témoignent des contradictions de la modernité, de son incapacité à créer les conditions du projet d'émancipation individuelle et collective qu'elle promettait. Ainsi, le diagnostic établi par Hartmut Rosa dans Accélération permet d'analyser les formes nouvelles que revêt l'aliénation dans la modernité tardive. Identifiant les pathologies de la société qui s'ensuivent de la perte de sens consécutive à l'accélération (technologique, du changement social et des rythmes de vie), il imagine des contrepoids à la fragmentation de la société et à la désynchronisation entre l'économie et la politique. Ces phénomènes érodent le désir de vivre-ensemble et génèrent des frustrations liées au sentiment d'impuissance et à une colère à l'endroit des représentants politiques accusés de ne pas répondre aux problèmes sociaux (de manière suffisamment rapide et efficace). Autrement dit, le diagnostic porté par H. Rosa sur le malaise social tel qu'il est vécu de nos jours signifie que la démocratie est exposée à des risques majeurs, y compris en Europe. C'est pour remédier à cette situation que H. Rosa, opérant une greffe de la phénoménologie sur la sociologie mais travaillant toujours à l'intersection entre les structures de la subjectivité et les structures sociales et économiques, propose sa théorie de la résonance. Tout en soulignant la pertinence et la fécondité de cette théorie quand on se place à un niveau local ou qu'on l'applique au travail, à la médecine ou à la pédagogie, nous soulèverons les problèmes que suscite l'idée d'une démocratie résonante. S'il est fondamental de concevoir une énergie sociale qui rassemble les êtres, au lieu d'exacerber leurs divisions, l'objection classique faite à Hartmut Rosa, à savoir que la résonance pensée à l'échelle d'un peuple et même l'idée d'une énergie sociale ayant une vertu dynamogénique (pour parler comme Durkheim) pourraient être récupérées par les mouvements nationalistes, a du sens. Ce questionnement, qui ouvrira sur un dialogue avec Hartmut Rosa, sera l'occasion de rappeler ses sources et de mettre au jour certains aspects de la sensibilité du sociologue, en soulignant notamment le rôle que joue le romantisme dans son œuvre. Nous ferons quelques propositions attestant une sensibilité différente, marquée par la prise en compte de la destructivité humaine et par la nécessité d'offrir des ressources individuelles et collectives permettant d'éduquer à la démocratie en considérant l'ambivalence de l'humain.
Corine Pelluchon est professeure à l'université Gustave Eiffel. Spécialiste de philosophie morale et politique et d'éthique appliquée (médicale, animale et environnementale), elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages, traduits pour la plupart dans plusieurs langues. Tout en s'inscrivant dans l'héritage des Lumières et de la phénoménologie, elle développe une philosophie de la corporéité qui insiste sur notre vulnérabilité et notre dépendance à l'égard de la nature et des autres vivants et en montre les implications sur le plan éthique, juridique et politique. Elle a reçu, en Allemagne, le Prix Günther Anders de la pensée critique pour l'ensemble de ses travaux en 2020 et, en 2025, le prix Leopold Lucas, décerné par l'université de Tübingen.
Derniers ouvrages parus
Les Lumières à l'âge du vivant, Seuil, 2021, 2022.
L'espérance, ou la traversée de l'impossible, Rivages, 2023.
L'être et la mer. Pour un existentialisme écologique, PUF, 2024.
La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, Rivages, 2025.
Dietmar WETZEL : Quand les voix touchent : réflexions sociologiques sur la résonance de la voix
L'auteur développe une réflexion sociologique et phénoménologique sur la voix comme phénomène de résonance. La voix n'est pas réductible à un simple instrument physiologique ou à un vecteur linguistique : elle constitue un espace liminal où se nouent corps, langage, affects et relations sociales. À partir des travaux de Mladen Dolar, Hartmut Rosa et Hans-Ulrich Gumbrecht, l'auteur montre que la voix crée des espaces de résonance individuels et collectifs, porteurs d'intensité, de vitalité et de sens. Elle exprime les humeurs et émotions (sympathie, joie, tristesse, peur) et relie ainsi subjectivité et monde social. Les voix rassemblées, notamment dans le chant choral ou dans les foules, illustrent la dimension communautaire et politique de la voix, capable de produire proximité, synchronisation et polyphonie démocratique, mais aussi de nourrir propagande et manipulations. La conclusion insiste sur l'ambivalence de la voix : elle forge l'identité et ouvre des horizons relationnels, tout en étant menacée par la reproductibilité technique et les usages instrumentalisés. Elle reste néanmoins un organe central de résonance, à la fois intime, social et politique.
Dietmar J. Wetzel est Professeur de Sciences Sociales et Directeur du Département de Pédagogie depuis 2019 à la MSH Medical School de Hambourg. Il est chargé de cours à l'université de Bâle et à la ZHAW de Winterthur.
Publications
Affektregister der Gegenwart - soziologisch-philosophische Reflexionen, Wiesbaden, Springer VS, 2025.
Handbuch Sozialwissenschaftliche Resonanzforschung (Co-éditeur), Wiesbaden, Springer VS, 2025.
Arthur BUENO : Résonance et révolution
La relation entre résonance et révolution est loin d'être évidente. La théorie de Hartmut Rosa élargit la critique marxienne du capitalisme tout en visant à transformer les conditions de la modernité par une révolution simultanée et concertée au niveau politique, économique et culturel. Cependant, sa théorie de la résonance invite également à une certaine prudence à l'égard des aspects fondamentaux des approches marxistes de l'émancipation sociale. En effet, l'accent que Rosa place sur la réceptivité et l'indisponibilité des relations résonantes au monde contraste avec l'importance accordée, dans les théories révolutionnaires, à l'action et au contrôle. De plus, la résonance démocratique, en tant que mode de stabilisation "adaptatif", s'oppose à l'antagonisme qui est associé aux relations au monde "répulsives" et qui joue un rôle crucial dans la conception marxiste du changement social. Ainsi, une lutte pour la résonance pourrait sembler contradictoire : les moyens mobilisés (action, conflictualité) risquent de compromettre les finalités poursuivies (réceptivité, indisponibilité et adaptation). Pourtant, je défendrai l'idée selon laquelle le concept de résonance est politiquement compatible avec les luttes pour une transformation de la société et même qu'il leur est intrinsèquement lié. En revisitant l'analyse de Georg Lukács sur la conscience révolutionnaire à travers le prisme de la théorie de H. Rosa, il devient possible de montrer que les relations résonantes au monde émergent des luttes collectives contre l'aliénation.
Arthur Bueno est maître de conférences à l'université de Passau, affilié à l'université Goethe de Francfort et à l'université de São Paulo. Ses recherches portent sur la théorie sociale et la théorie critique. Il examine les déterminants sociaux et les implications politiques des formes de subjectivité. Il est vice-président de la Georg Simmel Gesellschaft et président du comité RC35 de l'Association internationale de sociologie.
Publications
Bueno, A., "Doing Away with the Spectre of Regression : Adorno and the Paradox of Authoritarianism", Critical Horizons : A Journal of Philosophy and Social Theory (à paraître).
Bueno, A., "The End (and Persistence) of Subjectivity : Lukács with Adorno, Adorno with Lukács", Distinktion : Journal of Social Theory, vol. 25, n°3, 2024, p. 435-454.
Bueno, A., Teixeira, M. et Strecker, D. (éds.), De-Centering Global Sociology : The Peripheral Turn in Social Theory and Research, Londres, Routledge, 2022.
Rosa, H., Henning, C. et Bueno, A. (éds.), Critical Theory and New Materialisms, Londres, Routledge, 2021.
Paul D'AMBROSIO : La résonance comme retour. Discussions sur l'ancrage de la théorie de Rosa et son concept d'authenticité [Resonance as Returning : Engaging with Hartmut Rosa Beyond Authenticity]
Hartmut Rosa plaisante souvent, quand il parle en anglais, en disant qu'il aime utiliser les "trois A" dans son travail. Par exemple, il utilise les termes "available" (disponible), "attainable" (réalisable) et "accessible" (accessible) comme thèmes centraux de sa théorie de l'accélération. Ces A caractérisent la société contemporaine. Sa solution introduit un R, à savoir la résonance. Cependant, il s'appuie sur un fondement philosophique d'authenticité ("authenticity"). Ainsi, un autre mot commençant par A a envahi l'espace où les R devraient dominer. Que se passe-t-il si on met les A de côté et que l'on remplace la résonance basée sur l'authenticité ("authenticity-based resonance") par une résonance basée sur le retour ("returning-based resonance") ? Tel est l'objectif que je poursuis ici en montrant que H. Rosa a a sous-estimé l'importance des profils et qu'il s'appuie surtout sur une théorie de l'authenticité pour comprendre les individus. De même, si, dans sa théorie de la résonance, H. Rosa indique que la première étape est "l'affection", c'est-à-dire que quelque chose qui "nous touche de l'extérieur", il indique que la deuxième étape est la réponse du sujet (auto-efficacité, puis le fait qu'il fasse entendre sa "propre voix"), tandis que la troisième étape implique la transformation significative de la personne. Or cette description soulève des problèmes qui ont trait à l'authenticité. En présentant une approche inspirée de la pensée taoïste classique, je présenterai une théorie différente de la résonance, basée sur la reconnaissance de notre interconnexion avec le tout.
Paul J. D'Ambrosio enseigne la philosophie chinoise à East China Normal University à Shanghai, China, où il est aussi directeur du ECNU's English-language MA et du programme doctoral et chair du centre interculturel. Il est l'auteur avec Hans-Georg Moeller de You and Your Profile (Columbia University Press, 2021), Genuine Pretending (CUP 2017) et éditeur avec Michael Sandel de Encountering China : Michael Sandel and Chinese Philosophy (Harvard University Press, 2018).
Christophe FRICKER : Pouvons-nous rendre nos étudiants heureux ? Une pédagogie "résonante" entre la bureaucratie universitaire et la salle d'apprentissage
La pédagogie de la résonance est l'application aux salles de cours de la théorie du même nom. Elle pose que l'apprentissage est à la fois plus agréable et plus efficace dans le cadre de relations résonantes. Or, puisque la résonance ne saurait être manufacturée, ni les professeurs, ni les élèves, ni surtout les administrations d'université ne peuvent avoir la certitude que les objectifs visés seront effectivement réalisés. Dans cette intervention, je proposerai tout d'abord un tour d'horizon d'initiatives d'universités actuelles cherchant à donner l'impression, problématique, que le succès dans les études peut être garanti. J'analyserai les moyens que les pédagogues, que ce soit à l'échelle individuelle et quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ont d'affirmer leur agentivité et d'accéder par là à l'auto-efficacité, qui est le préalable de la résonance. Dans un second temps, j'examinerai si celle-ci a davantage de chances d'advenir si l'on cesse de traiter, à l'instar de nombreuses institutions d'aujourd'hui, élèves et personnels universitaires comme deux corps disjoints. J'envisagerai les perspectives prometteuses offertes par la co-conception et prendrai l'exemple de l'évaluation, qui est un aspect de l'éducation supérieure particulièrement conflictuel et souvent démoralisant pour les personnes impliquées. Enfin, en m'appuyant sur des données empiriques et quantitatives, je défendrai l'idée selon laquelle la résonance trouve ses catalyseurs moins dans les politiques institutionnelles ou dans l'expression d'une "voix étudiante" que chez les enseignants eux-mêmes.
Christophe Fricker est professeur associé en allemand et en traduction à l'université de Bristol, Fellow de la Higher Education Academy et Associate du Bristol Institute for Learning and Teaching. Il formule des recommandations méthodologiques en pédagogie de la résonance à destination des universités. Il enseigne aux côtés d'Hartmut Rosa dans le cadre d'écoles d'été de la Deutsche SchülerAkademie depuis 2014 et il est le traducteur en anglais de certains de ses essais parmi les plus influents.
Bettina HOLLSTEIN : La résonance et l'engagement bénévole pour le développement durable
Le développement durable est une nécessité que les nations du monde ont bien compris. Le programme 2030 pour le développement durable avec ses 17 objectifs (SDG) a été signé par 193 nations en 2015 et, depuis les années 1970, les scientifiques ne cessent d'alerter sur les problèmes écologiques, sociaux et économiques qui sont directement liés à notre façon de vivre dans le monde moderne pris dans une accélération globale. Pour Hartmut Rosa, l'accélération concerne le développement technique et économique, les changements sociaux et les rythmes de vie, c'est-à-dire qu'il touche aussi le niveau individuel, ce qui génère stress et dépression. Cependant, comprendre la nécessité de changer notre façon de vivre dans le sens d'un développement durable ne suffit pas à nous motiver à agir en ce sens. La théorie de la résonance de Hartmut Rosa peut nous aider à résoudre ce problème. Je parlerai des moments de résonance que des personnes éprouvent quand elles s'engagent bénévolement pour des projets qui leur sont chers ; elles se sentent appelées à agir et répondent à cet appel. La résonance change les personnes qui en font l'expérience. Mais comme elle reste imprévisible et ne peut pas être commandée, on peut se demander quel est son impact réel sur le plan écologique. M'appuyant sur des observations empiriques, je me demanderai si une expérience de résonance peut changer les habitudes individuelles et comment. Je confronterai la théorie de H. Rosa avec celle de John Dewey pour réfléchir à la relation entre le fait d'apprendre et la transformation de soi.
Bettina Hollstein est professeure à l'université d'Erfurt et responsable du management du Max-Weber-Kolleg. Elle travaille sur l'éthique économique et s'intéresse en particulier à la théorie pragmatiste de l'action, qu'elle étudie en réfléchissant notamment au bénévolat et au développement durable.
Publications
Hollstein, B., Rosa, H., Rüpke, J. (éds.), "Weltbeziehung". The Study of our Relationship to the World, Frankfurt/New York, Campus 2023.
"Learning by Doing' in Higher Education. Empirical Insights into Education for Sustainable Development", in RIAEE, Araraquara v, 19, n. esp. 1, 2024. p. 1-26 (with João Tziminadis and Pia Schrage).
Klaas HUIZING : Heavy metal : la situation clé
La théologie s'inspire volontiers d'autres disciplines — traditionnellement de la philosophie et désormais de la psychologie, de la sociologie, de la politologie, de la littérature, des sciences de l'image, etc. — pour penser le phénomène religieux. Actuellement, le sociologue Hartmut Rosa compte parmi les auteurs les plus appréciés en théologie. Dans son opus magnum Resonanz, il place (encore) la religion primo loco sur l'axe vertical de résonance. Je voudrais plaider ici pour un changement de regard. Ce n'est pas le livre Resonanz, ni l'ouvrage Demokratie braucht Religion qui me sert ici de référence, mais l'ouvrage que Rosa a écrit avec son cœur : When Monsters roar and angels sing. Une petite sociologie du heavy metal. Dans ce livre, Rosa travaille sur les notions de sacré sans nommer explicitement Rudolf Otto. Le heavy metal devient un modèle idéal de "peak experiences" qui interrompent la réification, et fait un pied de nez à l'industrie culturelle. À partir de là, il faudra se demander quel est le rapport entre ces expériences extraordinaires et les autres expériences de résonance. Dans le monisme normatif de Rosa, n'y a-t-il pas une gradation entre les petites transformations et la grande transformation qui crée une orientation plus fondamentale propice à la vie ?
Klaas Huizing, théologien nééerlandais, romancier, professeur et docteur, occupe la chaire de théologie systématique et d'éthique à l'université de Würzburg. Il est membre, en tant qu'écrivain, du PEN Club.
Dernières publications
Scham und Ehre. Eine theologische Ethik, Gütersloh, 2022.
Lebenslehre. Eine Theologie für das 21. Jahrhundert, Gütersloh, 2025.
Das Testament der Kühe, Roman, Tübingen, 2020.
Rosa Marie KELLER : Décrypter le paradoxe de la résonance en temps de crise politique
Les démocraties du XXIe siècle sont confrontées à des contraintes croissantes alimentées par de multiples crises économiques, écologiques et géopolitiques, et elles se heurtent au désenchantement du public à l'égard de la politique et à la montée en puissance des partis nationalistes. Il importe d'examiner les réponses adéquates à ces crises et de s'interroger sur les ingrédients majeurs qui peuvent rendre les démocraties résilientes. En m'inspirant des concepts d'aliénation et de résonance propres à Hartmut Rosa, je présenterai les résultats d'une recherche empirique à méthodes multiples qui explore la démocratie allemande en s'appuyant sur les représentations sociales. Il s'agira de discuter les résultats qui soulignent le rôle que joue la polyphasie cognitive dans la résilience démocratique. La polyphasie cognitive conceptualise un état dans lequel un individu conserve et utilise plusieurs systèmes de connaissances pour donner un sens à un objet social donné. Les résultats des recherches empiriques montrent que la résilience démocratique est plus forte chez les individus qui ont simultanément des représentations aliénées et résonnantes de la démocratie sans avoir besoin de tomber dans l'un ou l'autre camp. Au contraire, les individus aliénés et indifférents dont les représentations affichent des logiques de dissonance cognitive tombent dans un certain désenchantement et se coupent de la démocratie. L'objectif est d'examiner les implications potentielles de ces résultats à la fois sur le plan pratique (éducation démocratique, activisme et valeurs) et sur le plan théorique, en remettant en question conceptuellement la dichotomie des concepts d'aliénation et de résonance de Hartmut Rosa. Il convient de prendre au sérieux les implications du "paradoxe de la résonance", où les individus les plus résonnants par rapport à la démocratie sont peut-être ceux qui ont des représentations polyphasiques, englobant simultanément la résonance et l'aliénation, ce qui fait de la capacité de polyphasie cognitive une caractéristique majeure de la résilience démocratique au XXIe siècle.
Rosa Marie Keller est Doctorante à l'université Friedrich-Schiller-Universität Jena (sous la direction de H. Rosa) et à l'Institute of Sociology & London School of Economics and Political Science, Department of Psychological and Behavioural Science.
Jürgen OBERSCHMIDT : Concept - idée - métaphore - phénomène. Découvrir la résonance dans les pratiques musicales
À la question de savoir ce qu'est en fait un chef d'orchestre, Sergiu Celibidache a répondu un jour : "Derrière tout chef d'orchestre se dissimule un dictateur qui se contente, fort heureusement, de la musique". Nous nous retrouvons face à cette dualité diriger/se laisser guider dès les premiers stades de l'apprentissage de la musique. En effet, dans les cours de violon, par exemple, on nous enseigne la tenue de l'archet et nous apprenons comment phraser un thème puis produire différents timbres : "On attend souvent de l'apprenti qu'il intériorise la leçon du maître par osmose, pour ainsi dire. Le maître montre comment réussir quelque chose et l'apprenti doit trouver où est la clé" (Richard Sennet). Ainsi, le chef d'orchestre, tel un artisan, façonne le son collectif, guidant chaque instrumentiste vers une interprétation commune. Il s'agit avant tout de créer une harmonie finale. Quelles conséquences faut-il tirer de telles conceptions de la pratique musicale pour l'enseignement de la musique ? Comme Andreas Gruschka l'a dit en parlant du topos de la "froideur bourgeoise", entraîner les enfants en les dressant reflète une éthique de l'apprentissage qui est "comme le résultat de pressions sociales reproductives" profondément ancrées dans notre système éducatif. Or, si nous voulons répondre par la musique et l'enseignement de la musique aux discours sociaux et politiques qui s'imposent à nous, nous pourrions nous inspirer de Daniel Barenboïm, pour qui la pratique et la réception de la musique sont liées à des procédés de mise en accord et à tout un ensemble de représentations individuelles : "La partition d'une grande œuvre contient de nombreuses "solutions"". Ainsi, les auditeurs et les musiciens prennent part à un événement de résonance.
Jürgen Oberschmidt est professeur de musique et de didactique à l'université pédagogique de Heidelberg. Après des études à l'université de Musique, Théâtre et Médias de Hanovre, il a travaillé comme professeur de musique et d'allemand dans une école secondaire de Rhénanie du Nord-Westphalie et comme professeur de formation à l'université de Kassel. Il est président de la Société internationale Leo Kestenberg, du New Music Network Baden-Württemberg et président de l'Association fédérale pour l'éducation musicale (BMU).
Publications
Oberschmidt, Jürgen (2024), "Plädoyer für eine Rückkehr des Staunens. Gedanken über Musikunterricht in einer verwunderungsfreien Schule", in Heiner Gembris, Bianca Maria Herbst, Sebastian Herbst & Kristin Sander-Steinert (Hg.), Musik erleben - erforschen - vermitteln. Begegnungen mit Thomas Krettenauer, Münster, LIT., p. 89-107.
Oberschmidt, Jürgen (2023), "Resonanz. Musikpädagogische Überlegungen zu einem vielstimmig-schillernden Begriff", in Georg Biegholdt, Martina Benz, Jürgen Oberschmidt (Hg.), Resonanz. Tagungsband zum 5. Bundeskongress Musikunterricht in Mannheim, Mainz, Schott, p. 6-19.
Oberschmidt, Jürgen (2022), "Musik(-unterricht) zwischen Divertimento und Etüde. Über das Spannungsverhältnis zwischen fremdgesteuertem Anpassungsdruck, musikimmanenten Steigerungsstrategien und kontemplativen Zugängen", in Andrea Ellmeier u. Doris Ingrisch (Hg.), Muße, Musen und das Müssen. Wissen und Geschlecht in Musik - Theater – Film, Wien, Köln, Böhlau Verlag, p. 103-123.
Maximilien PRIEBE : La subjectivité face aux apories modernes : réévaluer la théorie de l'accélération sociale via le prisme du surmenage cognitif
Il s'agit d'examiner la théorie de l'accélération sociale de Hartmut Rosa qui est majeure pour comprendre une aporie centrale de la modernité, à savoir la nécessité paradoxale de ne pouvoir se stabiliser que "dynamiquement", c'est-à-dire de ne pouvoir garantir l'ordre que par une logique d'augmentation continue. Dans ce contexte, une dichotomie conceptuelle sera remise en question : celle de "l'accélération" et de "l'aliénation". Pour Rosa, ces deux concepts sont complémentaires dans la mesure où chaque accélération sociale comporte des risques d'aliénation que seul un rapport résonant au monde peut surmonter. Je propose de prendre du recul par rapport à cette constellation de concepts pour m'interroger sur ce qu'il advient de l'approche explicative de Rosa quand on remplace la ligne théorique de l'aliénation — de Marx, de Weber et de Taylor — par des présupposés plus orientés vers les sciences culturelles, en éclairant, par exemple, sa sociologie par l'héritage de Georg Simmel. Ainsi, l'accent sera mis sur cette décompensation de la subjectivité — que Simmel décrit comme "tragédie de la culture" — qui consiste en un surmenage avant tout cognitif du sujet face à un débordement dû à la complexité du monde. On ne peut déduire que dans un deuxième temps que cette forme de déracinement spirituel est une aliénation généralisée. De cette manière, envisager une "sociologie du rapport au monde", non seulement à travers des relations corporelles, affectives et existentielles, mais aussi dans ses dimensions épistémiques et cognitives, pourrait permettre, par un recours critique à l'appareil conceptuel de Rosa, de trouver de nouvelles réponses aux problèmes auxquels font face les individus dans les "sociétés du savoir" contemporaines (surcharge informationnelle, difficultés d'orientation ou perte des connaissances générales).
Maximilian Priebe est doctorant à la chaire de sociologie générale et théorique de l'université d'Iéna, sous la direction de Hartmut Rosa. Il a obtenu un master en histoire et théorie politique de l'université de Cambridge ainsi qu'un master en philosophie sociale de l'EHESS, Paris. Dans ce cadre, il s'est notamment intéressé aux réactions philosophiques aux problèmes de la division du travail. Son projet de recherche porte sur le surmenage du sujet moderne.
Publications
"Edgar Morin – Kosmologe der Komplexität. Porträt eines transdisziplinären Intellektuellen", Kulturwissenschaftliche Zeitschrift (2023), 96–123.
"Lire ou voir ? Ernst Cassirer et Hans Blumenberg sur la pensée et l'image", Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, 56 (2024), 225-242.
"The "Science" of Political Economy – A Victory for Common Sense ?", Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch (2024).
Charlie RENARD : La philosophie avec les enfants : un laboratoire pour la résonance
Harmut Rosa est depuis 2019 le parrain de la Chaire Unesco sur la philosophie avec les enfants. La volonté de démocratiser la philosophie dès le plus jeune âge s'inscrit dans des préoccupations à la fois éthiques (reconnaissance de l'enfant comme sujet) et politiques (offrir de espaces d'émancipation, d'esprit critique et d'ouverture d'esprit pour toutes et tous sans discrimination d'âge, de sexe ou de classe sociale). H. Rosa soutient la thèse que notre modernité tardive est caractérisée par une pression constante, soumettant les individus, adultes et enfants confondus, à un rythme effréné. Ils font désormais face au monde sans pouvoir l'habiter et parvenir à se l'approprier. Ce sentiment d'avoir en permanence à se hâter ("dépêche-toi" serait la phrase la plus entendue par les enfants au quotidien), à être constamment débordé, l'intériorisation des valeurs de compétition, de performance et d'individualisme génèrent une angoisse, une culpabilité diffuse et un sentiment de perte de sens. On n'a plus prise sur son existence et sur la marche du monde, ce qui entraîne un "déficit de résonance" allant jusqu'à mettre en péril le modèle démocratique (tout va trop vite, tout se confond, se délite, s'inverse, le vrai/le faux, le juste/l'injuste). Les ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents — en leur offrant des oasis de pensée et de décélération qui les amènent à prendre le temps de rentrer en résonance avec eux-mêmes, avec les autres, avec les œuvres et avec le monde — sont un des leviers pour reprendre part au processus d'émancipation. Ces pratiques visent à répondre aux crises politiques contemporaines en luttant contre le relativisme des opinions et le dogmatisme des idéologies. Dans cette communication, je montrerai comment les ateliers de philosophie avec les enfants nous montrent ce que devrait être l'école et l'éducation au quotidien dans une perspective démocratique et humaniste : "une école philosophique" qui résonne avec toutes les préoccupations traversant l'œuvre et la pensée d'Hartmut Rosa.
Hartmut ROSA : D'où vient la force motrice ? Vers une théorie de l'énergie sociale circulante
La conférence part de l'observation que la société moderne tardive souffre d'une double crise liée à l’énergie. En effet, elle a besoin de toujours plus de ressources physiques et d'énergie (fossile, solaire et nucléaire) pour maintenir sa structure institutionnelle. Ce faisant, elle épuise la planète et aggrave le réchauffement climatique. Bien plus, il semble qu'il y ait également un épuisement politique, qui réside dans le fait que, malgré une intensification des querelles politiques, un changement social véritable devient de plus en plus improbable. D'un autre côté, la société exige des individus qu'ils dépensent de plus en plus d'énergie psychique : la croissance, l'accélération et l'augmentation constante de l'innovation, qui sont structurellement indispensables, ne sont possibles que si les sujets cherchent sans cesse à augmenter leur performance. Ainsi, on assiste de plus en plus à une sorte d'épuisement psychique qui génère dépression et burn-out. Il est évident que quelque chose ne va pas dans l'équilibre énergétique de la société moderne, tant d'un point de vue structurel que culturel : elle doit en faire toujours plus pour se maintenir et semble disposer de toujours moins d'énergie. Malheureusement, il n'existe pas encore un concept d'énergie propre aux sciences sociales : lorsqu'il est question d'énergie, il s'agit soit d'énergie physique, soit d'idées ésotériques. L'objectif de cette contribution est de développer, à la suite d'Émile Durkheim et de Randall Collins, un concept d'énergie sociale circulante. Celle-ci ne doit pas être comprise comme une agrégation d'énergies motrices individuelles, mais elle naît de l'interaction et dans l'interaction. Elle se multiplie en quelque sorte elle-même : elle ne peut pas être modélisée selon le schéma input-output, mais constitue une puissance dynamique collective d'un type particulier. Ce n'est qu'en comprenant celle-ci que nous pouvons analyser les conditions dans lesquelles les acteurs sociaux, les mouvements et les sociétés peuvent déployer de l'énergie.
Hartmut Rosa (1965) est professeur de sociologie générale et théorique à l'université Friedrich-Schiller de Iéna depuis 2005 et directeur du Max-Weber-Kolleg à l'université d'Erfurt depuis 2013. Il est également directeur du domaine de recherche spécial de la DFG "Strukturwandel des Eigentums" (Changement structurel dans la propriété), qui a commencé ses travaux en 2021. Il a également été professeur invité à la New School for Social Research à New York et à la FMSH/EHESS à Paris. De plus, il était éditeur de revue Time & Society et maintenant il co-édite Berliner Journal für Soziologie. En 2023, il a reçu le prix Leibniz, le prix scientifique allemand le plus prestigieux. Il a notamment publié Accélération (2005), Résonance (2016) et Rendre le monde indisponible (2018).
Niklaus SCHEFER : À la recherche de la résonance transculturelle
Le terme "résonance" est un concept relativement moderne. Son utilisation métaphorique s'est rapidement imposée dans les sciences sociales et humaines. Hartmut Rosa a montré que les sociétés modernes avaient besoin de résonance, héritage du romantisme, pour sortir de l'aliénation. Dans ma contribution au sein des disciplines de la philosophie et de la sinologie, je m'intéresse à la façon dont ces termes sont perçus dans d'autres cultures et j'analyse les concepts chinois qui décrivent ce phénomène esthétique et social. Les caractères spécifiques pour "résonance" sont 韵 (韻) yùn ou 气韵 (氣韻) qìyùn. Issus de la théorie classique de l'art, ils signifient la résonance qu'une œuvre d'art réussie est capable de déclencher. Le terme est établi dès le Ve siècle et s'applique à toute l'histoire de l'art d'Asie de l'Est. Mon étude se concentre sur la relation entre la résonance, le romantisme et certains aspects d'un "proto-modernisme". Cela est illustré par des exemples de la peinture de paysage chinoise de la dynastie Song, qui témoigne des évolutions révélatrices d'une conception résonnante de l'art. Ces illustrations visent à montrer que, dans un contexte culturel différent, les ingrédients de ce que nous comprenons par romantisme et par réaction au rationalisme et aux Lumières (c'est-à-dire à un mouvement proto-moderne), sont apparus au moins 800 ans plus tôt et se sont imposés dans la théorie de l'esthétique. Ainsi, il me semble que la relation entre les phénomènes que Rosa décrit en analysant des sociétés des XXe et XXIe siècles dans les pays occidentaux est également valable pour d'autres cultures et d'autres époques. J'essaie d'en tirer des conclusions transculturelles.
Niklaus Schefer est professeur de philosophie, psychologie, sociologie et du chinois au lycée de Thoune (Suisse). Il est également membre de la direction de l'école et travaille sur des thèmes philosophiques, transculturels et pédagogiques.
Publications
Schefer, N. (2020), "Enlightenment and Freedom in a Confucian Way", in Reichenbach R. Kwak, D.-J., Confucian Perspectives on Learning and Self-Transformation, Springer.
Schefer, N. (2024), "Umwandlungen und Einsichten, Episoden aus der Geschichte unserer Bildungsinstitution(en) anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Hauptgebäude Seefeld" mit drei Einsichten für die Zukunft" [en ligne].
Schefer, N. (2021), "Maturity and Modernity in East and West (The Philosophical Concept of 萬物一體 (wanwu yiti) and its Educational and Political Relevance)", published in academia.edu.
Jan SONNTAG : Résonance et démence
Au cours des dernières années, l'image publique et professionnelle de la démence s'est formée de manière complexe, discutée par de nombreuses disciplines — pas seulement la médecine. La forte incidence des phénomènes démentiels dans les populations vieillissantes des pays industrialisés est un énorme défi pour les sociétés concernées. La perte de la mémoire et de la capacité de penser est particulièrement éprouvante car l'humain est souvent associé à ces compétences : cogito ergo sum. Nous pouvons même parler à ce sujet d'une société hypercognitive. Cela conduit à une approche purement déficitaire de la démence. Pourtant, il existe d'autres approches axées sur les ressources et ces perspectives anthropologiques et phénoménologiques montrent que la cognition intacte n'est pas la condition sine qua non de la qualité de la vie. Dans ma spécialité, la musicothérapie, j'ai pu développer au cours des dernières années un traitement centré sur l'expérience et sur la création d'atmosphères. Je définis la catégorie centrale de l'atmosphère thérapeutique comme un espace de résonance qui permet de se sentir à l'aise en communauté malgré des troubles cognitifs importants. Avec Hartmut Rosa, je comprends la démence comme un rapport au monde qui devient silencieux. J'expliquerai cela et soulignerai l'importance que peut avoir la rencontre thérapeutique en tant qu'espace de réponse.
Jan Sonntag est musicothérapeute diplômé et professeur de musicothérapie à la MSH Medical School de Hambourg. Il a suivi des études de musicothérapie à la Fachhochschule de Heidelberg. Depuis 1999, il est praticien, chercheur, conseiller et enseignant spécialisé dans la démence. En 2013, il obtient un Doctorat à l'École supérieure de musique et de théâtre de Hambourg.
Publications
Sonntag, J. (2016), "Atmosphere – an Aesthetic Concept in Music Therapy with Dementia", Nordic Journal of Music Therapy, 25/3, 216-228.
Sonntag, J. (2024), Demenz und Atmosphäre. Musiktherapie als ästhetische Arbeit. 3. Auflage, Frankfurt, Mabuse.
Sonntag, J., Goditsch, M. J., Storf, M. (2023), "Soziologische Resonanztheorie und ihre Relevanz für die Musiktherapie", Musiktherapeutische Umschau 44/4, 323-335.
Simon SUSEN : La théorie critique comme sociologie des relations au monde [Critical Theory as a Sociology of World-Relations ?]
Il s'agit d'examiner le concept de résonance de Hartmut Rosa. À cette fin, l'analyse est divisée en quatre parties. La première partie élucide ce concept en insistant sur la manière dont Rosa distingue les "axes de résonance" horizontaux, diagonaux et verticaux et en montrant leur rôle dans la construction de différentes relations au monde. La deuxième partie est centrée sur l'aliénation : dans quelle mesure est-elle un élément central des formes de vie modernes et de la condition humaine ? La troisième partie aborde la dialectique de la résonance et de l'aliénation. Je défends l'hypothèse selon laquelle elles sont antithétiques et soutiens que leur étude approfondie fournit des paramètres normatifs permettant de distinguer la "bonne vie" de la "mauvaise vie". La dernière partie examine la tentative de Rosa de défendre son esquisse d'une théorie sociologique de la résonance contre les objections soulevées par ses détracteurs. Cela comprend une évaluation point par point de son plaidoyer pour une sociologie des relations au monde axée sur la résonance. Enfin, je montre qu'en dépit des problèmes qu'elle peut soulever, l'approche de Rosa représente l'un des développements les plus prometteurs de la théorie critique du XXIe siècle.
Simon Susen est professeur de sociologie à l'université de Londres depuis 2011. Il a obtenu son doctorat de l'université de Cambridge en 2007. Il est professeur associé à l'université Andrés Bello in Santiago, Chile , membre associé du Bauman Institute et, avec Bryan S. Turner, éditeur du Journal of Classical Sociology.
Publications
Humanity and Uncontrollability : Reflections on Hartmut Rosa's Critical Theory, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 324 pp. (2024).
"Twenty-Five Theses on the Task of the Translator : With, against, and beyond Walter Benjamin", Revista Portuguesa de Filosofia, 80 (1–2), pp. 197–270 (2024).
"The Interpretation of Cultures : Geertz Is Still in Town", Sociologica – International Journal for Sociological Debate, 18 (1), pp. 25–63 (2023).
"A New Structural Transformation of the Public Sphere ? With, against, and beyond Habermas", Society, 60 (6), pp. 842–867 (2023).
"Towards an Ontology of Contemporary Reality ?", Theory, Culture & Society, 40 (7–8), pp. 33–55 (2023).
"Lessons from Reckwitz and Rosa : Towards a Constructive Dialogue between Critical Analytics and Critical Theory", Social Epistemology, 37 (5), pp. 545–591 (2023).
Frédéric VANDENBERGHE : Le projet romantique d'une herméneutique critique de la modernité
L'École de Francfort est désormais une tradition centenaire. Devenu célèbre grâce à ses livres sur l'accélération et la résonance, Hartmut Rosa est le représentant le plus connu de la quatrième génération de la Théorie critique. Pour bien comprendre d'où il vient et où il va, il faut toutefois resituer sa pensée dans la tradition d'une herméneutique critique de la modernité qui s'inspire, dès sa thèse de doctorat jusqu'à ses réflexions plus récentes sur l'énergie physique, sociale et cosmique, de la philosophie sociale de Charles Taylor. La question centrale qui anime son œuvre est la même que celle de Wilhelm Dilthey, Max Weber et Charles Taylor : Quel type d'humanité produit la modernité ? Peut-on imaginer une autre modernité, une autre humanité et une autre relation au monde que celles héritées des philosophes des Lumières qui cherchent à dominer et à contrôler le monde ? Le pari de Rosa est qu'une réactivation du programme philosophique du romantisme est possible et donc que nous pouvons promouvoir une relation au monde qui ne se caractérise plus par l'aliénation et la réification qui conduisent l'humanité vers des crises multiples.
Frédéric Vandenberghe est professeur de sociologie à l'université fédérale de Rio de Janeiro et collaborateur associé au centre de recherche "Zukunfte der Nachhaltigkeit" à l'université de Hambourg.
https://frederic.vdb.brainwaves.be/
Dernières publications
Caillé, A. & Vandenberghe, F. (2021), Towards a New Classic Sociology. A Proposal and a Debate, London, Routledge.
Vandenberghe, F. (2024), Teoria social reconstrutiva. Vol. 1 : A sociologia como filosofia moral, Rio de Janeiro, Ateliê de humanidades.
Vandenberghe, F. (2025), "Moral Maps, Time Structures and World-Relations", in Rosa, H., Time and World, Cambridge, Polity Press.
Olivier VOIROL : Théorie critique et résonance
Née dans la première partie XXe siècle, la théorie critique est un courant de la philosophie et de la théorie sociale dont l'histoire mouvementée a traversé celle du siècle, à ses différents moments. Elle reste active et vivante à l'heure actuelle. S'il est insuffisant de rabattre ce courant de pensée sur ses figures fondatrices telles que Max Horkheimer, Herbert Marcuse et Theodor W. Adorno, il l'est tout autant de le restreindre à ses représentants tardifs, tels que Jürgen Habermas, Axel Honneth ou encore Nancy Fraser. La théorie critique gagne à être envisagée dans sa pluralité théorique autant que dans son unité épistémologique. La question de son actualité se repose sans cesse — en particulier à l'heure actuelle.
Hartmut Rosa inscrit ses travaux dans le sillage de cette tradition de pensée, ce qu'il a explicité à plusieurs reprises à partir des discussions faisant suite à Accélération (2005), et dans son opuscule Aliénation et accélération (2011). Rosa retient de cette tradition de pensée une conception immanente de la critique, à quoi s'ajoute une sensibilité aux aspects "négatifs" du social, ainsi qu'une attention aux thèmes (adorniens) de la domination de la nature et du "non-identique", réinterprétés en termes d'"indisponibilité" au sein de la théorie de la résonance.
Grâce à son concept de "monde", la théorie de la résonance apporte une dimension manquante jusque-là dans la théorie critique — et écartée par sa version intersubjectiviste. La théorie de la résonance offre en outre des éléments de réponse à certains enjeux sociaux et politiques clés du temps présent. En reconnaissant cet apport, j'entends montrer qu'une théorie critique articulée aux concepts de résonance et de monde fait face au double enjeu de penser une approche non-dominatrice de la raison et de l'agir politique.
Enseignant en sciences sociales et politiques à l'université de Lausanne, chargé de cours à l'université de Paris-Cité, Olivier Voirol a mené pendant vingt ans ses recherches à l'Institut für Sozialforschung de Francfort sur le Main, en étudiant l'histoire et l'actualité de la théorie critique, en particulier sous l'angle des questions de l'autoritarisme et des mutations de l'espace public. Il est responsable depuis 2008 de la collection "théorie critique" aux éditions de La Découverte, qui a traduit les travaux de Rosa et les a introduits dans l'espace francophone.
Nathanaël WALLENHORST : Résistance, résonance
Comment éviter l'écueil où le néolibéralisme nous a conduits ? Pour parer aux logiques d'accélération et de croissance, qu'il identifie comme étant à l'origine de l'aliénation contemporaine, le sociologue Hartmut Rosa a dessiné une voie magistrale : un rapport au monde renouvelé. À rebours de l'instrumentalisation que nous impose la société moderne, il nous invite à une relation vivante, responsive. En un mot, à la "résonance", seule en mesure de nous sortir de l'ornière sans violence. Mais ce concept est-il assez puissant pour penser une nécessaire transformation ? La résonance est subversive, mais un renouvellement en profondeur peut-il faire l'économie de la rupture ? Comment éduquer les générations futures à un nouveau rapport au monde ? Comment se former pour transformer ? Faut-il entrer en résonance ou en résistance ?
Nathanaël Wallenhorst est docteur en sciences de l'éducation, sciences de l'environnement et science politique. Il est professeur à la faculté d'éducation de l'université catholique de l'Ouest dont il est le doyen. Il travaille sur les incidences politiques, éducatives et anthropologiques de l'entrée dans l'Anthropocène et dirige actuellement une Encyclopedia of the Anthropocene – Pluriversal Perspectives (avec Wulf, Springer Nature). Il est membre de l'Anthropocene Working Group (AWG) et dirige le réseau international de recherche "Education in the Anthropocene" pour Wera, l'association mondiale de la recherche en sciences de l'éducation.
Derniers ouvrages
Qui sauvera la planète ? Les technocrates, les démocrates ou les autocrates…, Actes Sud, 2022.
Penser l'éducation à l'époque de l'Anthropocène (avec Hétier), Le Bord de l'eau, 2023.
A critical theory for the Anthropocene, Springer-Nature, 2023.
Contenir l'emballement bioclimatique, Actes Sud, 2025.
2049. Ce que le climat peut faire à l'Europe, Le Seuil, septembre 2025.
Accélération, résonance, énergies sociales. Quels usages opérationnels ?, table ronde animée par Sylvain ALLEMAND, avec Nicolas ESCACH, Luc GWIAZDZINSKI, Edith HEURGON et Vincent PETITET
Luc GWIAZDZINSKI
L'intervention proposera une mise en dialogue des concepts d'"accélération", de "résonance", d'"énergie sociale" avec des dynamiques collectives observées sur les territoires : appropriations politiques, festives, ludiques et créatives des espaces publics (Rond-point des gilets jaunes, Zad, guérilla jardinière…), politiques temporelles territorialisées (bureau des temps, Slow Cita), urbanisme événementiel et temporel, territoires apprenants, tiers-lieux (…). Nous examinerons ce que les concepts d'accélération, de résonance et d'énergies sociales peuvent apporter à la compréhension de phénomènes observés depuis la fin des années 90 et à l'analyse des stratégies d'adaptation développées par les individus, les collectifs et les pouvoirs publics notamment à l’échelle locale.
Luc Gwiazdzinski est géographe. Professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse et chercheur au LRA. Ses travaux portent notamment sur les temporalités, la chronotopie, les rythmes, les appropriations créatives, festives et politiques et les dispositifs apprenants.
Dernières publications
Graff C., Gwiazdzinski L., 2024, Flux et rythmes à l'épreuve des territoires, Rhuthmos.
Gwiazdzinski L. et al., 2024, Les nouvelles proximités, FYP.
Cholat F., Gwiazdzinski L., 2020, Territoires apprenants, Elya.
Gwiazdzinski et al., 2020, Manifeste pour une politique des rythmes, EPFL Éditions.
Floris B., Gwiazdzinski L., 2019, Sur la vague jaune. L'utopie d'un rond-point, Elya.
Gwiazdzinski L., 2015 (dir.), L'hybridation des mondes, Elya.
Vincent PETITET
Sociologue de formation (Sciences Po Paris, doctorat en sciences humaines à l'ENS, Harvard), Vincent Petitet se définit comme un "être hybride" qui fait dialoguer sciences humaines et monde de l'entreprise. Chercheur associé au CNRS de 2009 à 2018, il a travaillé sur la domestication des individus dans les organisations au jour de l'œuvre de Sloterdijk, Anders, Foucault, Derrida et Rosa. Il est notamment l'auteur de cinq ouvrages, allant du management au cinéma de Visconti, jusqu'à une relecture de l'œuvre de Michel Foucault quarante ans après sa disparition (Michel foucault en son Escurial). Il a occupé des fonctions de direction dans des grands groupes et des institutions publiques (Arthur Andersen, AXA, EPA Paris-Saclay) et, aujourd'hui consultant indépendant, accompagne des dirigeants dans la conduite du changement et le management par le récit. Boxeur passionné et pratiquant la méditation tibétaine depuis vingt ans, il explore les sensations comme voies privilégiées vers des expériences de résonance.
Born to be wild, spectacle de Sophie BOUREL & Silvia LENZI [Compagnie La Minutieuse]
Accélération et rapport au temps, résonance et rapport au monde, mise à disposition garantie et indisponibilité foncière de la résonance. En texte et en musique classique et métal, Silvia Lenzi et Sophie Bourel dialoguent et explorent la pensée d'Hartmut Rosa. Toutes deux membres de La Minutieuse, elles sont déjà intervenues à Cerisy, en 2022 lors du colloque Édouard Glissant, la relation mondiale et à l'été 2023 pour celui intitulé L'Europe : héritages, défis et perspectives.
Violoncelliste, Silvia Lenzi s'empare de la diversité des rôles que son instrument propose pour assouvir sa curiosité et son envie de partage. Elle privilégie les projets interdisciplinaires originaux, et riches de sens. Des créations qui l'amènent à interroger la relation entre texte et musique.
Sophie Bourel est actrice, elle crée depuis quelques années ses propres spectacles en relation avec poètes et artistes pluri-disciplinaires. Passionnée d'archives et de poésie, elle invente des dispositifs qui évoluent au gré de ses recherches et des commandes artistiques qui lui sont faites.