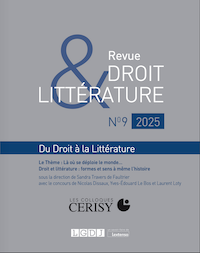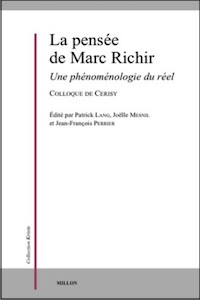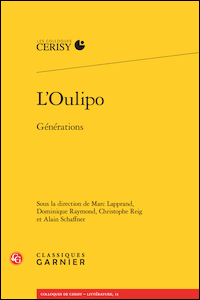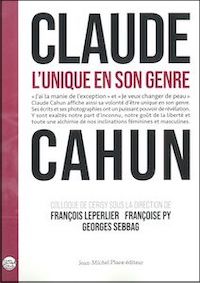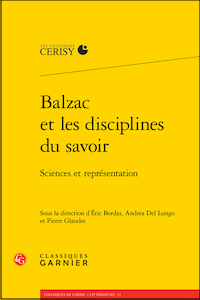Cette invitation fut donc l'occasion d'établir des liens avec les quatre autres colloques auquel j'ai assisté pendant l'été 2025 (Métamorphoses par le paysage ; Philosophies comptables, pour recomposer un monde écologique ; Hartmut Rosa : accélération, résonance, énergies sociales ; La proximité comme projet), mais aussi de remonter dans le temps en incluant dans le corpus trois autres colloques particulièrement marquants à mes yeux : Quelles transitions écologiques ? (2015) ; Le renouveau du sauvage (2023) ; Vers des politiques des cycles de l'eau (2024).
Nota : La mise en forme qui suit comporte des références aux communications et activités du colloque d'octobre 2025 sur la nature, sans autre précision ; pour le cas contraire, les colloques de référence sont cités.
Résonance et énergies sociales, la magie du lieu
Au premier rang des motivations qui me conduisent chaque année à Cerisy, il y a sans nul doute le plaisir des nouvelles rencontres, mais aussi — peut-être surtout — celui des retrouvailles, des complicités qui parfois se transforment en amitiés solides, des engagements communs, comme autant de précieuses ressources qui permettent de se sentir moins seule face aux enjeux environnementaux et aux combats écologiques.
Comme l'a si bien exprimé Thomas Fabre à l'issue du colloque Hartmut Rosa, Cerisy est un lieu particulièrement propice à la résonance et à l'émergence d'énergies sociales, grâce à la magie du château et au sentiment d'y être bienvenue, mais aussi grâce à la nature qui l'entoure. Reviendrais-je si souvent à Cerisy si Cerisy n'offrait pas ces potentielles résonances propices à la rencontre ?
La construction collective d'une cartographie sensible des limites du parc de Cerisy, sous la houlette de Jean-Jacques Terrin et Émilie Gascon, a permis à chacun d'explorer son propre rapport au lieu et à ce qu'il engendre.
Par-delà les frontières disciplinaires, le croisement des savoirs
Cerisy offre un espace irremplaçable de mise en commun des savoirs, de dialogue entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales, philosophie, littérature, expression artistique… Loin des visions partielles, superficielles ou biaisées, cela permet d'éviter bien des pièges du prêt-à-penser, d'éclairer les controverses, de penser la complexité, de nourrir sa propre pensée. Mon "premier" Cerisy en 2015 — une décade consacrée aux transitions écologiques — avait donné le la, pour le meilleur et pour le pire de mes angoisses éco-anxieuses. De l'exégèse de l'encyclique Laudate Si' par Gaël Giraud aux travaux de Philippe Bihouix sur les mirages de la croissance verte, des considérations de Mathilde Szuba sur les quotas individuels carbone à la discussion autour des travaux de Raphaël et Catherine Larrère, les débats furent toujours passionnés.
Plus récemment, les travaux du géochimiste Jérôme Gaillardet m'ont entraînée vers l'insoupçonné à deux reprises. En 2024, son introduction remarquable du colloque Vers des politiques des cycles de l'eau a fait voler en éclat mes connaissances scolaires basiques : des cycles de l'eau au pluriel, des temporalités et des distances d'une longueur insoupçonnée, des profondeurs inconnues. Cette année, des échos en étaient perceptibles dans la communication de Dominique Bourg, évoquant les rivières volantes de la canopée amazonienne si bien photographiées par Salgado.
En mai 2025 (Métamorphoses du paysage), le concept de zone critique présenté par le même Jerôme Gaillardet m'a fait percevoir l'incommensurabilité de ce qu'il reste à découvrir sous nos pieds. C'est ainsi que quelques intervenants ont fini de lever les doutes et interrogations que pouvait susciter une lecture littérale du titre "La nature comme levier", en insistant à plusieurs reprises sur le fait que planter des arbres et protéger la biodiversité n'est que la face émergée de l'iceberg des nécessaires transformations.
Ces doutes quant au titre du colloque avaient d'ailleurs été bien entamés par les propos d'introduction de Vincent Piveteau et Lucile Schmid, confirmant ainsi que la première matinée d'un colloque cerisyen — toujours déterminante — ne doit faire l'impasse ni sur un cadrage précis, ni sur les définitions à partager.
Lors de ce colloque, plusieurs intervenants se sont attachés à poser ces définitions et à décrire leur cadre conceptuel, en particulier lors des capsules de retours d'expérience. Ainsi Damien Lejas a pris le temps de définir ce qu'il faut entendre par "restauration écologique" ou "renaturation", tandis que Zoé Raimbault présentait en détail les fonctionnalités écologiques de sols avant de revenir sur quelques expérimentations.
À mes yeux, ces temps de cadrage et de définitions sont pleinement caractéristiques d'un colloque de Cerisy réussi qui, loin de s'adresser uniquement à une coterie de spécialistes, cherche au contraire à jeter des ponts vers une diversité d'auditeurs et de sensibilités. Une vigilance que tous les directeurs de colloques devraient garder à l'esprit.
Où atterrir ? Le contact avec le terrain et les savoirs ordinaires
L'une des autres caractéristiques des colloques de Cerisy est la place habituellement donnée aux témoignages et aux visites de terrain (intitulés "HORS LES MURS"), comme autant d'occasions de mise à l'épreuve des savoirs académiques. Cela offre des moments souvent privilégiés comme l'arpentage dans l'archipel des îles Chausey, suivie d'un retour vers Granville en compagnie des dauphins (Métamorphoses du paysage).
Donner du temps aux savoirs vernaculaires, au modeste, à l'expérience située, voire à ce qui peut être considéré comme insignifiant, me semble essentiel. En effet, cela apporte une autre compréhension des choses, sensible, souvent inspirante quand la question "Où atterrir ?", telle que posée par Bruno Latour, reste entière en particulier sur les sujets écologiques et démocratiques.
Les jardins privés ont été brièvement évoqués par Gwenaël Boidin, en relation avec les errements de la loi ZAN, rejoignant une présentation détaillée des potagers pavillonnaires de Caen par Maxime Marie, lors du colloque La proximité comme projet. La question de la (non)-transmission des savoirs ordinaires — cuisiner, jardiner — a été discutée lors de la présentation de Lucie Brice Mansencal, réveillant un souvenir, lié au colloque Quelles transitions écologiques ? : j'en étais repartie rassurée et fière d'avoir transmis ces savoirs à mes enfants.
Il est donc toujours dommage que certains retours de terrain n'aient pas tout le temps nécessaire pour un complet développement. J'aurais ainsi aimé passer plus de temps sur les questions d'aménagement face au recul du trait de côte, exposées par Régis Leymarie (Conservatoire du littoral), questions qui avaient déjà été présentes à travers une exposition prospective de l'avenir du bourg des Genêts, dans la baie du Mont-Saint-Michel, commanditée par le C|A.U.E de la Manche (Métamorphoses du paysage).
La vertu de ces visites et témoignages est également de mettre en valeur les énergies sociales, telles que conceptualisées par Hartmut Rosa. Celles qui permettent de se retrousser les manches dans les territoires. Une démocratie du faire avec peu, qui agit avec l'expertise des élus locaux et des habitants, comme en a témoigné Jean-François Caron (Métamorphoses du paysage), un fidèle de Cerisy.
Faire ensemble, faire avec, ne pas faire à la place mais encourager à faire et accompagner. Peut-être y trouver des pistes pour contrer le sentiment d'impuissance qui habite aujourd'hui massivement les maires. À cet égard, la visite de Saint-Sauveur-Villages (La proximité comme projet), en compagnie de sa maire, Aurélie Gigan, n'a pas manqué de surprendre les chercheurs : de la pratique du crochet et du tricot dans les locaux de la médiathèque créée avec les moyens du bord et avec des habitants bénévoles, à la plantation d'une vigne dans le parc municipal avec un agriculteur s'imaginant en viticulteur normand !
La tension urbain/rural : un éléphant dans la pièce quand il est question de nature
"Et si le rural n'était pas l'arrière-pays de l'urbain ? Si plutôt c'était l'urbain qui était l'arrière-pays du rural". Ce cri du cœur de Somhack Limphakdi, lors du colloque Philosophies comptables, pour recomposer un monde écologique, met au jour de manière saisissante une aporie qui, me semble-t-il, traverse nombre de colloques de Cerisy.
Il y a pour moi, issue du monde rural et vivant depuis toujours dans le rural, l'évidence d'un gouffre entre les représentations du monde spécifiques aux urbains, et celles qui existent dans la ruralité. Comme si nos attachements au monde n'étaient pas les mêmes, et nos renoncements acceptables non plus. Il s'ensuit le constat d'un profond problème démocratique, tout particulièrement s'il est question de nos engagements et responsabilités vis-à-vis de l'environnement, surtout quand les injonctions au changement semblent fort éloignées des réalités rurales.
Peut-on se satisfaire de l'angle de la sécession, et réfléchir à "Prendre la clé des champs", comme nous y a invité Sébastien Marot à deux reprises cet été (Métamorphoses du paysage & Philosophies comptables, pour recomposer un monde écologique) ? La notion de biorégionalisme, apporte-t-elle un début de réponse pour réduire cette tension ? Elle court de colloque en colloque depuis quelques années, et a sans doute été abordée trop brièvement lors du dernier en date.
Au fil des colloques 2025, à ma grande surprise, la notion de cosmogonie est venue s'installer de manière insistante dans mon esprit sans doute en quête d'un renouveau des approches et des discours inspirants. Le colloque Hartmut Rosa ne m'a pas apporté les réponses simples dont je rêvais, l'aurait-il pu ? Mais il m'a permis de comprendre qu'il reste possible de ménager des lieux et des circonstances où la résonance peut advenir, lieux qui laissent évidemment de la place à la nature me semble-t-il.
Habiter le monde en changeant de regard : vers une nouvelle cosmogonie accueillante pour les non-vivants
Roberto Casati, en introduction au colloque Métamorphoses du paysage, nous a conduit dans les fonds marins pour nous inviter à nous décentrer, en regardant le monde comme le ferait une raie manta, un mollusque ou un dauphin.
Au fil des colloques de Cerisy, s'installe une question insistante, celle de la place que nous accordons aux non-humains. C'était ainsi toute la puissance du colloque Le renouveau du sauvage qui, loin d'être uniquement focalisé sur le réensauvagement, posait des questions essentielles sur les droits des animaux et de la nature en général. Ainsi, les interrogations éthiques liées au droit à la vie privée des animaux, pucés ou captés par des pièges photographiques, ont largement occupé les chercheurs.
La puissance du droit — autre découverte cerysienne — peut également contribuer à ce changement de regard. Ainsi, quand il a été question du droit de l'humain à un environnement sain à propos de la lagune de Mar Menor, je me suis demandé quels seraient les bases, et l'intérêt pour la nature, d'un droit à une espèce humaine non prédatrice.
Si ces pistes semblent aujourd'hui incompatibles avec notre ethos occidental, et sans doute encore plus avec celui de la technostructure et de bon nombre de nos décideurs politiques, c'est peut-être par ce biais que la nécessaire révolution des représentations pourrait advenir et nous guider vers les renoncements nécessaires.
C'est en tout cas, ce que je continuerai de venir explorer à Cerisy dès 2026 et son premier colloque Quelles sciences de la Terre à l'heure de l'anthropocène ? (programme de la saison 2026). En attendant un jour peut-être un colloque autour des travaux du Pacte civique pour une transition juste, en compagnie de quelques sociologues centrés sur la débrouille en milieu rural.