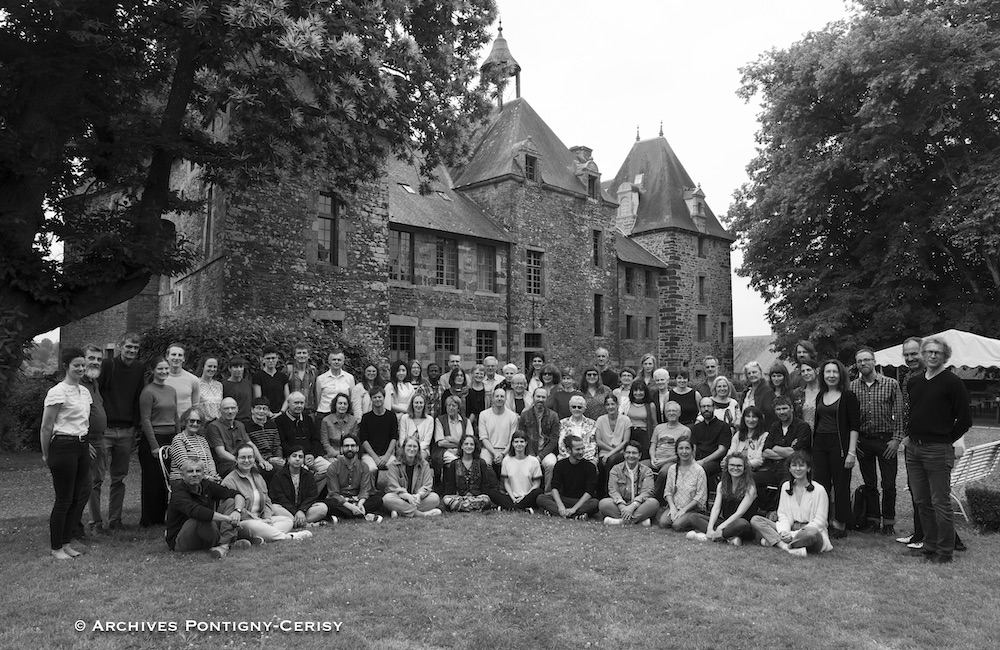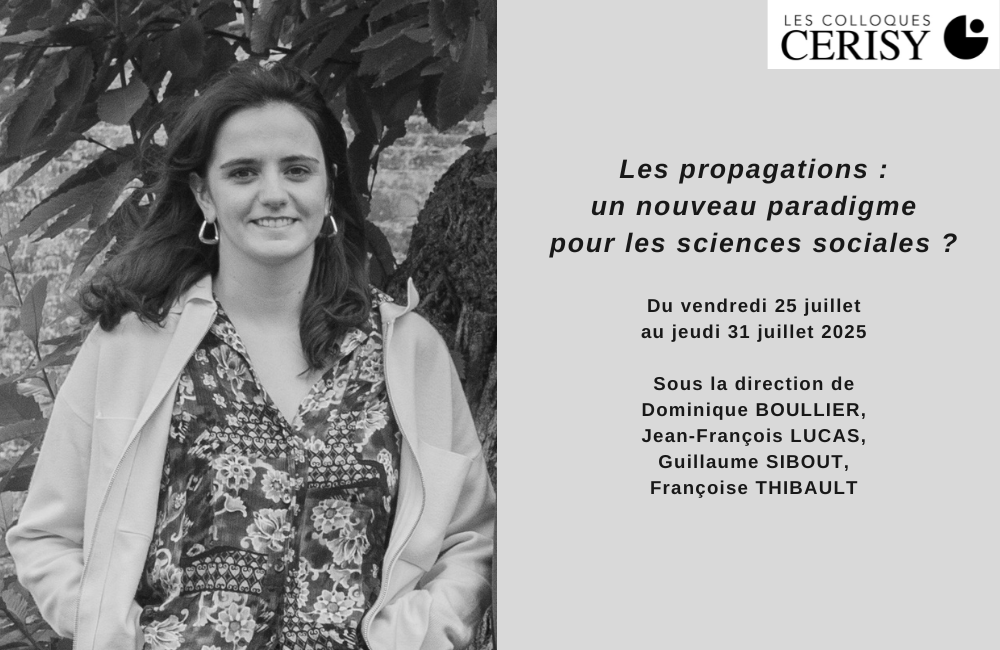Avant d'en venir à ces actes issus non pas d'un mais de deux colloques de Cerisy, pouvez-vous commencer par revenir sur la genèse de ceux-ci. L'intention de les articuler était-elle affichée dès le départ de leur programmation ?
Colette Camelin : Non, d'autant moins qu'initialement, les deux colloques avaient été programmés l'un indépendamment de l'autre, et conçus selon leur propre logique. Les deux découlaient cependant de la même conscience aiguë des conséquences désastreuses de l'agriculture productiviste, de l'extractivisme, etc., pour la planète et ses habitants : des dégradations de l'environnement, mais aussi, sur un plan plus politique, la montée de populismes qui remettent en cause jusqu'aux politiques de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Autant de constats désespérants qui auraient pu donner une tonalité pessimiste à nos deux colloques. Mais, justement, les deux équipes organisatrices partageaient aussi le refus de se résigner à ces évolutions, et manifestaient leur volonté d'agir. Comment ? En créant les conditions d'échanges interdisciplinaires — ce que favorise un lieu comme Cerisy —, puis en diffusant le fruit de ces échanges dans la société à travers la publication d'actes, notre objectif étant de toucher le plus grand nombre et de susciter chez chacun le désir de changer ses propres rapports au vivant et au sauvage. Car, comme le dit Bruno Latour, "Non, la Terre ne va pas disparaître, les humains, non plus. Il faut juste se mettre au boulot !" (Bruno Latour, "L'apocalypse, c'est enthousiasmant", propos recueillis par Jean Birbaum, Le Monde, 31 mai 2019).
Comme on l'imagine, les directeurs de l’un et de l'autre colloque se connaissaient assez pour se risquer à envisager des séances communes…
Colette Camelin : Détrompez-vous ! Nous ne nous connaissions pas du tout ! Pour ce qui me concerne, j'avais lu les livres de Raphaël et Catherine Larrère, mais je ne les avais jamais rencontrés. Les directeurs de l'un et de l'autre colloque viennent d'univers disciplinaires très différents : Raphaël était agronome de formation, zootechnicien ; il a beaucoup travaillé sur les relations avec les animaux, dont il a tiré son idée de "contrat domestique" et a beaucoup étudié les pratiques agricoles et forestières avant de s'orienter vers les questions d'éthique environnementale auxquelles il a consacré plusieurs livres, coécrits avec Catherine. Rappelons qu'il présida pendant dix ans le conseil scientifique du Parc national du Mercantour. Des travaux et des engagements multiples qui devaient l'amener à constater le "renouveau du sauvage" à partir notamment d'espèces domestiques. Il parlait bien d'un "renouveau" et non d'un retour, car ces espèces autrefois domestiquées ne retrouvent pas un état d'avant la domestication. Il avait déjà organisé un séminaire sur cette thématique, qui devait l'inciter à proposer à Edith Heurgon (directrice du CCIC) un colloque. À peu près au même moment, elle et moi réfléchissions à un colloque sur le rapport entre littérature et le vivant. Nous sommes alors en 2019, soit avant la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux périodes de confinement auxquelles elle devait donner lieu.
Venons-en à votre propre colloque. Comment l'idée vous en est-elle venue ?
Colette Camelin : J'avais de longue date un rêve ! Celui de faire dialoguer des pratiques littéraires et des travaux scientifiques autour de la question du vivant. Ce rêve doit beaucoup à ma lecture d'Edgar Morin, dans les années 1990. Ce dernier insistait déjà sur la nécessité — je le cite [elle consulte ses notes] — d'"articuler, de relier, de contextualiser les savoirs, car les problèmes sont transdisciplinaires". Il prône en conséquence un rapprochement des sciences et des humanités. Ce à quoi je me suis employée, dans le cadre de mes enseignements — en travaillant sur divers auteurs comme Saint-John Perse, Segalen et Lorand Gaspar, etc.
Mais ma démarche en restait encore au stade du bricolage. Je sentais que j'avais besoin de me former, de me doter d'une méthode, pour reprendre le titre de l'œuvre majeure d'Edgar Morin, La Méthode (Seuil, 2008). C'est dans cet état d'esprit que j'ai assisté à deux colloques de Cerisy : Le moment du vivant, organisé en 2012, sous la direction d'Arnaud François et de Frédéric Worms, puis, quelques années plus tard, en 2019, Humains, animaux, nature : quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ? sous la direction de Corine Pelluchon et Jean-Philippe Pierron. Ces colloques me fournirent les fondations dont j'avais besoin pour proposer à Edith un colloque sur la littérature dans son rapport au vivant. Je me souviens très bien du moment : c'était en janvier 2019, juste après la signature du bon-à-tirer des actes du colloque Segalen 1919-2019 : "Attentif à ce qui n'a pas été dit", Edith, qui avait participé à cette séance, me demanda, en sortant de chez l'éditeur, si je souhaitais préparer un autre colloque. Je lui fis part de mon rêve, d'en faire un sur la littérature dans ses relations avec des "scientifiques", dans le même esprit interdisciplinaire qui avait dicté le premier colloque que j'avais codirigé quelques années plus tôt, en 2013. Intitulé 1913 Cent ans après : enchantements, désenchantements, il mêlait des approches littéraires, philosophiques, artistiques — avec des contributions sur la danse, la musique, la peinture… Edith a aussitôt manifesté son intérêt et donné son accord de principe. Il ne restait plus qu'à monter ce colloque ! [Rire].
Nous ne reviendrons pas plus en détail sur la genèse de ce colloque, car le lecteur peut la découvrir dans l'avant-propos des actes que vous venez de publier. En revanche, pourriez-vous rappeler les circonstances qui ont décidé de leur programmation en parallèle ?
Colette Camelin : C'est là qu'intervient la sérendipité…
Ah la sérendipité ! Je ne peux qu'être tout ouïe…
Colette Camelin : [Rire]. Chaque rivière — si on peut filer cette métaphore pour évoquer nos deux colloques — suivait son cours, tranquillement, en se nourrissant de rencontres et de lectures. Jusqu'à ce que surviennent d'heureux hasards, auxquels le "bassin versant" de Cerisy est particulièrement propice avec sa passeuse de frontières disciplinaires qu'est Edith.
Parmi ces heureux hasards, il y eut… la crise sanitaire liée au Covid-19… Parler d'heureux hasard à son propos peut paraître surprenant et même choquant tant elle a été d'abord synonyme de drames. Toujours est-il que si elle aura eu pour effet de contraindre de reporter à plusieurs reprises nos deux colloques, ceux-ci finirent par être programmés au même moment, ce qui, comme je l'ai dit, n'était pas prévu initialement.
Entre temps, en 2021, j'étais intervenue au colloque L'enchantement qui revient (sous la direction de Rachel Brahy, Jean-Paul Thibaud, Nicolas Tixier, Nathalie Zaccaï-Reyners), au cours duquel Edith reçut un appel de Raphaël lui annonçant que son colloque devait être (de nouveau…) reporté en 2023 pour cause, cette fois, d'un problème de financement. C'est à ce moment-là qu'Edith a proposé de programmer les deux colloques en parallèle. Un mal pour un bien puisque cela me laissait encore deux ans de préparation, avec également la possibilité d'animer le Foyer de création et d'échanges de l'année suivante, en proposant en guise de fil conducteur, une réflexion collective (avec les résidents) sur le thème "Que peut la littérature pour les arbres ?" — dans l'esprit d'un "proto-colloque" selon la formule d'Edith —, tout en préparant le volume de la collection "Les Traversées de Cerisy", sur le thème Écrire avec les vivants [Hermann, 2022] — un recueil de communications tirés d'actes de colloques de Cerisy, ayant traité de ce thème.
Bref, la Déesse grecque du hasard, Tyché, eut l'amabilité de se rappeler à plusieurs reprises à notre bon souvenir…
Mais pourquoi l'université n'aura pas permis d'exaucer votre rêve ?
Colette Camelin : [Soupire]. Je me garderai de noircir le tableau de la situation du monde universitaire. D'autres sont parvenus à créer les conditions d'un dialogue entre des disciplines qui se méconnaissent. Pour ma part, je me suis toujours sentie enfermée dans les cases disciplinaires. J'ai essayé de faire venir des scientifiques à des colloques que j'organisais, mais c'était toujours compliqué ; les chercheurs pressentis ne voyaient pas forcément l'intérêt de sortir de leur domaines de recherche… À se demander si c'est le principe même de ce dialogue interdisciplinaire qui était compliqué à instaurer.
Heureusement, ce n'est pas le cas. Le premier colloque que j'ai organisé à Cerisy — 1913 Cent ans après : enchantements, désenchantements, avec Marie-Paule Berranger — m'en apporta la démonstration non sans me redonner espoir. Enfin, je trouvais un espace où faire dialoguer des chercheurs d'horizons disciplinaires apparemment les plus éloignés — scientifiques et littéraires. Depuis, j'ai acquis une conviction : Cerisy est le cadre le plus approprié où organiser ce type de dialogue. C'est toujours ainsi que je l'ai vécu, y compris au cours des colloques — une dizaine à ce jour ! — auxquels j'ai participé comme intervenante ou auditrice.
Raphaël Larrère pourrait reprendre tel quel ce que vous venez de dire, lui qui y a organisé ou a participé à plusieurs colloques…
Colette Camelin : Absolument ! Raphaël avait participé à de nombreux colloques, à différents titres — directeur, intervenant, auditeur —, soit seul, soit avec Catherine. Il y avait notamment organisé le colloque Les animaux, deux ou trois choses que nous savons d'eux avec la philosophe Vinciane Despret, ce qui attestait de son esprit d'ouverture à des disciplines autres que "scientifiques".
Nul doute que le fait que les équipes de direction de vos colloques respectifs comptaient des "Cerisyens" — des personnes connaissant Cerisy pour s'y être rendus à maintes reprises — a dû favoriser l'amorce du dialogue : vous ne vous connaissiez pas forcément, mais vous aviez au moins tous l'expérience de Cerisy…
Colette Camelin : Non seulement nous connaissions Cerisy, mais encore nous avions l'expérience de la direction de colloques cerisyens.
Ce qui est essentiel quand on sait que la préparation d'un colloque prend en général deux ans !
Colette Camelin : Comme vous le savez, le principe des colloques parallèles n'était pas nouveau. Chaque année, Cerisy en propose. Reste qu'il est peu fréquent que des parallèles se rencontrent ! [Rire]. Pourtant, c'est bien ce qui s'est produit et plus rapidement qu'on pouvait le penser. Raphaël souhaitait de longue date un dialogue avec des littéraires. Une aspiration qui remonte à loin : rappelons qu'avant de s'engager dans une carrière scientifique, il voulait faire des études de philosophie ; il était donc ravi de la perspective de ce dialogue, d'autant plus qu'il avait eu récemment des échanges fructueux avec des littéraires.
Qu’en est-il des directeurs de votre propre colloque ?
Colette Camelin : Alain Romestaing avait travaillé sur le corps, les animaux et la nature, en collaboration avec des spécialistes d'éthologie. Il était donc ouvert à ce dialogue entre littérature et sciences. Quant à Bénédicte Meillon, elle travaillait à l'élaboration d'une "écopoétique pour les temps extrêmes" dans la littérature étatsunienne.
Très vite, avec Raphaël, nous avons identifié des zones de confluence, où les eaux de nos deux rivières pourraient donc se mêler. Nous nous sommes accordés sur le principe d'échanges dans le cadre de trois demi-journées et de trois soirées communes, enfin, une journée "HORS LES MURS".
Avez-vous songé un temps à fondre les deux colloques en un ?
Colette Camelin : Non, à aucun moment. Chaque équipe avait des sujets spécifiques à aborder, et avait donc besoin de ne pas se dissoudre dans un seul et même colloque. Nous tenions donc tous à préserver des approches disciplinaires distinctes.
L'occasion de souligner que l'ouverture interdisciplinaire ne signifie pas l'effacement des disciplines…
Colette Camelin : Non, c'est même le contraire : c'est parce que chaque spécialité disciplinaire arrive à un niveau de précision dans l'étude d'un objet de recherche, à partir des instruments mis à sa disposition — lesquels peuvent être mobilisés par plusieurs sciences, ainsi que le précise Bruno Latour — que les chercheurs qui en relèvent sont en mesure de discuter avec des chercheurs d'autres disciplines, dans une perspective interdisciplinaire. Mais, au préalable, insistons sur ce point, il importe que chacun aille au bout de son sujet de recherche, avec ses propres instruments, méthodes et concepts.
Qu'en est-il des repas qu'à Cerisy, les intervenants et auditeurs, de quelque colloque qu'ils soient, partagent ensemble ? N'ont-ils pas été propices à des échanges approfondis, quoique plus informels, entre scientifiques et littéraires ?
Colette Camelin : Autant le reconnaître, les repas n'ont pas été autant l'occasion que cela d'échanges croisés entre les participants des deux colloques et ce, pour une raison qui peut se comprendre : les participants de chaque colloque se connaissaient et avaient plaisir à se revoir à l'occasion de "leur" colloque. Il y eut donc assez peu de mélanges. Il en est cependant allé différemment entre les directeurs de colloque : personnellement, il m'est arrivé souvent de déjeuner avec Raphaël et Catherine pour faire un point d'étape ou juste pour le plaisir d'échanger avec eux, à table. En dehors des séances communes, les participants eurent une autre occasion de se retrouver ensemble : la journée "HORS LES MURS", en l'occurrence pour la visite des Falaises littorales de Carolles et Champeaux en haut desquelles nous avons pique-niqué après une demi-heure de marche ; et de la grande Noé, une ancienne carrière d'extraction de granit, objet d'actions de renaturation. Une double illustration, au passage, du "faire avec" et du "renouveau du sauvage".
Dans un cas comme dans l'autre, j'ai profité de la présence de botanistes participant à l'autre colloque, pour en savoir plus sur telle ou telle plante. À la grande Noé, nous avons aussi bénéficié des éclairages des experts de l'OFB de la Manche : ils nous ont présenté les espèces animales et végétales de retour dans le milieu, dont une petite plante qu'ils tiennent pour "un véritable miracle de la nature", et dont je ne résiste pas au plaisir de vous donner le nom exact [elle consulte ses notes] : l'hélianthème à gouttes, de son vrai nom latin Tuberaia Guttata ! [Rire].
Une illustration, cette fois, des "brassages planétaires", la thématique d'un autre colloque de Cerisy, organisé en août 2018 autour du jardinier-paysagiste Gilles Clément (paru sous le titre Brassages planétaires. Jardiner le monde avec Gilles Clément, sous la direction de Patrick Moquay et de Frédérique Mure, aux éditions Hermann, en 2020)…
Colette Camelin : Colloque auquel je n'ai pas assisté mais dont j'ai lu avec profit les actes.
Ce que vous dites là est l'occasion de rappeler l'importance de ces actes de colloque de Cerisy, qui permettent d'établir des filiations entre colloques, de montrer comment des idées creusent leur sillon de l'un à l'autre quand bien même leurs directeurs respectifs ne se connaissent pas forcément.
Colette Camelin : En effet. Pour ma part, je me suis appuyée sur les actes de plusieurs colloques ne serait-ce que pour ma contribution à l'avant-propos : Brassages planétaires, Le moment du vivant, Humains, animaux, nature : quelle éthique des vertus dans le monde qui vient ?, L'enchantement qui revient, Les animaux : deux ou trois choses que nous savons d'eux, La mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène ? Autour et en présence d'Augustin Berque et La démocratie écologique. Une pensée indisciplinée.
On mesure à travers la lecture de vos propres actes, les affinités que les deux colloques entretiennent avec des colloques antérieurs, selon une logique que je qualifierai de "rhizomatique", en référence bien sûr à Deleuze et Guattari. À se demander si un colloque de Cerisy ne vaut pas d'abord par sa capacité à nouer des liens, même invisibles de prime abord, avec d'autres colloques. Des liens qui sautent étrangement aux yeux quand on les remet en perspective…
Colette Camelin : J'en suis tellement convaincue que je ne peux m'empêcher de me replonger dans des actes, dans l'espoir d'y trouver un texte — une préface, une introduction, une communication… — qui m'ouvrira une brèche dans des domaines disciplinaires qui me sont nouveaux. Je viens de la littérature, et plus précisément encore de la poésie. J'ai donc besoin de m'acculturer aux savoirs proprement scientifiques. Et pour cela, les actes de colloques de Cerisy sont une source précieuse.
Je propose de laisser aux lecteurs le soin de découvrir la richesse de vos deux colloques en en lisant les actes communs, pour mieux en venir à la manière dont ceux-ci ont été conçus. D'ailleurs, l'idée d'un seul et même volume s'est-elle imposée d'emblée ?
Colette Camelin : Non, loin de là, pas plus que celle d'un seul et même colloque, ainsi que je l'ai dit. Dans un premier mouvement, nous avons considéré que puisque nous étions parvenus à distinguer des spécialités disciplinaires en les répartissant dans deux colloques distincts, nous pouvions envisager deux volumes. Sauf que très vite, nous nous sommes heurtés à un premier problème : que faire des communications programmées dans les séances communes ? Cela n'avait a priori pas de sens de les publier deux fois ! Il y eut bien une autre possibilité : les répartir dans l'un ou l'autre selon qu'elles avaient une tonalité plus scientifique ou littéraire. Mais on perdait alors l'acquis de la convergence opérée par les deux colloques.
Qu'est-ce qui vous a donc décidés à proposer deux actes en un ?
Colette Camelin : À la toute dernière séance consacrée au bilan des deux colloques, nous avions proposé aux deux représentants de l'OFB, Laurent Germain et Gérald Mannaerts, mandatés chacun pour assister à l'un des colloques, de nous faire leurs retours. Et ce qui nous a beaucoup touchés — moi en tout cas —, c'est que chacun avait tenu à dire le bien que leur avait fait, au regard du travail qu'ils devaient poursuivre au sein de leur institution, l'opportunité d'écouter les scientifiques, dont ils faisaient partie, mais aussi des "littéraires", car, disaient-ils, cela leur inspirait des moyens de mieux dialoguer avec le public, en plus de leur permettre de voir sous un autre jour les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Bref, ils avaient manifestement tiré profit de ces échanges improbables entre scientifiques et littéraires.
À partir de là, nous nous sommes dit que si nos séances communes avaient été bénéfiques à des esprits scientifiques, autant en faire profiter à un plus large public. De là, l'idée d'éditer les actes de nos deux colloques dans un seul volume.
Non sans proposer un titre spécifique…
Colette Camelin : En effet, en l'occurrence Faire avec le sauvage, renouer avec les vivants réfère aux deux colloques. Non sans reformuler les intitulés initiaux des colloques.
"Faire avec" : cela fait penser au livre d'Yves Citton (Faire avec. Conflits, coalitions, contagions, Les liens qui libèrent, 2021) qui en appelle, face aux défis de l'anthropocène, à "faire avec", en l'occurrence nos "ennemis d'hier" pour affronter les défis d'aujourd'hui. Ou encore à Baptiste Morizot qui, lui, promeut une "diplomatie" de la relation avec le vivant, et que vous citez d'ailleurs…
Colette Camelin : Effectivement, ce sont des auteurs que je lis avec beaucoup d'intérêt. Je conclus mon propre texte d'introduction (de la 3e partie) en citant notamment le second.
Raphaël avait lui-même distingué trois modes de relations des humains à la nature : un premier qui s'appuie sur la technique à des fins de domination ; un deuxième qui cherche à "faire avec", justement, en composant avec la nature comme on le ferait avec un partenaire dans une relation d'amitié ; enfin, un troisième mode consistant à… ne rien faire, autrement dit à laisser libre cours aux dynamiques naturelles partout où c'est possible.
Des trois modes, Raphaël privilégiait le deuxième, le "faire avec", soit une position intermédiaire entre le sauvage et le domestique, car — c'est une idée à laquelle il était attaché — il n'existe pas à proprement parler de frontière nette entre les deux : le sauvage peut se laisser domestiquer tandis que l'animal domestiqué peut redevenir sauvage — sans retrouver pour autant un état d'avant la domestication. Raphaël renouait en cela avec une notion romaine, cette du saltus, qui désigne cet espace intermédiaire entre la forêt, le domaine féral par excellence des bêtes sauvages (silva), et les espaces occupés ou exploités par les hommes (la ville, les terres agricoles). Une zone intermédiaire qui permettait de se livrer à des activités en dehors des normes sociales — la cueillette de champignons, faire l'amour en cachette, etc. — et qu'on retrouve abondamment évoquée en littérature sous une forme ou sous une autre : le "maquis de Montmartre" de Mac Orlan ; la "zone" d'Apollinaire, cette ceinture de Paris, héritée des anciennes fortifications, et qu'on associe aujourd'hui, en un sens péjoratif, aux "Banlieues".
Si, d'ailleurs, Raphaël a choisi "Le renouveau du sauvage" pour la composante du titre des actes relative à son colloque, c'est par réaction contre la tendance à voir dans les jeunes de ces dernières, des "sauvageons" : loin de faire partie d'un espace ensauvagé, ils vivent, insistait-il, dans des espaces intermédiaires au sens du saltus, propices donc à des échanges avec les deux autres espaces. S'ils ne sont pas à proprement parler dans la ville, ces jeunes n'en sont pas tout à fait à l'extérieur non plus. Ce titre souligne la dimension sociale et politique de la pensée de Raphaël, qu'il assumait en l'articulant à sa démarche scientifique.
Comment en êtes-vous venus à la seconde partie du titre, "Renouer avec les vivants", qui réfère davantage à votre colloque ?
Colette Camelin : D'abord, nous souhaitions passer de l'interrogation — l'intitulé du colloque — à une affirmation, pour être davantage dans une logique d'action. Les débats auxquels ont donné lieu le colloque nous y ont encouragés.
Sans entrer dans le détail du contenu de ces actes, je souhaiterais vous entendre sur le principe de leur structuration en trois parties, les deux premières consacrées à l'un des colloques (hormis une communication sur laquelle on pourra revenir), la 3e reprenant les communications des séquences communes et d'autres encore, de l'un ou l'autre des colloques…
Colette Camelin : Si, avec le recul, cette structuration paraît évidente, nous avons en réalité beaucoup hésité. Je ne cache pas non plus que si j'avais lu la préface de Lucile Schmid avant d'établir le plan, j'aurais proposé une autre structuration proche de ce qu'elle a su faire et qui me paraît plus que pertinent : tisser des liens entre les deux colloques, autour de thématiques transversales. Le résultat est remarquable. J'invite les lecteurs à lire cette préface !
Cela étant dit, Raphaël et moi étions étions contraints, mais aussi désireux, de ne pas rompre la cohérence interne à chaque colloque. La première partie regroupe ainsi des communications de scientifiques et de praticiens, tandis que la seconde, des analyses littéraires.
La troisième est plus novatrice. Si les contributions des séquences communes y trouvaient naturellement leur place (par exemple, l'entretien entre Gisèle Bienne, auteure de La Malchimie [Actes Sud, 2019] et Gilles-Éric Séralini, biologiste, spécialiste des OGM et des pesticides, de l'université de Caen qui a mis en évidence le caractère cancérigène du glyphosate), nous y avons ajouté des communications programmées initialement dans l'un ou l'autre des colloques. Par exemple, "Le sauvage du domestique : art brut et art de l'attention" de Joëlle Salomon Cavin, qui y relate notamment l'histoire d'une souris qui a grignoté le volume d'une œuvre de Raymond Queneau… ; "La recouvrance des noms de lieux "sauvages" au Québec et à Hokkaido", de Francine Adam et Augustin Berque — qui malheureusement ne purent assister au colloque.
Un texte fait exception : c'est celui de Jacques Tassin, agronome, qui traite de l'œuvre de Maurice Genevoix. Quoique programmé dans le colloque Le renouveau du sauvage, nous avons jugé pertinent de le placer dans la deuxième partie.
Au final, on peut parler d'actes uniques dans les "Annales" de Cerisy…
Colette Camelin : Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'équivalent, en effet.
Pourquoi, cependant, n'avoir mentionné que trois directeurs de colloque — outre vous-même, Raphaël Larrère et Alain Romestaing — au titre de directeurs des actes ?
Colette Camelin : Tout simplement parce que, tout en approuvant le principe de deux actes en un volume, les autres n'ont pas souhaité participer à leur édition, faute de disponibilité. Quand on sait le cloisonnement du milieu universitaire, je suis reconnaissante à Bénédicte Meillon de s'être déjà engagée dans la direction d'un colloque aussi atypique au regard de sa discipline et de sa volonté de dialogue avec un autre colloque organisé en parallèle.
Combien de temps se sera écoulé entre l'issue des colloques et la publication des actes…
Colette Camelin : C'est bien simple : les colloques ont eu lieu en juin 2023 et les actes sont sortis de presse en mai 2025, soit un peu plus d'un an et demi.
Soit un laps de temps relativement court au regard de la durée habituelle d'actes de colloques scientifiques comme d'ailleurs de Cerisy… Pour autant, l'édition des vôtres a-t-elle été un long fleuve tranquille ?
Colette Camelin : Non, loin de là ! [Rire]. D'abord pour les raisons que j'ai dites : il y eut de longues discussions avec Raphaël sur la constitution du sommaire. Mais ce qui a demandé le plus de temps a été la rédaction de l'avant-propos, que nous avons jugé utile d'ajouter aux introductions de chacune des trois parties. Il nous semblait nécessaire d'expliquer en quoi l'ouvrage tranche avec les actes de colloques habituels. Il y eut cependant un nombre considérable d'allers-retours entre nous trois pour parvenir à une version définitive. Malgré son état de santé, Raphaël y avait beaucoup travaillé et avait bouclé sa propre contribution avant son décès brutal. Mon dernier échange avec lui sur le sujet précède de quelques jours son décès.
Ce sont des avant-propos à l'image de ces colloques parallèles entrés en dialogue, et de leurs actes — baroques serais-je tenté de dire sans que cela en dévalorise la portée, au contraire. Vous y prenez le temps, les trois directeurs, de revenir sur vos parcours respectifs — exercice auquel se livrent trop rarement les directeurs d'actes, alors que cela permet de mieux comprendre la manière dont ils en sont venus au projet de leur colloque…
Colette Camelin : Je souscris à ce que vous venez de dire. Et c'est d'ailleurs en prenant ce parti — revenir sur nos trajectoires respectives — que nous nous en sommes sortis. Notre intention première était de produire un texte commun. Nous nous y sommes essayés, au prix de ces allers-retours que j'évoquais. Finalement, nous avons tenté une tout autre option : un seul et même texte, mais dans lequel chacun revient, à la première personne, sur la manière dont il en est venu à participer à ces colloques parallèles, ce qui l'y a prédisposé, sans oublier les circonstances ayant permis de concrétiser leur programmation.
Ce parti pris de l'écriture à la première personne ajoute à la singularité de ce texte introductif. L'idée m'en est venue d'un texte de Catherine Larrère, intitulé, justement, "Écrire à la première personne", que j'ai fait figurer dans le recueil Écrire avec les vivants… Je me souviens très bien avoir dit à Raphaël : "Écoute, nous ne parviendrons jamais à écrire un seul et même texte. Faisons comme le suggère Catherine !". Raphaël ne pouvait qu'obtempérer, ce qu'il fit au demeurant avec joie [Rire].
Iriez-vous jusqu'à parler d'"ego-discipline" en référence à ces modes d'écriture apparus dans certaines sciences humaines et sociales — l'ego-histoire ou l'ego-géographie — qui reviennent à reconnaître la part personnelle intervenant dans une démarche de recherche ?
Colette Camelin : Je me retrouve parfaitement dans ce mode d'écriture. D'ailleurs, je lis beaucoup de livres de sciences humaines et sociales qui s'en réclament.
Cela étant dit, cette fragmentation en trois temps n'allait-elle pas à l'encontre de la recherche de points de convergence ?
Colette Camelin : C'est là que le choix du titre de cet avant-propos a été décisif : "La nature férale et la "grammaire fauve"". Si nous voulions témoigner des ponts jetés entre les deux colloques, des discussions et des échanges partagés, du fait aussi d'avoir relu ensemble les différentes communications, il nous fallait trouver à exprimer cette jointure dans le texte liminaire. Le déclic s'est produit autour du principe de liberté. Raphaël insistait en particulier sur le fait que les animaux de la nature férale ont été préalablement domestiqués par des humains, avant de devenir sauvages, mais pas, comme je l'ai dit, au point de revenir à un état originel — un chien peut devenir féral sans pour autant se muer en loup. En revanche, il devient "libre". Or, ce qui caractérise le travail sur le langage en littérature, en poésie comme en prose, c'est précisément le fait de se libérer des idées toutes faites — j'ai été jusqu'à parler des "automatismes idéologiques" et des "éléments de langage". De fait, les figures littéraires libèrent la pensée, en permettant de faire des rapprochements insoupçonnés à travers des métaphores, des images et bien d'autres procédés discursifs. Ce dont je rends compte à travers cette expression de "grammaire fauve" sur laquelle je suis tombée un peu par hasard dans un texte de Henry David Thoreau, qui m'a été transmis par Bertrand Guest, contributeur de la 3e partie.
Ainsi, à travers l'évocation d'une libération, nous rapprochions deux mots, féral et fauve, qui réfèrent au sauvage et au vivant, et dans ce même mouvement, à nos deux colloques.
J'aime beaucoup cette idée de "grammaire fauve", car j'y vois une caractéristique de ces textes auxquels j'aime me confronter de plus en plus : des textes qui, loin d'une recherche de toute vulgarisation, assument la part d'"altérité" avec ce que cela suggère d'inconnu que comporte une langue, qu'elle soit littéraire ou scientifique. Et ce, quitte à ne pas comprendre de prime abord ce dont il retourne. Mais au moins cela suggère comme une terra incognita qu'il revient au lecteur, s'il le souhaite, d'explorer… Ce feedback un peu "sauvage", si je puis dire, fait-il sens pour vous ?
Colette Camelin : Oui, étant entendu que cette évocation du fauve comme du féral, est aussi une invitation à travailler l'altérité en soi-même. Ce que dit bien Catherine Larrère dans la préface de Humains, animaux, nature. Quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ?. Que sont ces vertus si ce n'est cette acceptation de travailler à fortifier sa liberté en soi, ce qui consiste nécessairement à rencontrer l'autre, à découvrir un autre monde, quitte à se risquer à changer son comportement, ses habitudes. Si je devais donc retenir une vertu de la littérature, ce serait celle-ci : une expérience de la libération de soi pour aller vers les autres…
Ce qu'a bien su résumer cet écrivain, dont j'ai un doute quant à l'identité (serait-ce André Gide ?), par ces mots : "Le plus court chemin de soi à soi passe par autrui"…
Colette Camelin : J'ignore si ces mots sont de lui, mais effectivement, c'est une autre manière de dire ce que j'exprimais à l'instant, étant entendu que cet "autrui" peut être aussi du vivant non humain.
Permettez-moi d'en venir à un sujet d'étonnement à la lecture de ces actes comme des colloques et de leurs séances communes : qu'ils n'aient pas été l'occasion de rappeler, que pour être scientifique, on n'en a pas moins possiblement un esprit littéraire. À avoir cherché des ponts, n'avez-vous pas escamoté le fait que des personnes les incarnent à leur façon, que des scientifiques n'ont pas besoin d'aller à la rencontre d'esprits littéraires, qu'ils en sont eux aussi…
Colette Camelin : Au début du colloque, les premières réactions des scientifiques ont été plutôt sur le registre d'une forme de dédain. Mais l'état d'esprit a changé au fil des échanges, jusqu'à la séance conclusive au cours de laquelle, comme je l'ai dit, deux scientifiques patentés, Laurent Germain et Gérald Mannerts, témoignaient de leur plaisir à entendre les intervenants littéraires, en voyant dans la littérature un moyen de mieux communiquer sur les avancées scientifiques mais aussi mieux comprendre les défis au plan humain. À défaut maintenant de pouvoir donner des exemples de scientifiques littéraires, en dehors de Raphaël et de Jacques [Tassin], je constate que des contributeurs scientifiques n'ont pas manqué de faire allusion, dans leur texte, à la littérature.
Finalement, que nous soyons scientifiques ou littéraires, nous partageons ce même humanisme soucieux de tous les vivants, sans distinguer les humains et les vivants autres qu'humains.
Au cours de l'entretien, vous avez fait état de votre volonté d'être dans l'action. Que répondrez-vous à ceux qui objecteraient que passer plusieurs jours dans un centre perdu au milieu de nulle part, en apparence déconnecté du monde, puis consacrer son temps et son énergie à établir des actes, ne sont pas les moyens les plus efficaces d'agir, de le faire en tout cas à la mesure de l'urgence des enjeux dont vous traitez… Je pose la question tout prenant soin de rappeler que le mot "actes" a quand même à voir avec celui d'action…
Colette Camelin : Il nous importait pour commencer de partager avec d'autres l'expérience de la rencontre entre littéraires et scientifiques et de son intérêt. Selon Elisée Reclus, les recherches scientifiques doivent être diffusées, informer les acteurs de la société civile, apporter des connaissances aux étudiants. Si des universités se montrent désireuses de promouvoir ce dialogue entre sciences et littérature — je pense en particulier à celles de Reims Champagne-Ardenne et de Poitiers —, en revanche, c’'est plus difficile dans d'autres. Or, littéraires et scientifiques en ont été convaincus : il importe de décloisonner, de sortir de ce genre de vision dualiste.
En cela, les actes ne sont pas l'aboutissement de la démarche que nous avons engagée il y a maintenant plus de six ans, si on remonte au plus loin de sa genèse. Ils marquent un nouveau commencement en ce sens où leur publication donnera lieu à des rencontres, des débats, ce qui constituent à mon sens autant d'actions. De premières rencontres sont prévues dès ce mois de septembre 2025 — le 19 septembre, une table ronde est organisée à la Sorbonne, à l'initiative de Catherine Larrère, Sandra Laugier, Lucile Schmid et moi-même, en hommage à Raphaël. Par ailleurs, Accustica (Association des acteurs de la culture scientifique de l'université de Reims Champagne-Ardenne), organisera une rencontre avec, outre la responsable de ce centre, des enseignants de l'université de Reims Champagne-Ardenne : le géographe Yann Calbérac qui connaît bien Cerisy pour y avoir organisé des colloques ; la biologiste Séverine Paris-Palacios qui travaille, elle, sur les effets des produits phytosanitaires sur les plantes. Une rencontre de l'association Université populaire écologique de la Marne est programmée le 3 novembre. À Poitiers, le philosophe Alexis Cukier cherche à organiser une présentation avec des littéraires et des scientifiques du laboratoire Ruralités.
À suivre, donc. En attendant, on aura la preuve que les actes d'un colloque ne sont pas condamnés à finir sur une étagère sans être consultés, mais qu'ils sont matière vivante, à même de voyager au gré de nouvelles initiatives et rencontres…
Colette Camelin : Permettez-moi de saluer encore les capacités de connexion d'Edith : elle a suggéré à Philippe Prévost, ingénieur agronome, de m'associer à l'organisation d'un colloque en 2027 : "Artistes et agriculteurs-paysans", avec Bernard Hubert, directeur de recherche à l'INRAe, le sociologue Bertrand Hervieu et l'artiste Julie Crenn. Une autre manière de faire vivre les actes, que ces codirecteurs ne manqueront pas de consulter, comme je l'ai fait avec ceux d'autres colloques. Nous cherchons des points de contact entre des démarches scientifiques et des approches poétiques qui "donnent à voir" le monde (Paul Éluard).
Propos recueillis par Sylvain ALLEMAND
Secrétaire général de l'AAPC