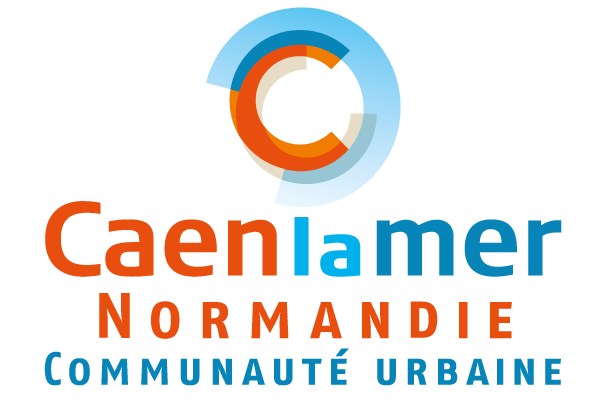1023-2023 : LE MONT SAINT-MICHEL EN NORMANDIE ET EN EUROPE
NOUVELLES DÉCOUVERTES ET NOUVELLES PERSPECTIVES DE RECHERCHE
DU MERCREDI 31 MAI (14 H) AU DIMANCHE 4 JUIN (14 H) 2023
[ colloque de 4 jours ]
ARGUMENT :
Prenant prétexte de l'anniversaire du lancement en 1023 de la reconstruction de l'abbatiale romane, ce colloque entend marquer un point d'étape sur les recherches sur le Mont Saint-Michel. Depuis le "millénaire monastique" de 1965-1966, aucune rencontre interdisciplinaire n'a proposé un état des lieux des travaux sur le Mont dans tous ses aspects (l'abbaye, la forteresse, le sanctuaire, le village…) et selon toutes les disciplines (histoire, archéologie, histoire de l'art, lettres…). En outre, si la rencontre s'inscrit dans le cycle de Cerisy sur la "Normandie médiévale" et accordera une large place au Moyen Âge, les périodes plus récentes seront aussi envisagées, notamment autour des questions de la prison (XIXe siècle) ou des restaurations contemporaines (XIXe-XXIe siècles). Elle posera aussi les questions de l'avenir du Mont Saint-Michel.
Dans cet esprit, largement ouvert aux auditeurs et soucieux de favoriser les échanges, ce colloque international accordera une large place à des tables rondes et à des interventions à plusieurs voix, dont celles de jeunes chercheurs. Il réunira à Cerisy, au Mont Saint-Michel et à Hambye tous les acteurs intéressés par les sujets traités, qu'ils soient impliqués dans la conservation du Mont, attachés à explorer ce domaine riche et polymorphe.
MOTS-CLÉS :
Architecture romane, Architecture gothique, Enfermement, Manuscrits, Monachisme, Mont Saint-Michel, Normandie médiévale, Pèlerinages
CALENDRIER DÉFINITIF :
Mercredi 31 mai
"HORS LES MURS" — AU MONT SAINT-MICHEL
12h: ACCUEIL DES PARTICIPANTS AUTOUR D'UN DÉJEUNER
13h15: Mot d'accueil
13h30: SÉANCE PUBLIQUE (Salle Henri Voisin) : Gaël CARRÉ & Fabrice HENRION : L'archéologie au Mont Saint-Michel depuis le XIXe siècle : état des lieux et perspectives
14h45: Visite de l'exposition "La demeure de l'archange. Art, architecture et dévotion à l'abbatiale du Mont Saint-Michel", guidée par Brigitte GALBRUN & Mathilde LABATUT ; puis temps libre au Mont Saint-Michel
18h: Départ pour Cerisy
19h: ACCUEIL DES PARTICIPANTS À CERISY
Soirée
Présentation du Centre, du colloque et des participants
Jeudi 1er juin
Matin
Ouverture du colloque, par Diane de RUGY
DE L'ABBATIALE ROMANE À LA PRISON (I) — Présidence : Cécile LAGANE
Véronique GAZEAU : Introduction
Camille CANTELOUP : Les collections de l'abbaye du Mont Saint-Michel : bilan de l'inventaire et perspectives
Éliane VERGNOLLE : Le chevet roman du Mont Saint-Michel. Une œuvre majeure du second quart du XIe siècle
Yves GALLET : La date du cloître du Mont Saint-Michel au regard de l'iconographie franciscaine et de son évolution au XIIIe siècle
Après-midi
DE L'ABBATIALE ROMANE À LA PRISON (II) — Présidence : Mathilde LABATUT
Décrypter la merveille, table ronde avec Katrin BROCKHAUS et Elen CADIOU (La Merveille : un édifice emblématique décrypté par l'archéologie)
Falk BRETSCHNEIDER & Élisabeth LUSSET : De l'abbaye à la prison : les transformations du Mont Saint-Michel à l'aune des autres abbayes-prisons au XIXe siècle [communication établie avec Isabelle HEULLANT-DONAT]
Bertrand MARCEAU : Prison et monastère : le Mont Saint-Michel d'après la visite de mars 1786
Soirée
Grand entretien, avec François JEANNEAU et Philippe ROCHAS, animé par Mathilde LABATUT
Vendredi 2 juin
Matin
LE VILLAGE, LA NORMANDIE, LA CHRÉTIENTÉ — Présidence : Pierre BAUDUIN
Hélène BILLAT : Le bourg fortifié du Mont Saint-Michel et ses maisons : typologie de l'habitat et morphologie urbaine
Bastien MICHEL : Servir saint Michel : les clientèles guerrières du Mont (XIIe-XIIIe siècles) [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]
Laurent MORELLE : L'exemption du Mont Saint-Michel : un cas d'étude à la lumière des travaux récents
Richard ALLEN : Le chartrier perdu du Mont Saint-Michel : réseaux, échanges et construction spatiale dans le diocèse d'Avranches (XIe-XIIIe s.)
Après-midi
Échanges autour d'une exposition, textes, œuvres plastiques et mises en voix réalisés par des élèves de 6e du Collège Anne Heurgon-Desjardins de Cerisy
ÉCRIRE AU MONT SAINT-MICHEL — Présidence : Laurence JEAN-MARIE
Lucie ARBERET, Stéphane LECOUTEUX, Anne MICHELIN & Laurianne ROBINET : L'évolution des pratiques des copistes et des artistes du scriptorium du Mont Saint-Michel au XIe siècle
Benjamin POHL : L'atelier de l'abbé-historien du Mont Saint-Michel : Robert de Torigni, où a-t-il écrit ?
Pierre BOUET & Denis BOUGAULT : Le crâne dit de saint Aubert : de la pratique chirurgicale à la pratique cultuelle
Soirée
L'œuvre de Pierre Bouet autour de l'archange. Du Mont Saint-Michel au Monte Gargano, animée par Marie-Agnès LUCAS-AVENEL et François NEVEUX (Pierre Bouet, de l'université aux colloques normands de Cerisy), avec la participation de Pierre BOUET, Edith HEURGON et Angela LAGHEZZA (Hommage à Giorgio Otranto)
Samedi 3 juin
Matin
HAGIOGRAPHIE ET LITURGIE — Présidence : Marie-Agnès LUCAS-AVENEL
Fabien PAQUET : Des abbés contre leur couvent ? Le gouvernement abbatial au Mont Saint-Michel à la fin du XIIe et au XIIIe siècle
Catherine JACQUEMARD : Hagiographies et reliques fondatrices du Mont Saint-Michel : hypothèses de datation et de lecture
Marie FREY REBEILLÉ-BORGELLA : Le Mont Saint-Michel dans l'histoire des Bibles latines : analyses sur le texte biblique des manuscrits Avranches BM 1 et Avranches BM 2-3
Louis CHEVALIER : Le culte liturgique de saint Aubert au Mont Saint-Michel (XIe-XVe siècles)
Après-midi
"HORS LES MURS" — À L'ABBAYE DE HAMBYE
IMAGES DU MONT — Présidence : Christophe MANEUVRIER
David FIASSON : De l'histoire au patrimoine. Le Mont Saint-Michel à la fin du Moyen Âge dans le roman, la bande dessinée et les séries télévisées francophones (XXe siècle)
Anne CURRY : Le Mont Saint-Michel dans la perception anglaise, du Moyen Âge à nos jours
Visite de l'abbaye de Hambye
Soirée
Chants par Anne CURRY, accompagnée au piano par François NEVEUX
Dimanche 4 juin
Matin
DE L'ITALIE À LA NORMANDIE — Présidence : Angela LAGHEZZA
Vincent JUHEL : Pèlerins et routes vers le Mont Saint-Michel, un point des recherches
Ada CAMPIONE : Le Chronicon sancti Michaelis monasterii in pago Virdunensi et la tradition michaélique européenne : texte, contextes, pèlerinages
Fabio LINGUANTI : Le monastère de Saint-Michel-Archange de Troina. Un "Mont Saint-Michel" dans la Sicile normande ?
Catherine VINCENT : Conclusions
Après-midi
DÉPARTS
RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :
Mathilde LABATUT
Mathilde Labatut est conservatrice des Monuments Historiques à la DRAC de Normandie (site de Caen). Elle est plus particulièrement en charge du département du Calvados et de la Manche.
Christophe MANEUVRIER
Christophe Maneuvrier est maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l'université de Caen Normandie où il est aussi directeur-adjoint de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines. Ses travaux portent en particulier sur l'histoire économique et sociale de la Normandie. Il a déjà co-dirigé plusieurs colloques à Cerisy.
Fabien PAQUET : Des abbés contre leur couvent ? Le gouvernement abbatial au Mont Saint-Michel à la fin du XIIe et au XIIIe siècle
Cette communication se fondera d'abord sur une démarche prosopographique, afin de proposer des éléments sur les abbés du Mont Saint-Michel du XIIe siècle et du XIIIe siècle. Un court temps sera consacré à l'identification de leur profil général afin de le comparer aux autres supérieurs de la même époque et d'identifier de potentielles spécificités — à cet égard, les abbés du Mont apparaîtront relativement "banals". Ce sera également l'occasion de présenter en quelques mots un outil en cours de développement à l'université de Caen Normandie, E-Personae, qui permet de constituer, éditer, publier et exploiter des notices prosopographiques à l'aide du langage XML. La communication portera ensuite sur l'étude de la crise — car tel semble bien être le mot qu'il faut prononcer — du gouvernement abbatial au Mont dans les premières décennies du XIIIe siècle. Le couvent paraît en effet être alors le lieu de conflits entre les moines et leur abbé (et probablement entre les moines). Même s'il faut prendre garde à ne pas surinterpréter les choses — ce qui ressort des sources correspond toujours aux anomalies —, la situation semble alors explosive à plusieurs titres et ira jusqu'à l'accusation du meurtre de deux moines par leur abbé. Je rouvrirai le dossier en repartant du plus près des sources, et notamment du ms. 149 de la bibliothèque d'Avranches.
Fabien Paquet est maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Caen Normandie, où il co-dirige également l'Office Universitaire d'Études Normandes (OUEN, MRSH). Ses recherches portent sur l'histoire religieuse des mondes normands médiévaux (en particulier le monde monastique) et sur l'écriture de l'histoire au Moyen Âge.
Publication
Maîtriser le temps & façonner l’histoire. Les historiens normands au Moyen Âge (dir.), Colloque de Cerisy, Presses universitaires de Caen, 2022.
Richard ALLEN : Le chartrier perdu du Mont Saint-Michel : réseaux, échanges et construction spatiale dans le diocèse d'Avranches (XIe-XIIIe s.)
Parmi les fonds d'archives détruits lors du bombardement allié de Saint-Lô le 6 juin 1944, les collections médiévales de l'abbaye du Mont Saint-Michel occupaient une place numériquement et qualitativement de premier rang. Presque 3000 articles et 1500 sceaux ont été en effet réduits en cendres, dont le contenu exact nous échappe faute non seulement d'un inventaire publié mais de toute autre description détaillée. Or, si les documents originaux qui composaient le chartrier médiéval du Mont Saint-Michel nous sont aujourd'hui perdus, les chartes de l'abbaye ont fait l'objet de copies d'érudits dès le XVIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, alors qu'un inventaire médiéval de presque 1500 titres nous donne un aperçu de l'état des archives montois vers la fin du Moyen Âge. Cette communication a pour but d'approfondir la réflexion sur ces documents conservés aujourd'hui de manière éparpillée dans les fonds de plusieurs archives et bibliothèques, tant (inter)nationaux que locaux. Ce faisant, on ne vise pas à une "reconstitution" du chartrier montois, un desideratum qui dépasse largement le cadre de cette communication, mais à en utiliser certaines parties comme outil pour aborder plusieurs questions que propose d'examiner ce colloque, dont les réseaux dans lesquels les religieux montois s'inscrivaient, la façon dont ils ont géré au quotidien leurs domaines, et le rôle joué par l'abbaye dans la construction spatiale du diocèse frontière dans lequel elle se situait.
Richard Allen est chercheur et archiviste à Magdalen College, Oxford. Ses recherches portent sur l'histoire ecclésiastique du monde anglo-normand du XIe au XIIIe siècle. Ses travaux s'articulent principalement autour de l'édition critique de chartes et il prépare actuellement la publication des actes épiscopaux normands pour le projet Les actes épiscopaux français du Moyen Âge : édition multimodale et exploitation (ACTÉPI). Il s'intéresse aussi aux pratiques documentaires en Normandie et en Europe du Nord-Ouest, à la culture de l'écrit médiéval et à l'histoire des abbayes avranchaises du Mont Saint-Michel et de Savigny.
Lucie ARBERET, Stéphane LECOUTEUX, Anne MICHELIN & Laurianne ROBINET : L'évolution des pratiques des copistes et des artistes du scriptorium du Mont Saint-Michel au XIe siècle
Le projet d'Étude Matérielle des Manuscrits Anciens du Mont Saint-Michel (2018-2022) a permis d'analyser les matériaux — parchemins, encres et matières colorantes — entrant dans la composition d'une cinquantaine de manuscrits aujourd'hui conservés à la bibliothèque patrimoniale d'Avranches et produits par le scriptorium du Mont Saint-Michel entre 980 et 1100. Les pratiques des copistes et des artistes actifs durant cette période ont ainsi pu être caractérisées et leurs évolutions ont pu être suivies sur environ 120 ans. Plusieurs ruptures importantes sont apparues, tant dans l'usage des parchemins que dans le choix des matières colorantes (en particulier pour le rouge et le jaune). Elles offrent à l'historien de précieux critères d'identification et de datation, ce qui a permis de corriger plusieurs attributions erronées antérieures. L'objectif de cette communication à quatre voix, réunissant trois physico-chimistes et un historien, est de présenter de manière synthétique et contextualisée l'ensemble des résultats acquis par l'équipe du Centre de Recherche sur la Conservation au terme de cinq années de travail. Grâce à une approche comparative, ces résultats sont replacés dans une perspective plus large, notamment anglo-normande.
Lucie Arberet est doctorante en physico-chimie. Elle a été recrutée en 2018-2019 pour la coordination des campagnes d'analyse matérielle du projet "Étude matérielle des manuscrits anciens du Mont Saint-Michel" en tant qu'ingénieur d'étude du CNRS pour le Centre de Recherche sur la Conservation. Elle mène, depuis 2020, une thèse de doctorat visant à identifier et à caractériser les colorants d'un manuscrit produit en Amérique centrale au XVIe siècle (soutenance le 15 mars 2023).
Stéphane Lecouteux est ingénieur de recherche en analyse de sources anciennes à l'université de Caen Normandie au sein du "pôle Document numérique de la MRSH" et membre associé du CRAHAM. Depuis 2018, il co-dirige, avec Laurianne Robinet, le projet "Étude matérielle des manuscrits anciens du Mont Saint-Michel".
Anne Michelin est physico-chimiste, maître de conférences du Muséum national d'Histoire naturelle et rattachée au Centre de recherche sur la conservation. Dans ce laboratoire, elle est responsable du "pôle Couleur et effets visuels". Depuis 2022, elle coordonne l'archivage mutualisé et interopérable des données matérielles du patrimoine écrit au sein du projet Equipex Biblissima+ (cluster 2).
Laurianne Robinet est physico-chimiste, ingénieure de recherche du Ministère de la Culture au sein du Centre de Recherche sur la Conservation (CRC). Dans ce laboratoire, elle est responsable du "pôle Cuir et parchemin". Depuis 2018, elle co-dirige, avec Stéphane Lecouteux, le projet "Étude matérielle des manuscrits anciens du Mont Saint-Michel" (EMMA du MSM).
Hélène BILLAT : Le bourg fortifié du Mont Saint-Michel et ses maisons : typologie de l'habitat et morphologie urbaine
Édifié d'est en ouest sur un rocher escarpé, le village du Mont Saint-Michel tire sa singularité de son implantation topographique, de son histoire étroitement liée au destin de l'abbaye et de son enceinte fortifiée qui a conditionné sa forme urbaine. Intégralement protégé par le rempart au XIVe siècle, l'habitat s'est constitué en interaction avec son environnement monumental et naturel, se transformant au gré des usages et des évolutions des techniques de construction. Destructions, (re)constructions, restaurations, réhabilitations et reconversions ont notablement modifié la physionomie du village au cours des siècles, en particulier son identité architecturale mais aussi ses réseaux (de circulation et de distribution) et son parcellaire. De 1875 au 4e quart du XXe siècle, l'administration culturelle prend de nombreux arrêtés de protection alors que le village connaît une mutation de son habitat avec le retour des pèlerinages et l'avènement du tourisme. Cette période a remodelé le tissu urbain du bourg pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Hélène Billat est chercheur à l'Inventaire général du patrimoine culturel attachée au Service Patrimoine et Inventaire de la Région Normandie depuis 2013. Ses travaux, portant essentiellement sur des sites patrimoniaux et des territoires ruraux, ont fait l'objet de publications diverses notamment dans les collections de l'Inventaire général. Elle mène actuellement un inventaire topographique du village du Mont Saint-Michel faisant l'objet d'une convention de partenariat scientifique et technique avec l'État et les collectivités territoriales (2020-2023).
Falk BRETSCHNEIDER, Isabelle HEULLANT-DONAT & Élisabeth LUSSET : De l'abbaye à la prison : les transformations du Mont Saint-Michel à l'aune des autres abbayes-prisons au XIXe siècle
En 1791, le Code pénal français fait de l'enfermement la principale manière de punir. Nombre d'abbayes, devenues biens nationaux, sont transformées en prisons ou en maisons de détention : l'Abbaye-aux-Dames en Saintonge, La Sauve-Majeure en Gironde, Clairvaux ou encore le Mont Saint-Michel, prison pour les détenus politiques jusqu'en 1844 et de droit commun des deux sexes jusqu'en 1863. Prenant appui sur les dépouillements effectués aux Archives nationales à l'occasion de la production du webdocumentaire Le cloître et la prison. Les espaces de l'enfermement (2018) et plus largement dans le cadre du programme de recherche Enfermements (2009-2020), cette communication propose d'examiner les multiples transformations spatiales du Mont Saint-Michel (qui servait déjà de prison pour les moines de la congrégation de Saint-Maur depuis la fin du XVIIe siècle et de prison royale au XVIIIe siècle) pour s'adapter à sa nouvelle fonction carcérale. Appréhendés à partir des devis, rapports et plans produits par les architectes du département de la Manche ainsi que par l'administration pénitentiaire, les réaménagements constants de l'espace carcéral seront comparés à ceux effectués dans d'autres abbayes-prisons comme Fontevraud ou Clairvaux. Cette communication s'interrogera sur les continuités et les discontinuités dans les usages des espaces entre la période monastique et la période carcérale.
Falk Bretschneider est Historien moderniste, maître de conférences HDR à l'École des hautes études en sciences sociales (centre Georg Simmel, UMR 8131), il travaille sur l'histoire de l'enfermement dans l'espace germanique, en s'intéressant notamment aux aspects spatiaux des prisons modernes.
Isabelle Heullant-Donat est Historienne du Moyen Âge, professeur à l'université de Reims Champagne Ardenne (CERHiC-EA 2616), elle travaille sur l'histoire culturelle et religieuse entre XIIe et XVe siècle et sur l'histoire des enfermements monastiques et carcéraux.
Élisabeth Lusset est Historienne du Moyen Âge, chargée de recherche au CNRS (LAMOP, UMR 8589), elle travaille sur l'histoire des ordres religieux et des justices d'Église.
Bibliographie commune
I. Heullant-Donat, J. Claustre et É. Lusset (dir.), Enfermements. Le cloître et la prison (VIe-XVIIIe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 [en ligne].
I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset et F. Bretschneider (dir.), Enfermements II. Règles et dérèglements en milieux clos (IVe-XIXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 [en ligne].
I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset et F. Bretschneider (dir.), Enfermements III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (XIIIe-XXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2017 [en ligne].
I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset et F. Bretschneider, Le cloître et la prison. Les espaces de l'enfermement, 2018 [en ligne].
Katrin BROCKHAUS
Katrin Brockhaus a fait ses études d'histoire de l'art à Fribourg (Allemagne) et à Paris. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2005, avait pour objet l'architecture de l'abbatiale de la Trinité de Fécamp. Depuis, elle continue ses recherches sur l'architecture normande du Moyen Âge, en particulier en Basse-Normandie.
Elen CADIOU
Elen Cadiou est responsable d'opération, spécialiste en archéologie du bâti, Inrap Bretagne (UMR 6566-CReAAH).
Publications
Cadiou-[Esnault] E., "Le cloître de l'abbaye du Mont Saint-Michel (Manche) : apports de l'étude du bâti et des sols", dans Journées archéologiques de Normandie. Rouen, 20 et 21 avril 2018, PURH, 2021, p. 105-118.
Cadiou E., Caligny Delahaye F., Carre G., "L'apport primordial de l'archéologie à l'histoire du Mont Saint-Michel et à sa valorisation", dans Archéopages, Hors-série, n°6, Paris : Inrap, Octobre 2022, p. 398-413.
Ada CAMPIONE : Le Chronicon sancti Michaelis monasterii in pago Virdunensi et la tradition michaélique européenne : texte, contextes, pèlerinages
En prenant comme référence le Chronicon sancti Michaelis monasterii in pago Virdunensi, l'objectif de ce travail est d'étudier les relations de Saint-Mihiel avec d'autres sanctuaires michaéliques en Italie et en Europe. La relation la plus évidente est avec le sanctuaire du Monte Gargano, auquel l'établissement de Saint-Mihiel, semble être lié dès sa fondation : le comte Wolfand s'y rendit en pèlerinage en 709 et prit quelques pignora pour fonder un sanctuaire dédié à l'Archange à son retour. Mais, en plus de cela, le Chronicon offre des aperçus d'enquête : pensez à la dynamique liée à la sacralisation de l'espace ; à la valeur de la recherche de nouvelles reliques pour effacer l'importance et la mémoire des "reliques" michaéliques ; à la rivalité avec le sanctuaire du Mont Saint-Michel — et peut-être avec d'autres sanctuaires français — surtout au XIe siècle ; aux relations avec des interlocuteurs religieux et aussi politiques.
Ada Campione, est Professeur Associé (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Université de Bari Aldo Moro). Ses recherches portent sur l'origine et la diffusion du culte de saint Michel en Italie et Europe ; culte de saints et hagiographie du haut Moyen Âge en Italie du Sud ; sanctuaires chrétiens, espaces sacrés et pèlerinages ; christianisation et formation des diocèses en Occident ; épîtres papales et actes conciliaires par rapport au vécu des communautés chrétiennes.
Camille CANTELOUP : Les collections de l'abbaye du Mont Saint-Michel : bilan de l'inventaire et perspectives
Si le Mont Saint-Michel a été largement étudié dans ses aspects historiques, archéologiques ou environnementaux, il a plus rarement été envisagé du point de vue de l'histoire de l'art et de ses objets mobiliers. Malgré le peu d'œuvres présentées au public dans l'abbatiale, qui pourrait laisser croire à un monument vide de collections, l'architecte en chef Pierre-André Lablaude recensait pourtant déjà 617 biens culturels dans son inventaire de 1991. Partant de cette enquête fondamentale, qui elle-même se basait sur les inventaires anciens de Paul Gout (1913), de l'abbé Lechat (1971) et du catalogue du Millénaire de 1966, le Centre des monuments nationaux publiera en 2023 l'inventaire réglementaire des collections de l'abbaye, enrichi et actualisé selon le protocole en vigueur. Ce colloque sera ainsi l'occasion de dresser le bilan des différentes enquêtes in situ et de faire le point sur des collections encore méconnues. De la phase de recherche à la diffusion des données, ce travail permet de dresser un état précis du statut de propriété des biens, et offre une vision complète de l'intégralité des collections conservées dans ce monument. Éléments lapidaires déposés, objets de fouilles médiévaux, vestiges issus de l'époque carcérale, essais de restitutions pendant les restaurations du XIXe et XXe siècle, mobilier liturgique moderne… À l'image du Mont, les collections sont plurielles et croisent des approches historiques, sociales et religieuses. La clôture de l'inventaire, première étape vers de plus amples recherches, ouvre de nouvelles perspectives en terme de conservation, restauration et présentation au public.
Diplômée de l'École du Louvre et de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, Camille Canteloup est Référente collections au Centre des monuments nationaux. Après avoir travaillé au service de l'Inventaire et du Récolement des collections, au sein duquel elle a réalisé l'inventaire des collections de l'abbaye du Mont Saint-Michel, elle est aujourd'hui en charge de la conservation et de la restauration des collections des monuments gérés par le Centre des monuments nationaux (Pôle Ouest).
Gaël CARRÉ & Fabrice HENRION : L'archéologie au Mont Saint-Michel depuis le XIXe siècle : état des lieux et perspectives
L'apport de l'archéologie à la connaissance de l'évolution de l'abbaye, du village et de ses fortifications, émerge au cours du XIXe siècle, à l'initiative des architectes des monuments historiques. Depuis ces vingt dernières années, le regard d'archéologues professionnels ou agissant dans le cadre de travaux de recherche est venu compléter et réinterroger des observations ou des hypothèses déjà anciennes. Dans le même temps, des lacunes dans la connaissance de plusieurs endroits ou parties de construction persistent également. Au regard de tels constats, cette communication propose de revenir rapidement sur quelques secteurs clefs des origines de l'abbaye, tels l'incontournable Notre-Dame-sous-Terre et autres vestiges gravitant dans son environnement et dont la compréhension archéologique reste à poursuivre, mais aussi de rappeler l'apport nouveau de l'archéologie pour la connaissance de l'évolution du village médiéval (traces d'occupation et inhumations récemment observées) et de ses fortifications. Dans le même esprit, une attention sera portée à d'autres composantes moins connues, en raison d'études archéologiques inachevées ou inédites (évocation, par exemple, de constructions participant à la délimitation du front sud de l'abbaye ou contribuant à sa fortification ou, encore, de rares maçonneries antérieures aux XVe-XVIe siècles et repérées très ponctuellement dans l'emprise actuelle du village). Quelques pistes de recherche ou secteurs restant à explorer, ou pouvant faire l'objet de compléments d'étude, pourront être signalés également.
Gaël Carré est ingénieur d'études au Service régional de l'Archéologie de la DRAC de Normandie (site de Caen) et membre associé du CRAHAM. Spécialiste d'archéologie du bâti, il assure au sein du SRA des missions de gestion administrative et scientifique du patrimoine archéologique dans les contextes attachés aux monuments historiques. Il intervient en particulier dans les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne.
Fabrice Henrion est conservateur régional adjoint de l'archéologie au service régional de l'archéologie de la DRAC de Normandie (site de Rouen), archéologue médiéviste et spécialiste d'archéologie du bâti.
Louis CHEVALIER : Le culte liturgique de saint Aubert au Mont Saint-Michel (XIe-XVe siècles)
Saint Aubert fut évêque d'Avranches et le fondateur du sanctuaire du Mont Saint-Michel (v. 708-709). Il occupe une place centrale dans le récit de la Revelatio, rédigé vers l'an mil, qui relate l'apparition de saint Michel sur le Mont Tombe. Cependant, l'examen des remaniements secondaires opérés sur le sacramentaire Rouen, Bibl. patr., ms mm 15 (suppl. CGM 116) laisse penser que le culte liturgique d'Aubert n'a pas été développé par les moines du Mont avant la seconde moitié du XIe siècle. Cette communication a pour but de décrire les sources liturgiques montoises dédiées à saint Aubert, et de reconstituer les différentes expressions du culte liturgique du saint par une analyse de l'office, de la messe, des suffrages et des litanies de l'abbaye. Elle sera également l'occasion d'éclairer l'usage cultuel des reliques d'Aubert, décrit par les ordinaires Avranches, Bibl. patr., ms 46 et ms 216 ; et de s'interroger sur le degré de parenté de l'ordo de la fête du 18 juin dans les liturgies du Mont et du diocèse d'Avranches.
Ingénieur de recherche (CRAHAM-Centre Michel de Boüard - Université de Caen Normandie), Louis Chevalier a soutenu en 2019 une thèse d'histoire consacrée à l'étude et à l'édition critique et numérique des deux ordinaires liturgiques du Mont Saint-Michel (XIVe-XVe s.).
Anne CURRY : Le Mont Saint-Michel dans la perception anglaise, du Moyen Âge à nos jours
Pour l'historien de la Guerre de Cent ans, le Mont Saint-Michel est fameux pour être le seul lieu du duché de Normandie que les Anglais ne sont jamais parvenus à conquérir au XVe siècle. Mais il y a bien d'autres raisons pour que le Mont occupe une place spéciale dans l'histoire des Anglais à travers l'histoire. Il a ainsi inspiré la création d'une imitation anglaise à St Michael's Mount, un lieu de pèlerinage possédé par les moines du Mont Saint-Michel jusqu'au règne d'Henri V. Ce roi l'a en effet confisqué pour le donner à sa nouvelle fondation de Syon, qui est le dernier monastère fondé en Angleterre avant la Réforme. Depuis le XVIIIe siècle, par ailleurs, le "vrai" Mont Saint-Michel est devenu un site de pèlerinage artistique et touristique pour les Anglais, et plus généralement pour le monde anglophone. Le but de cette communication sera de retracer cette construction et d'examiner les manifestations de cet intérêt dans la peinture et la littérature, mais aussi dans la culture populaire, par exemple visible dans les réseaux sociaux, où le Mont Saint-Michel apparaît comme "a real life Harry Potter town".
Anne Curry est professeure émérite d'histoire médiévale à l'université de Southampton. Elle est spécialiste de la guerre de Cent Ans, et en particulier de la Normandie lancastrienne et de la bataille d'Azincourt. Outre de nombreuses publications sur ces sujets et d'autres, elle vient de publier avec Rémy Ambülh : A Soldiers' Chronicle of the Hundred Years War. College of Arms manuscript M9, Cambridge, Brewer, 2022.
Véronique GAZEAU : Introduction
Cette intervention visera à faire un tableau des productions scientifiques depuis le colloque du Millénaire du Mont Saint-Michel en1966, publié sous la forme de six volumes entre 1967 et 2005.
Véronique Gazeau, professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen Normandie, membre associée du CRAHAM, directrice des Annales de Normandie, est spécialiste de l'histoire de la Normandie ducale. Ses travaux portent sur les institutions religieuses, régulières et séculières, sur l'aristocratie, sur les modèles de sainteté et sur l'historiographie. Elle prépare une traduction de la Vita et des lettres de Lanfranc (1010-1089), moine du Bec, abbé de Saint-Étienne de Caen et archevêque de Cantorbéry.
Publications récentes
"911-1911. La Normandie dans l'histoire : trois historiens au début du XXe siècle. Charles Homer Haskins, Gabriel Monod, Henri Prentout", dans Les historiographies des mondes normands, XVIIe-XXIe siècle. Construction, influence, évolution. Actes du colloque d'Ariano Irpino (9-10 mai 2016), dir. Pierre Bauduin, Edoardo D'Angelo, Caen-Ariano Irpino, Presses universitaires de Caen-Centro Europeo di Studi Normanni (Coll. "Symposia"), 2022, p. 47-59.
"Réformateur ou stratège ? L'évêque Odon, patron des moines de Saint-Vigor et commanditaire de la Tapisserie de Bayeux", dans Évêques et communautés religieuses dans la France médiévale, dir. Noëlle Deflou-Leca et Anne Massoni, (Colloque introductif ANR Col&mon, Grenoble 10-12 mai 2017), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022, p. 318-341.
Catherine JACQUEMARD : Hagiographies et reliques fondatrices du Mont Saint-Michel : hypothèses de datation et de lecture
La mémoire des origines du Mont Saint-Michel s'enracine dans deux hagiographies anonymes qui, aux confins du mythe et de l'histoire, ont doté le sanctuaire d'un passé compatible avec sa notoriété ultérieure : la Revelatio ecclesiae sancti Michaelis et le *De miraculis in Monte Sancti Michaelis patratis. Or les deux textes présentent des divergences notables sur la question des reliques de l'Archange et de l'évêque fondateur alors que leur réputation d'authenticité et d'efficacité représentait un enjeu considérable pour l'essor du sanctuaire. À partir de cette observation, j'ai été conduite à discuter la datation communément admise de la Revelatio et à vérifier la plausibilité d'une attribution de l'œuvre à la fin du Xe siècle. J'ai ensuite exploré la possibilité de lire la Revelatio comme narratio fabulosa projetant dans l'entente archétypale des héros fondateurs Aubert et Bain un accord contemporain entre l'évêque Norgod et l'abbé Mainard, visant à la (ré)introduction au Mont de chanoines sous la dépendance de l'évêque d'Avranches.
Catherine Jacquemard est professeur émérite de langue et littérature latines à l'université de Caen Normandie, membre associé du Centre Michel De Boüard (Craham, UMR 6273). Ses recherches sont axées sur les humanités numériques et les sources écrites du Mont Saint-Michel, en particulier dans le cadre des programmes Ex monasterio sancti Michaelis (avec participation à la mise en œuvre de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel) et des Equipex Biblissima et Bilblissima+.
Vincent JUHEL : Pèlerins et routes vers le Mont Saint-Michel, un point des recherches
Le Mont Saint-Michel acquit dès le IXe siècle une dimension internationale par le rayonnement de son sanctuaire de pèlerinage. La première mention d'un "chemin montais" date de 1025 et les occurrences sont plus nombreuses au bas Moyen Âge. Cependant les pèlerins et les autres voyageurs empruntaient les mêmes axes sans qu'il y ait de chemins spécifiques aux pèlerins. Cette communication fera le point des recherches sur les différents axes empruntés par les pèlerins, en commençant par la restitution de l'itinéraire suivi par les religieux envoyés au Monte Gargano par Aubert en 709 et connu par le Roman du Mont Saint-Michel. Seront aussi utilisées les données des différents voyages cités dans les Vitae ou fournies par des témoignages directs de pèlerins de la fin du Moyen Âge, notamment des Allemands.
Vincent Juhel est Historien et historien de l'art, administrateur général des Antiquaires de Normandie, chercheur et animateur de l'association des Chemins du Mont-Saint-Michel, qui depuis vingt-cinq ans restitue progressivement des chemins balisés vers le Mont pour les miquelots du XXIe siècle et anime la recherche scientifique sur l'histoire des pèlerinages au Mont et de tous les thèmes qui y sont associés (organisation de "Rencontres historiques" éditées à chaque fois, publication d'articles, organisation d'expositions…).
Fabio LINGUANTI : Le monastère de Saint-Michel-Archange de Troina. Un "Mont Saint-Michel" dans la Sicile normande ?
La construction du monastère de Saint-Michel-Arcangé de Troina (1090) a été ordonnée par le Grand Comte Roger d'Hauteville, qui l'a confiée à la communauté italo-grecque et a nommé abbé le bénédictin Robert, déjà évêque de Troina, ville choisie comme centre d'organisation de la conquête normande de la Sicile (1061-1091) et siège du premier évêché refondé sur l'île (1082). Sa position stratégique, sur une montagne juste à l'extérieur de la ville, garantissait au monastère le contrôle d'une partie considérable de la Sicile orientale. Cependant, malgré le rôle important qu'il a joué dans l'administration du pouvoir normand sur l'île, on sait peu de choses sur la forme du monument à l'époque de sa fondation, en raison des modifications qu'il a subies entre les XVIe et XVIIe siècles et de son abandon progressif. Des investigations récentes offrent cependant de nouvelles indications sur l'aspect originel du complexe monastique et en particulier de son église, située sur le point culminant du site, dont le plan semble découler directement de la tradition architecturale du duché de Normandie.
Bibliographie
J. BECKER, Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e di Sicilia, Rome 2013, pp. 121-122 et doc. 7, 21, 25.
G. C. CANALE, Strutture architettoniche normanne in Sicilia, Palerme, 1959.
G. C. CANALE, Aspetti della cultura architettonica religiosa del sec. XI in Sicilia e in Calabria, en "Cronache di archeologia e Storia dell'Arte", 6, 1967, pp. 92-106.
F. LINGUANTI, La cattedrale di Troina, prima sperimentazione architettonica normanna in Sicilia, en "Hortus Artium Medievalium", 25, n°2, Zagreb-Motovun, 2019, pp. 440-451.
F. LINGUANTI, Le recenti acquisizioni sulla cattedrale di Troina e lo schema a navata unica nella Contea normanna di Sicilia : un modello per la conquista ?, en "ABside", 4, 2022, pp. 95-110.
Bastien MICHEL : Servir saint Michel : les clientèles guerrières du Mont (XIIe-XIIIe siècles)
À travers l'étude des listes de vassaux conservées pour le Mont Saint-Michel (1172 et 1264), il s'agit de mettre en évidence l'insertion de l'abbaye dans les réseaux aristocratiques de la Normandie ducale et royale. Plusieurs points seront traités : 1) L'étendue des réseaux aristocratiques du Mont dans les mondes normands et français médiévaux ainsi que leur ancrage territorial normand (à travers, par exemple, les domaines de Bretteville-sur-Odon et Verson) ; 2) La nature du service militaire auquel sont astreints les vassaux du Mont, en particulier le service de garde, dans le contexte d'un espace frontalier disputé ; 3) La recomposition du lien unissant l'abbaye à ses clientèles guerrières après l'intégration de la Normandie, et par extension du Mont, au domaine royal.
Bastien Michel est doctorant à l'université de Caen, rattaché au CRAHAM (dir. Pierre Bauduin). Sa thèse porte sur les vassaux des évêques de Bayeux (XIe-XIIIe siècle), étudiés sous l'angle des réseaux et des mobilités. Il s'intéresse aux rapports entre vassalité, fief et écrit dans les mondes normands médiévaux ainsi qu'aux trajectoires de l'aristocratie normande dans le duché, le royaume de France et en Europe.
Laurent MORELLE : L'exemption du Mont Saint-Michel : un cas d'étude à la lumière des travaux récents
L'historiographie de "l'exemption monastique", qu'on vise par cette locution le statut des communautés religieuses ou de leurs dépendances (par ex., les "paroisses exemptes"), doit beaucoup au terreau normand, comme l'atteste l'ouvrage majeur de Jean-François Lemarignier (1937), qui avait tracé la voie et solidement ancré l'étude dans des perspectives d'histoire institutionnelle et politique. Le thème de l'exemption a depuis connu flux et reflux, sans jamais cesser de retenir l'attention ; il semble même connaître un regain d'intérêt depuis quelques lustres, revisité dans le cadre de dossiers locaux ou dans des trajectoires plus longues et plus "surplombantes" qui englobent, de façon plus ou moins heureuse, les notions de recours à Rome et de protection apostolique. La question de la "territorialité" des pouvoirs (ecclésiastiques et seigneuriaux) tout comme la prise en compte d'acteurs laïques parfois minorés, au-delà de la triade Rome/évêque diocésain/communautés religieuses, ont déplacé les perspectives. Par ailleurs, des recherches majeures sur l'épiscopat et l'abbatiat normands comme sur les sources narratives ou diplomatiques du Mont Saint-Michel ont passablement rebattu la donne documentaire et herméneutique. Dans ce contexte, la communication se propose surtout de donner les lignes de faîte de ce renouveau historiographique et de rouvrir le dossier documentaire de "l'exemption" du Mont Saint-Michel, pour le XIe siècle essentiellement, à la lumière de ces travaux et en l'éclairant au besoin d'exemples extérieurs à la Normandie.
Laurent Morelle est directeur d'études à l'École pratique des hautes études (section des sciences historiques et philologiques) où son séminaire de recherche ("conférence") s'intitule "Pratiques médiévales de l'écrit documentaire". La plupart de ses travaux portent sur la diplomatique médiévale jusqu'au XIIe siècle, surtout en France septentrionale : production des actes (vrais et faux), leurs usages sociaux et leur réception dans les chartriers et l'historiographie. Il a codirigé avec Arnaud Baudin un volume sur Les pratiques de l'écrit dans les abbayes cisterciennes (2015) et, avec Chantal Senséby, un ouvrage sur les chirographes ou chartes parties : Une mémoire partagée : Recherches sur les chirographes en milieu ecclésiastique (France et Lotharingie, Xe-mi XIIIe s.) (2019). Il collabore à l'entreprise internationale de la Gallia Pontificia (les relations entre la France et la papauté jusqu'en 1198) et travaille sur les communautés monastiques du haut Moyen Âge et Moyen Âge central, notamment sur leurs relations avec la papauté et les évêques. C'est au carrefour de ces différents domaines de recherche qu'il a rencontré le cas du Mont Saint-Michel.
Benjamin POHL : L'atelier de l'abbé-historien du Mont Saint-Michel : Robert de Torigni, où a-t-il écrit ?
À un colloque consacré à l'abbaye de Mont Saint-Michel, le nom de Robert de Torigni nécessite peu d'introduction. Après une carrière à l'abbaye normande du Bec-Hellouin, Robert est devenu l'abbé du Mont Saint-Michel en 1154, et occupait cette fonction jusqu'à sa mort en 1186. Pendant les trente années de son abbatiat, Robert a écrit plusieurs œuvres d'histoire, y comprit avant tout sa Chronica, mais aussi sa rédaction des Gesta Normannorum ducum, auxquelles il a continué à apporter des ajouts et des révisions jusqu'aux années 1180. Robert a également joué un rôle instrumental dans l'expansion de la bibliothèque domestique de l'abbaye en commandant la production de livres en interne tout en utilisant son autorité et son influence abbatiales pour se procurer des volumes de plus loin. À cause de l'intérêt renouvelé des chercheurs pour Robert et ses œuvres au cours des dernières années, nous en savons maintenant plus que jamais sur les différentes étapes de sa carrière, ses méthodes de travail en tant qu'historien et sa direction monastique. En revanche, ce qui n'a pas été étudié en détail jusqu'à présent c'est l'environnement physique dans lequel Robert a fait son travail intellectuel et d'écriture. Autrement dit : où a-t-il lu, recherché et écrit l'histoire en tant qu'abbé du Mont Saint-Michel ? Utilisait-il les installations communes (bibliothèque et scriptorium des moines) ou avait-il son studio privé ? Où aurait été située un tel studio, et que peut-on savoir de ses outils ? À partir de témoignages écrits, architecturaux et codicologiques, cette communication sera le premier à nous donner une idée plus précise de "l'atelier historique" de Robert.
Benjamin Pohl est maître de conférences (Associate Professor/Reader) en histoire médiévale à l'université de Bristol au Royaume-Uni. Il étudie l'écriture de l'histoire, les études manuscrites (paléographie et codicologie), l'histoire du livre, le monachisme et les études de la mémoire culturelle. Il est membre du Comité scientifique du Mont Saint-Michel en Normandie et en Europe et du Comité de rédaction de Tabularia : Sources écrites des mondes normands médiévaux. Il est l'auteur de plus de quarante articles et de deux monographies sur l'Historia Normannorum de Dudo de Saint-Quentin (2015) et les fragments manuscrits du Bristol Merlin (2021). Il a édité des volumes sur la mémoire et la narratologie (2013), l'abbaye normande du Bec (2017), l'historiographie monastique médiévale (2020) et la prochaine publication, The Cambridge Companion to the Age of William the Conqueror (2022). Il rédige actuellement deux nouvelles monographies, l'une sur le rôle des abbés médiévaux dans l'écriture de l'histoire (Abbatial Authority and the Writing of History in the Middle Ages), et l'autre sur le monastère d'Engelberg au XIIe siècle (Publishing in a Medieval Monastery : The View from Twelfth-Century Engelberg).
Publications
Abbatial Authority and the Writing of History in the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, à venir 2023/24.
"Robert of Torigni's "pragmatic literacy": some theoretical considerations / Quelques réflexions théoriques sur l'"écriture pragmatique" de Robert de Torigni", Tabularia (2022).
"The memory of Robert of Torigni : from the twelfth century to the present day / La mémoire de Robert de Torigni : du XIIe siècle à nos jours", in S. Lecouteux & F. Paquet (eds.), Maîtriser le temps & façonner l’histoire. Les historiens normands au Moyen Âge (2022), Colloque de Cerisy, Presses universitaires de Caen, p. 111–34.
"Review of Thomas N. Bisson (ed.), The Chronography of Robert of Torigni", History 106 (2021), 293–98.
"What sort of man should the abbot be ? Three voices from the Norman abbey of Mont Saint-Michel", in S. Vanderputten (ed.), Abbots and Abbesses as a Human Resource in the Ninth- to Twelfth-Century West, Vita Regularis, Zurich, LIT, 2018, 101–24.
"Robert of Torigni and Le Bec : the man and the myth", in B. Pohl & L. Gathagan (eds.), A Companion to the Abbey of Le Bec in the Central Middle Ages (11th-13th Centuries), Brill's Companions to European History, Leiden, Brill, 2017, 94–124.
"The date and context of Robert of Torigni's Chronica in London, British Library, Cotton MS. Domitian A viii, fols. 71r–94v", EBLJ 2016.1 (2016), 1–18.
"The "Bec Liber Vitae" : Robert of Torigni's Sources for Writing the History of the Clare Family at Le Bec, c.1128-54", Revue Bénédictine 126.2 (2016), 324–72.
"When did Robert of Torigni first receive Henry of Huntingdon's Historia Anglorum, and why does it matter ?", Haskins Society Journal 26 (2015), 143–67.
"Abbas qui et scriptor ? The handwriting of Robert of Torigni and his scribal activity as Abbot of Mont Saint-Michel (1154–1186)", Traditio 69 (2014), 45–86.
Éliane VERGNOLLE : Le chevet roman du Mont Saint-Michel. Une œuvre majeure du second quart du XIe siècle
Restituer le chevet du Mont Saint-Michel mis en chantier en 1023 peut sembler une gageure, compte tenu de sa disparition, en 1421. Les importantes substructures qui subsistent sous le chevet flamboyant, les fouilles et autres prospections menées depuis les années 1960 permettent néanmoins de connaître son plan tandis que la célèbre enluminure des très riches Heures du duc de Berry fournit sur son élévation des renseignements qu'éclaire la comparaison avec d'autres monuments de la même génération. L'analyse du transept, conservé dans son intégralité, apporte d'autres éléments d'information. Au total apparaît un chevet qui, avec son déambulatoire surmonté d'une tribune, s'inscrit dans un groupe de grandes abbatiales de la même génération également disparues pour tout ou partie mais dont l'étude a été récemment renouvelée (Saint-Martial de Limoges, Beaulieu-lès-Loches, Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, Landévennec) avec, en arrière-plan, le fantôme de Saint-Martin de Tours.
Éliane Vergnolle est Professeur honoraire à l'université de Besançon, membre correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Principales publications relatives au sujet
"Les tribunes de chevet dans l'architecture romane du début du XIe siècle", in Saint-Martial de Limoges. Millénaire de l'abbatiale romane (1018-2028), Bulletin monumental, n° spécial, 2020, p. 103-120.
Saint-Benoît-sur-Loire. L'abbatiale romane, Paris, 2018.
"L'église Saint-Denis. Un chef d'œuvre roman méconnu", in Nogent-le-Rotrou roman et gothique, Paris, 2022, p. 87-166.
Catherine VINCENT
Ancienne élève de l'École Normale Supérieure (promotion 1976), Catherine Vincent est actuellement professeur émérite d'Histoire du Moyen Âge de l'université Paris Nanterre, après avoir été en fonction à l'université de Rouen et à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ; de 2011 à 2016, elle a été membre senior de l'Institut universitaire de France. Depuis 2011, elle est présidente de la Société d'Histoire Religieuse de la France et depuis 2018 présidente de l'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS), fondée le 8 juin 1998 à Turin ; elle est également membre du comité de lecture de la Revue d'Histoire de l'Église de France et, en Italie, de la revue Vetera Christianorum (Università di Bari). Ses premières recherches ont porté sur les confréries médiévales (Les confréries dans le royaume de France, XIIIe–XVe siècle, Paris, Albin Michel, 1994) ; puis elle a travaillé sur l'histoire des paroisses (Histoire des curés, N. Lemaitre (dir.), Paris, Fayard, 2002, partie médiévale) et des pratiques religieuses, dont les luminaires dans le culte chrétien (Fiat Lux : lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIIIe au XVIe siècle, Paris, Le Cerf, 2004). Elle s'intéresse actuellement aux pèlerinages et au culte des saints en Occident durant la seconde moitié du Moyen Âge (coordination de deux volumes d'actes de colloques : Identités pèlerines, Actes du colloque de Rouen, 15-16 mai 2002, Rouen, PURH, 2004 et Cathédrale et pèlerinage, édition avec Jacques Pycke, Louvain, Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, Fascicule 92, 2010). Elle a aussi dirigé avec Daniel Le Blevec et Michelle Fournie, le 53e colloque de Fanjeaux, Corps saints et reliques dans le Midi, Toulouse, Privat, 2018, et avec Anne Bonzon, Isabelle Poutrin et Alain Tallon, Marc Venard, Historien, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, "Collection d'Histoire religieuse de la France, 48". Elle a co-dirigé, avec Armelle Sentilhes, Yves Lescroart et Jean-Pierre Chaline, le volume consacré à la cathédrale de Rouen dans la collection "La Grâce d'une cathédrale" fondée aux éditions de la Nuée Bleue par Monseigneur Joseph Dore (archevêque émérite de Strasbourg). Sur le culte de saint Michel, elle indiquera sa récente synthèse : "Le culte de saint Michel en France", dans Saint Michel, Giorgio Otranto et Sandro Chierici (dir.), Milan, Paris, Ultreya, Le Cerf, 2022, p. 154-165 (éditions en italien : San Paolo et en allemand : Schnell-Steiner). Pour les étudiants et un plus large public, elle a publié Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, Paris, Le Livre de Poche, 1995, collection "Références" (traduction en italien aux éditions Il Mulino), dirigée la partie médiévale de L'Histoire du christianisme, A. Corbin (dir.), Paris, Le Seuil, 2007, paru en livre de poche en 2013 (Points H475) et publié Église et société en Occident, XIIIe-XVe siècle, Paris, Armand Colin, 2009, "Collection U".
L'œuvre de Pierre Bouet autour de l'archange. Du Mont Saint-Michel au Monte Gargano, soirée animée par Marie-Agnès LUCAS-AVENEL et François NEVEUX
Pierre Bouet a été un grand enseignant de l'université de Caen, très apprécié des étudiants. Il était un pilier du département de latin. En matière de recherche, il a considérablement innové, puisqu'il s'est consacré aux auteurs latins du Moyen Âge, qui étaient alors délaissés par les universitaires français. De plus, il a initié et développé les recherches pluridisciplinaires sur la Normandie ducale en fondant l'OUEN (Office universitaire d'études normandes). Il a centré ses travaux sur les historiens des XIe et XIIe siècle : Dudon de Saint-Quentin, Guillaume de Jumièges, Guillaume de Poitiers et Orderic Vital. Concernant l'archange, il a publié en 2009 aux PUC (avec Olivier Desbordes) les Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècle). Pierre Bouet est aussi l'initiateur de nombreux échanges avec des collègues étrangers, aussi bien en Angleterre qu'en Italie (et notamment à Bari). À Cerisy, il a créé en 1992 le cycle de colloque sur La Normandie médiévale. Nombre des colloques de ce cycle ont eu saint Michel comme objet d'études, et en particulier le colloque de 2000 intitulé Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l'archange (École française de Rome, 2003).
Cette communication se fera à deux voix. François Neveux évoquera le collègue universitaire et ses travaux, alors que Marie-Agnès Lucas-Avenel donnera le point de vue de l'ancienne étudiante, qui a fait une thèse consacrée à la publication de l'œuvre d'un auteur d'Italie du Sud, Geoffroi Malaterra, Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard (publié aux PUC en 2016). Pierre Bouet a guidé et suivi très attentivement ce travail pendant des années.
Après leur intervention, les deux auteurs de la communication dirigeront une table ronde autour de l'œuvre multiforme de Pierre Bouet, qui sera présent en personne.
Marie-Agnès Lucas-Avenel est Professeur de langue et littérature latines de l'université de Caen Normandie.
François Neveux est Professeur émérite d'histoire du Moyen Âge de l'université de Caen Normandie.
BIBLIOGRAPHIE :
Sources
• BISSON M., "Où sont les archives du Mont Saint-Michel ?", in Sur les pas de Lanfranc, du Bec à Caen. Recueil d'études en hommage à Véronique Gazeau, Cahiers des Annales de Normandie, n°37, 2018, p. 453-464.
• Cartulaire du Mont Saint-Michel. Fac-similé du manuscrit 210 de la bibliothèque municipale d'Avranches, BOUET P. et DESBORDES O. (éd.), Arcueil, Anthèse, 2005.
• Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont Saint-Michel, suivie de divers opuscules historiques de cet auteur et de plusieurs religieux de cette même abbaye, DELISLE L. (éd.), Rouen, Le Brument, 1872-1873.
• Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècles), BOUET P. et DESBORDES O. (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2009.
• DOSDAT M., L'enluminure romane au Mont Saint-Michel, Xe-XIIe siècles, Rennes, Ouest-France, 1991.
• Le Mont Saint-Michel : enluminures et textes fondateurs : traduction française des chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècles), BOUET P. et DESBORDES O. (éd. et trad.), Rennes, Ouest-France, 2018.
Généralités
• FIASSON D., "Abbaye et forteresse : le Mont Saint-Michel au péril de la guerre (des débuts de la guerre de Cent Ans à l'avènement de Pierre Le Roy)", Les Amis du Mont-Saint-Michel, n°119, 2014, p. 129-159.
• GAZEAU V., Normannia monastica, Tome 1 - Princes normands et abbés bénédictins (Xe-XIIe siècles) et Tome 2 - Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIe siècles), Caen, Publications du CRAHM, 2007.
• Millénaire monastique du Mont Saint-Michel, Paris, Lethielleux, 1966-1993, 5 vol.
• Millénaire monastique du Mont Saint-Michel : 966-1966 (Catalogue de l'exposition de Paris et du Mont-Saint-Michel), Paris, Caisse nationale des monuments historiques, 1966.
Saint Michel et son culte
• Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l'archange (Actes du colloque de Cerisy, 26-30 septembre 2000), BOUET P., OTRANTO G. et VAUCHEZ A. (dir.), Rome, École française de Rome, 2003.
• Culto e santuari di san Michele nell'Europa medievale (Actes du colloque de Bari, 5-8 avril 2006), BOUET P., OTRANTO G. et VAUCHEZ A. (dir.), Bari, Edipuglia, 2007.
• Pellegrinaggi et santuari di San Michele nell'Occidente medievale (Actes du colloque de Sacra di San Michele, 26-29 septembre 2007), CASIRAGHI G. et SERGI G. (dir.), Bari, Edipuglia, 2009.
• Rappresentazioni del Monte e dell'Arcangelo san Michele nella litteratura e nelle arti (Actes du colloque de Cerisy, 29 septembre-3 octobre 2008), BOUET P., OTRANTO G. et VAUCHEZ A. (dir.), Bari, Edipuglia, 2011.
Le monument : histoire de l'art et archéologie
• DE BOÜARD M., "L'église Notre-Dame-sous-Terre au Mont Saint-Michel. Essai de datation", Journal des savants, n°1, 1961, p. 10-27.
• DELAHAYE F., "Construction et évolution des fortifications du Mont Saint-Michel (XIIIe-XVIIIe siècles)", Les Amis du Mont Saint-Michel, n°118, 2013, p. 37-60.
• FROIDEVAUX Y.-M., "L'église Notre-Dame-sous-Terre", Les monuments historiques de France, n°4, 1961, p. 145-166.
• GALLET Y., "Le chevet flamboyant du Mont Saint-Michel et ses modèles dans l'architecture gothique des XIIIe et XIVe siècles", Les Amis du Mont Saint-Michel, n°108, 2003, p. 43-55.
• MARGO F., "Les cryptes romanes du Mont Saint-Michel : ordonnancement des espaces", dans Espace ecclésial et liturgie au Moyen Âge (Actes du colloque de Nantua, novembre 2006), BAUD A. (dir.), Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2010, p. 369-378.
Pour aller plus loin
• PAQUET F., "Histoire et archéologie du Mont Saint-Michel : bibliographie scientifique", Annales de Normandie, n°71-1, 2021, p. 147-180.
SOUTIENS :
• Direction régionale des affaires culturelles Normandie (DRAC)
• Établissement public national du Mont Saint-Michel (EPMSM)
• Centre des monuments nationaux
• Centre Michel de Bouärd · CRAHAM · UMR 6273 | Université de Caen Normandie / CNRS
• Office universitaire d'études normandes (OUEN) | Université de Caen Normandie
• Caen la Mer
• Conseil départemental de la Manche