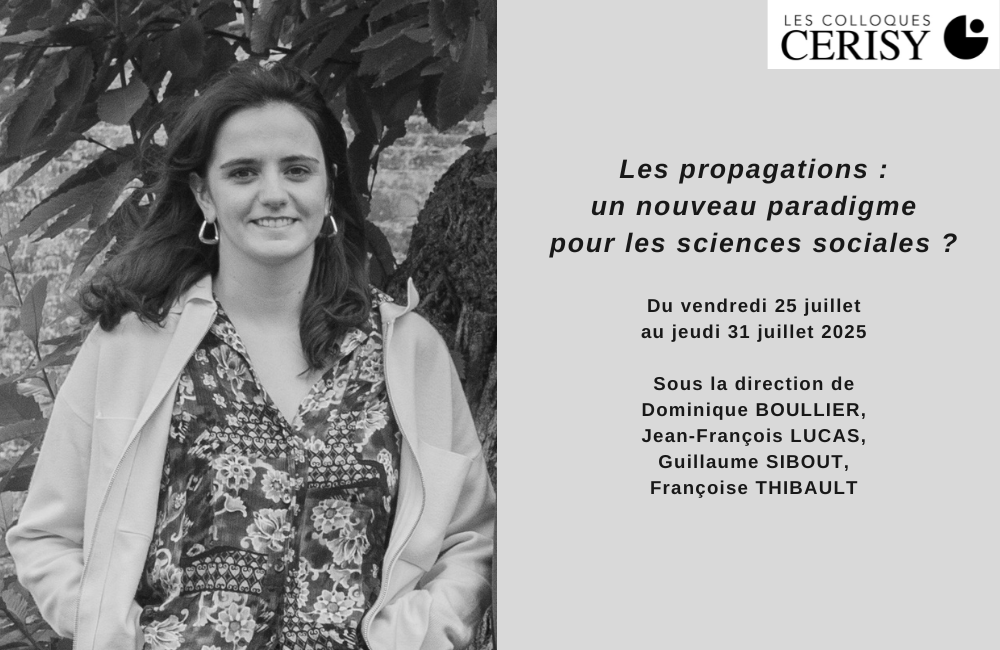"TÉMOIGNAGE D'UNE THÉSARDE AU CENTRE DE SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS (CSO)"
RENCONTRE AVEC LAURE GUIMBAIL
Suite de nos échos au colloque Les propagations : un nouveau paradigme pour les sciences sociales ? qui s'est déroulé du 25 au 31 juillet 2025, à travers, cette fois, un entretien avec Laure Guimbail qui poursuit une thèse au Centre de sociologie des organisations (CSO).
Qu'est-ce qui vous a motivée à assister à ce colloque ?
Laure Guimbail : Je connais depuis plusieurs années Jean-François Lucas, codirecteur du colloque. J'ai été bénévole à Renaissance Numérique, le think tank qu'il dirige. J'avais déjà travaillé avec lui du temps où il était consultant chez Chronos (cabinet d'études sociologiques et de conseil en innovation fondé par Bernard Marzloff). Puis j'ai eu envie de tenter ma chance, si je puis dire, dans la recherche en faisant une thèse. J'y ai été encouragée en 2023 par une offre d'emploi d'assistante de recherche à la Chaire Villes et Numérique de Sciences Po, dans laquelle travaillait Antoine Courmont, un ancien doctorant de Dominique Boullier, dont j'ai ainsi pu découvrir les travaux.
Sur quoi porte votre thèse ?
Laure Guimbail : Ma thèse, sous la direction d'Olivier Borraz, sociologue, spécialiste de la préparation à la gestion des crises, porte sur l'impact des nouvelles technologies sur cette préparation et cette gestion. Un enjeu auquel je m'intéresse depuis plusieurs années — en 2020, mon mémoire de fin d'étude en master sur l'"Analyse spatiale de la résilience en milieu urbain, le cas de la reconstruction de Mexico suite aux tremblements de terre de septembre 2017". Concrètement, dans ma thèse, je m'intéresse à la manière dont les autorités s'informent pour prendre les meilleures décisions en situation de crise. De prime abord, j'ai fait l'hypothèse que cela passait par le traitement de données numériques. Je m'étais imaginé un univers de science-fiction, à la Matrix, avec des acteurs rivés à leur écran d'ordinateur ou de téléphone portable. En réalité, en faisant un travail de terrain, j'ai pu mesurer à quel point la réalité est plus compliquée. Cela passe aussi par des interactions humaines, sociales, informelles. Les acteurs se renseignent auprès d'autres, de préférence qu'ils connaissent déjà et en qui ils peuvent avoir confiance quant à la qualité de l'information : en contexte de crise, ils ne disposent pas de beaucoup de temps ; il leur faut pouvoir avoir très vite des informations fiables.
Au cours d'une crise, une rumeur peut surgir d'un coup et se propager à une grande échelle non sans provoquer des phénomènes de foules. On l'a vu récemment avec les incidents survenus après un match du PSG ou la Fête de la musique. La foule se répand dans l'espace urbain, ce qui crée une situation on ne peut plus difficile et stressante pour les gestionnaires de crise. D'où vient l'information qui a déclenché le mouvement de foule ? Comment se propage-t-elle ? Vers où la foule va-t-elle se diriger ? La RATP a-t-elle fermé l'accès à des stations de métro ? Autant de questions, qui nécessitent le recueil d'informations réparties en différents endroits, leur transcription au moyen de logiciels, mais en débutant souvent par un simple appel téléphonique, un message adressé à un groupe WhatsApp, une boucle d'emails, etc.
Au sein de quel laboratoire menez-vous cette thèse ?
Laure Guimbail : J'ai fait le choix de faire cette thèse au CSO (Centre de sociologie des organisations), car j'avais besoin de disposer d'autres outils théoriques, d'autres données que celles habituellement traitées dans la perspective des infrastructures studies. Des travaux que j'avais lus sur cette sociologie des organisations m'avaient convaincue de leur intérêt. Quand j’ai appris la tenue du colloque sur les propagations, j'y ai vu l'opportunité d'élargir encore mon horizon.
Avec quel sentiment en repartez-vous ? Celui d'avoir enrichi votre grille de lecture, votre corpus théorique ? Avec de nouveaux questionnements ?
Laure Guimbail : Oui ! J'ai été notamment très intéressée par la notion de "voisinage" qui éclaire la nature des interactions sociales : les gens interagissent d'autant plus qu'ils ont eu l'occasion de se rencontrer en d'autres occasions, voire de travailler ensemble et de connaître le fonctionnement de leurs organisations respectives. En revanche, la notion de trace, également évoquée au cours du colloque, s'applique avec moins d'évidence.
J'ai aussi beaucoup apprécié les discussions sur les acteurs des plateformes numériques, qui façonnent certains circuits d'information, en décidant de leur degré d'accès. À l'heure des réseaux sociaux, la question se pose naturellement de savoir comment en faire un outil d'information opérationnel. Une question particulièrement prégnante dans le champ de recherche sur la gestion de risque. Seulement, suite aux nouvelles réglementations relatives à l'accès aux données, leur exploitation est plus difficile, au point que des projets de recherche ont même dû s'interrompre.
Qu'est-ce que cela vous a-t-il fait, à vous qui poursuivez une thèse en sociologie, de vous retrouver au milieu de participants d'autres horizons disciplinaires sinon professionnels ? En quoi cela a-t-il été déstabilisant ou, au contraire, stimulant ? De même que la différence de registre de langage entre les chercheurs en SHS, les philosophes, les professionnels du numérique et des réseaux sociaux, etc. ?
Laure Guimbail : Je trouve intéressante la possibilité qui a été donnée à des chercheurs des sciences dites dures et des sciences humaines et sociales de confronter leur point de vue. Pour ma part, j'ai été très stimulée par les communications relatives aux épidémies et autres phénomènes de virologie, d'autant que les spécialistes de ces domaines avaient consenti un effort pour être compréhensibles de tous ; bien plus, ils se sont mis à notre place pour comprendre ce qui, dans leur approche, leurs méthodes, pouvait nous être utile. En l'espace d'une communication, non seulement, on comprend ce que recouvre l'épidémiologie, mais aussi en quoi elle peut intéresser les chercheurs en SHS, être appliquée à nos propres travaux de recherche. Quant aux approches plus philosophiques ou de géographes, elles ont le mérite de pointer d'autres variables que celles auxquelles on pense dans la perspective de sa discipline. Je songe en particulier à la dimension spatiale que nous autres sociologues avons tendance à sous-estimer. J'y ai été d'autant plus sensible qu'avant de faire ma thèse, je me suis intéressée aux politiques urbaines, dans la perspective d'une sociologie urbaine qui prenait a priori en compte cette dimension spatiale sinon territoriale. Elle est de fait essentielle dans le cadre de ma thèse qui s'intéresse à des situations de gestion de crise au sein de la Ville de Paris, un cas particulier sous ce regard. Il me faudra souligner ses spécificités sociales, mais aussi spatiales avant de prétendre généraliser mon propos, le transposer à d'autres contextes urbains.
À vous entendre, vous quittez le colloque enrichie de nouveaux concepts comme aussi d'ailleurs probablement d'interrogations ?
Laure Guimbail : Et aussi avec beaucoup de travail en perspective ! [Rire]. Car il va me falloir non pas tant combler un retard — je n'ai pas eu le sentiment durant cette semaine d'avoir mis ma thèse entre parenthèse ; toute auditrice que je fusse j'étais venue avec la claire intention de nourrir ma réflexion théorique —, qu'intégrer l'apport des exposés, me plonger dans les très nombreuses références bibliographiques qui ont été citées.
Comment avez-vous vécu cette première expérience de colloque de Cerisy qui tranche avec les colloques scientifiques proprement dit, ne serait-ce que par sa durée — six jours en ce qui concerne celui-ci —, la pluralité des intervenants, la présence d'auditeurs, sans oublier ces repas qu'on partage ensemble… ?
Laure Guimbail : J'ai été d'autant plus surprise que, au risque de devoir reconnaître un trou dans ma culture générale, je ne connaissais pas Cerisy avant de découvrir l'annonce du colloque. Même si j'ai su très vite que ce ne serait pas un colloque scientifique ordinaire, j'avais imaginé un de ces séminaires comme en organisent des entreprises, dans de beaux endroits comme ce château, mis juste à disposition [Rire]. Heureusement, j'ai été briefée dans le train. Vous imaginez donc ma surprise ! Même si le programme était chargé avec jusqu'à parfois cinq communications par jour, chacune de 40 minutes, suivie d'un débat, j'ai trouvé ce séjour plutôt reposant. Il faut dire que le cadre est magnifique ; nous sommes environnés de nature. Nous avions le temps de faire des promenades dans le parc ou les alentours… Le fait de partager les repas, de baigner dans une forme de sociabilité, rend d'autant plus simple, l'accès à des spécialistes reconnus dans leur domaine. Nul doute que nous n'aurions pas la même relation avec eux que dans un contexte plus académique. Ici, on peut créer des liens susceptibles de perdurer bien au-delà du colloque. J'ai pu ainsi sympathiser avec des personnes ressources dont je sais que je pourrais les solliciter en cas de besoin pour m'éclairer sur un point de méthode, un concept, utile à ma thèse.
Comme aime à le dire Edith Heurgon, un colloque de Cerisy, c'est une "communauté éphémère" qui se prolonge en principe jusqu'à la publication des actes, sans exclure que des relations perdurent bien au-delà entre des participants…
Laure Guimbail : Sans attendre ces prolongements, le moment présent est précieux ; autant donc le vivre pleinement. La jeune doctorante que je suis mesure sa chance d'avoir pu accéder à des chercheurs de ce niveau-là, de manger avec tel ou tel pour prolonger une discussion et ce, en dehors de tout rapport hiérarchique.
N'empêche, n'y a-t-il pas de quoi être impressionné, la première fois qu'on vient, en découvrant dans le hall d'entrée du château ces photos où figurent tant d'illustres penseurs, chercheurs, écrivains…
Laure Guimbail : C'est vrai que c'est impressionnant ! En les découvrant, je me suis sentie toute petite… Je me suis demandé comment donc j'avais pu ignorer l'existence de ce lieu ! [Rire]. Donc, non, ici, nous ne sommes pas dans un château juste mis à disposition le temps d'un séminaire. Celui-ci est chargé d'une histoire qui en fait un lieu singulier.
Propos recueillis par Sylvain ALLEMAND
Secrétaire général de l'AAPC