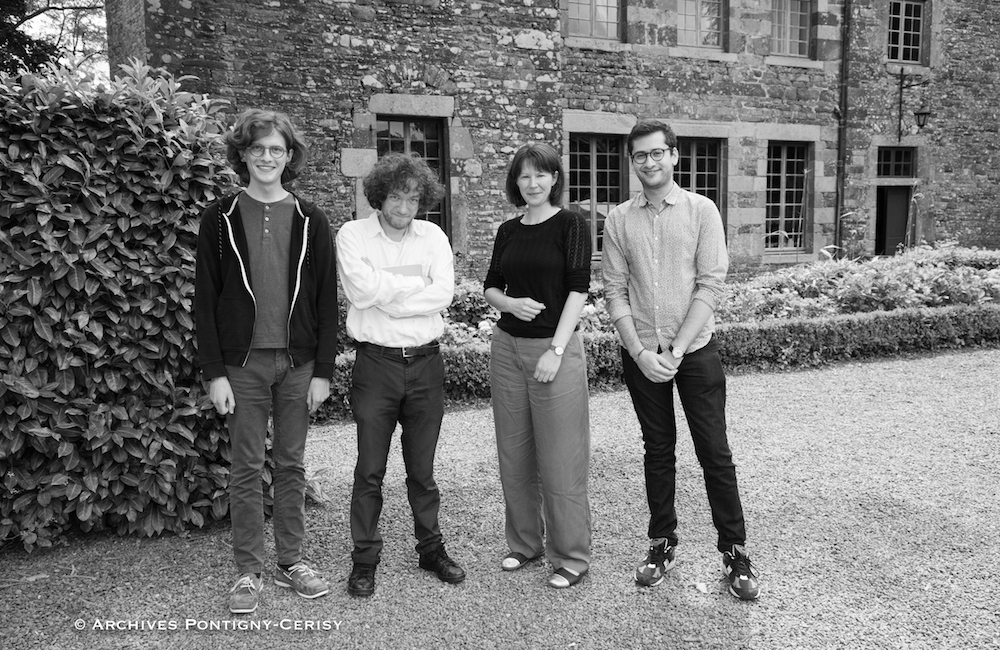"LEVINAS, MERLEAU-PONTY ET LE PING-PONG"
PAR ANTONIA SCHIRGI
Antonia Schirgi est chercheuse et enseignante à l'Institut de sociologie de l'université de Graz, Autriche. Le titre de sa thèse est "Sur la distance proche et la proximité distante : une théorie des rencontres humaines sur la base de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty". Voici le rapport d'étonnement qu'elle a présenté lors de la dernière séance du colloque Levinas et Merleau-Ponty : le corps et le monde, qui s'est tenu à Cerisy du 6 au 12 juillet 2022.
Un château, un lieu extraordinaire, la philosophie, Levinas, Merleau-Ponty, le Japon, la France et une doctorante autrichienne. Les discussions intensives, les rencontres et … une cave avec une table de ping-pong. Le tennis de table est un jeu que je ne pratique pas habituellement, mais qui s'intègre tout naturellement dans l'expérience cerisyenne. Il n'est pas seulement un jeu qu'on peut pratiquer à Cerisy, mais, en même temps, une activité qui démontre certains éléments de la philosophie discutée pendant le colloque. Un colloque sur le corps et le monde, un jeu pratiqué par des êtres corporels, dans une cave, en interaction avec la matérialité (la raquette, la balle, la table, les autres corps), avec le monde.
Un soir on commence le jeu à cinq. Une certaine disharmonie se manifeste. Que s'est-il passé ? Le jeu de ping-pong présuppose une certaine façon de percevoir, de se mouvoir ou certaines habitudes sensorimotrices. Avec Merleau-Ponty, on peut dire qu'un jeu de ping-pong — réalisé par des personnes qui le pratiquent régulièrement — est un moment où "le corps habituel peut se porter garant pour le corps actuel" (Merleau-Ponty, Maurice, 1945, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, p. 98). Autrement dit, la praxis, incorporée dans le schéma corporel, s'applique tout naturellement. Les non-habitués doivent apprendre à se mettre en place, à interagir avec les choses et à percevoir les mouvements d'une façon qui permette une réponse adaptée
Repartons de notre groupe ; certains joueurs ou joueuses ont besoin de commencer par ré-apprendre le jeu, d'autres sont plus professionnels. Pour les premiers, commence un moment d'enseignement ou de ré-enseignement. Re-commencer à jouer est une manière de se souvenir d'une habitude antérieure, d'une praxis incorporée dès l'enfance, quasiment oubliée, quasiment perdue. Même si cette perte n'est pas comparable avec la tragédie de la perte de diverses possibilités corporelles après une grave lésion, comme Merleau-Ponty l'a décrite quand il cherche une manière de comprendre philosophiquement le phénomène du membre fantôme, la différence entre des pratiques possibles pour certains et des pratiques possibles pour moi, qui devient évidente dans cette expérience, peut être comprise de la même façon. Pendant une longue période sans jouer au ping-pong, pouvoir y jouer est devenu une possibilité générale, quelque chose que l'on peut faire, pas plus quelque chose que je peux faire.
Pour rendre cette praxis ré-accessible au corps, nous commençons spontanément par un cours de tennis de table. L'enseignement des capacités motrices contient l'étrange nécessité d'expliciter quelque chose qu'en général on n'explicite pas et qui n'est pas facilement accessible à la conscience. Il se réfère à la praxis, aux puissances inscrites dans le schéma corporel. Notre professeur de ce soir-là est quelqu'un qui sait enseigner. Ce savoir lui-même peut être compris comme une praxis. L'enseignant a appris à rendre la praxis accessible à la conscience de soi et à la conscience des autres. Il sait expliciter la façon de travailler la raquette, d'interagir avec la balle, de se comporter envers la table et envers l'autre. Pour nous, les élèves, l'apprentissage est un processus au sein duquel ce nouveau savoir surpasse la conscience, ne reste plus quelque chose qu'on peut décrire de façon technique, mais quelque chose que le corps sait faire ; c'est une praxis qui devient lentement accessible ou ré-accessible au corps comme puissance motrice ; les corps commencent à s'habituer, la praxis commence à se (ré-)installer dans le schéma corporel. Un échange entre les joueurs commence et les interactions deviennent plus longues. On apprend à percevoir la balle dans sa puissance de se mouvoir d'une certaine façon — voir le mouvement, écouter le cliquètement quand la balle touche la table et quand elle est touchée par la raquette. On sent les interactions de la raquette avec la main et de la raquette avec la balle. La raquette dans la main devient quelque chose avec laquelle on joue la balle, quelque chose qui devient partie de notre motricité. D'une certaine façon la raquette devient parti de mon schéma corporel, même si ce système commun est fragile. Jouer implique voir, mais en même temps prévoir ; prévoir le mouvement de la balle et le mouvement de l'autre. Prévoir est une manière de surpasser le monde concret, d'imaginer le mouvement et l'avancement du jeu. Prévoir l'avancement du jeu est prévoir une future situation qui "apparaît flottante" devant moi. Le corps joue avec les avancements possibles et les potentiels mouvements de lui-même — le corps est un corps virtuel, un "corps phantastique" (Annabelle Dufourcq).
Il y a encore plusieurs aspects d'un jeu de ping-pong que l'on peut analyser avec la philosophie de Merleau-Ponty, particulièrement la relation entre les joueuses et les joueurs. Je voudrais juste mentionner un dernier aspect : un jeu comme celui-ci est une expérience commune à plusieurs personnes qui jouent ensemble, qui vivent une situation ensemble. Cette situation est plus que l'activité de jouer et plus que la "situation" sur la table, mais contient aussi cet être ensemble et l'ambiance — la cave avec son odeur agréable d'un lieu avec une longue histoire. Finalement, l'expérience en commun ne s'est pas limitée au jeu de ping-pong, c'est tout le colloque qui a été une vraie expérience en commun. Une expérience qui présuppose qu'on la vive ensemble, qu'on soit corporellement co-présent dans cette petite partie du monde, dans ce colloque sur le corps et le monde. Cette expérience en commun est quelque chose qui dépasse l'échange d'information, la discussion, même si elle est intense. C'est une expérience particulière ; elle est perçue de façon d'autant plus particulière après deux années marquées par la crise sanitaire et les restrictions prises pour l'endiguer. Mon travail philosophique discute justement cette différence, la différence graduelle entre les expériences en face à face et les rencontres à "distance".